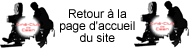|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Colloque-rencontres : "Pour vous, qu'est-ce que le cinéma ?"
35 personnalités invitées par Carole Desbarats, critique et historienne du cinéma, à répondre à la question inspirée d’André Bazin, en 15 minutes chrono, extraits à l’appui : "Pour vous, qu’est-ce que le cinéma ?"
 |
 |
|
samedi soir, grande fête au
Théâtre de Caen pour les 35 ans du café des Images
et le passage de Relais entre Geneviève Troussier et Yannick Reix |
|
Samedi 5 avril
9h30 : Introduction par Carole Desbarats
9h40 : Jean-Luc Lacuve, fondateur du site du Ciné-club de Caen.
Animateur d'une séance mensuelle de Ciné-club au Café
des Images depuis sept ans.
 |
 |
|
Lettre
d'une inconnue (Max Ophuls, 1948).
Fin de lecture de la lettre par Stefan : le rond de fumée autour
du cadre et la roue du destin qui s'arrête.
|
|
Le cinéma c'est pour moi revoir plusieurs fois un film que j'aime afin d'en organiser les signes. Se dégagent trois types de signes, générateur chacun du frisson dans le dos : "le signe musical" que l'on perçoit à la première vision d'un film et qui fait résonner une image avec une autre. "Le signe esthétique" qui surgit lorsque l'on voit comment le film est fait et "le signe théorique" qui n'est pas toujours généré par l'image la plus forte du film mais qui permet de trouver le fil conducteur qui permettra d'ordonner dans une vision cohérente l'ensemble des signes perçus. (voir : ici texte complet)
10h00 : Edith Perin, responsable du cinéma à la Scène
nationale la Coursive à La Rochelle
 |

|
|
Elle
et Lui, (Leo McCarey, 1957). Le 1er baiser après la visite
à la grand-mère
|
|
Les grandes émotions qu'Edith Perin a ressenties par le cinéma, le furent toujours dans une salle de cinéma. Ainsi dans la séquence choisie de Elle et lui : quand quelque chose de grave s'empare de ce qui n'était jusqu'alors que pure comédie pétillante. Elle et Lui, c'est Adam et Eve sur une musique bouleversante qu'annonce déjà le générique. C'est de l'humour et du champagne rosé puis, après la visite à la grand-mère, l'impression de quitter un paradis terrestre et d'affronter la violence et la réalité de l'amour avec ce premier baiser qui suit une première scène où il est refusé puis accordé en descendant les escaliers alors que ne sont montrées que les jambes.
Ce moment intense résonne alors avec d'autres moments intenses d'autres films qui submergent alors : le pas de deux de Cyd Charisse et Fred Astaire dans Tous en scène, le regard caméra de Sylvia Bataille dans Partie de campagne ou le baiser du capitaine John dans Le fleuve.
10h20 : Daniela De Felice, cinéaste et plasticienne et Matthieu
Chatellier, cinéaste et directeur de la photo
 |
 |
|
Casa
(Daniela de Felice, 2013) : souvenir du frère
|
|
 |
 |
|
Voir
ce que devient l’ombre (Matthieu Chatellier, 2010) : Fred Deux
évoque son père
|
|
Casa, est un film réalisé par Daniela de Felice avec, comme acteurs, sa mère et son frère pour réaliser le travail du deuil de leur mari et père. Faire le deuil, c'est à dire donner du sens tout en changeant d'axe pour se tourner vers le futur. C'est choisir et découper de petites choses qui permettent de mieux voir la totalité du réel. Comment le frère se souvient de son père qui le saisissait dans ses bras et passe alors sa main, devenue celle de son père, sur son épaule. Le plan long inclut ce moment où la parole de la cinéaste surgit pour la première fois dans l'interview, assez longtemps après que la parole du frère se soit tue pour l'accompagner d'un "je t'aime" fraternel d'une voix chuchotée.
Matthieu Chatellier dit sa difficulté à voir l'un de ses films en salle tant il redoute le moindre mouvement d'un spectateur qu'il pourra interpréter comme un signe d'ennui. Seule exception, le plaisir à revoir Voir ce que devient l’ombre (2010) car Fred Deux ne peut aujourd'hui, très âgé et malade, s'exprimer comme il le faisait encore il y a cinq ans. Réentendre la parole de Fred Deux est toujours un moment intense pour Matthieu Chatellier qui ressent alors pleinement une fonction essentielle du cinéma de préserver ses personnages de la corruption du temps.
10h40 : Eugène Andreanszky, délégué général
de l’Association Les Enfants de cinéma
 |
 |
|
Une incroyable histoire (Ted Tetzlaff, 1949)
|
|
Eugène Andreanszky, délégué général de l’Association Les Enfants de cinéma présente un extrait du film Une incroyable histoire (The Window) de Ted Tetzlaff réalisé en 1949, soit six ans avant La nuit du chasseur de Charles Laughton et qui raconte comment un petit garçon, Tommy, fabulateur, qui est le seul témoin d'une scène de meurtre, est poursuivi par un couple de tueurs. Le film qui s’appuie sur une fable d’Esope, L’enfant qui criait au loup, est un thriller haletant se déroulant dans un New York nocturne et inquiétant !
Venu au cinéma par les films de Ozu, Tarkovski et Fassbinder, Eugène Andreanszky, est aujourd’hui passionné par le cinéma documentaire et le dernier film qui l’a particulièrement marqué est le magnifique Tabou de Miguel Gomes, 2012. Il est sensible aux récits où émotions et violence ont partie liée. Curieusement, la boucle est bouclée puisque les premiers films vus parlaient d’enfants et qu’aujourd’hui il est en charge du projet national d’éducation artistique au cinéma Ecole et cinéma.
11h00 : Pause café
11h15 : Freddy Denaes, producteur, distributeur et éditeur Editions
de l'oeil
 |
 |
|
La
nuit du chasseur (Charles Laughton, 1955) : descente de la rivière
|
|
Freddy Denaes dédie un court extrait d'un film en noir et blanc à Geneviève Troussier : l'extrait se terminait par cette phrase : "Décidemment, j'aime Geneviève"
Freddy Denaes a commencé son parcours de cinéphile comme animateur dans un foyer socio-éducatif où, faute de mieux, il choisissait les films sur la simple foi du résumé. Il aurait pu faire de plus mauvais choix car les premiers ciné-clubs furent consacrés au Mécano de la General et à La nuit du chasseur dont il présente un extrait : la merveilleuse descente le long de la rivière.
Freddy Denaes poursuivit sa cinéphilie au sein de l'association Peuple et culture au milieu des années 70. C'est là qu'il rencontre Chris Marker, Serge Daney, Jeanine Bazin et son formidable festival de Belfort.
Freddy Denaes va ensuite rencontrer Idrissa Ouedraogo dont il veut financer le premier film, ce qu'il ne pourra faire, mais il parviendra à financer son second, Yabaa (1989). Aujourd'hui, en éditant l'œuvre complète de Jean Daniel Pollet en DVD, 10 ans après sa mort, il a la conviction de prolonger son combat politique et artistique.
11h35 : Olivier Baudry, architecte des grandes évolutions architecturales du Café des Images
 |
 |
|
Autant en emporte le vent (Alan Fleischer, 1979,
3')
|
|
La problématique que cherche à résoudre Olivier Baudry pour construire une salle de cinéma est de suggérer, dans un espace physique limité, un espace mental illimité. Si La rose pourpre du Caire avec son personnage qui sort de l'écran évoque cette problématique, c'est aussi le cas de Autant en emporte le vent (Alain Fleischer, 1979, 3') où, en superposant deux images, celle du ventilateur produisant le vent et celle du visage de la jeune femme dont les cheveux sont agités par ce vent artificiel, on obtient dans une unique image un court-circuit entre l'effet et sa cause. (voir ici : développements sur le bâtiment du Café des images)
11h55 : Olivier Ducastel, cinéaste et scénariste en binôme
avec Jacques Martineau, diplômé de l’ENS et agrégé
de lettres, il enseigne à l’université de Paris X Nanterre
 |
 |
|
Hair
(Milos Forman, 1979)
|
|
C'est Olivier Ducastel qui explique le choix de l'extrait ; un extrait qui donne envie de faire du cinéma. C'est à dire qui rassure, sur ce que l'on pourrait essayer de mieux faire, et qui fait peur aussi, s'il atteint une forme de perfection.
Choisir une métaphore du cinéma assez sexy pour bouleverser le monde et le confort de nos représentations et nous faire entendre ce que l'on n'a pas toujours envie d'entendre. Le cinéma nous donne à admirer et réveille notre regard par l'exposition d'un corps, souvent, comme ici, surtout avec des jambes et des fesses. Le cinéma c'est du désir. Et le désir est d'autant plus désirable qu'il est vu dans un regard désirant.
On pourrait aussi dire que le cinéma est un art de fantômes, un art à fabriquer des fantômes… quand on voit, comme Ducastel et Martineau après le visionnage de cet extrait sur un poste de télévision, en direct, aujourd'hui, Treat Williams, l'acteur principal de Hair dans une série américaine.
12h15 : Echange avec la salle
Le cinéphile est quelqu'un qui a gardé une partie de son enfance. C'est aussi le générique du Mépris de Godard, une création en équipe, une voix et, pour finir, une caméra qui filme une autre caméra qui dirige son objectif vers le spectateur.
Ce qui est particulièrement touchant dans Casa est le moment où la main du frère semble se substituer à la main du père dont il a parlé. Le cinéma est alors pleinement, par le raccourci qu'il permet un art du temps.
Un film ou une salle, c'est un lieu où l'on est accueilli et qui, ainsi, échappe à la nostalgie. Le film accueille le monde comme le vieux professeur dans Promise land restitue le monde à Matt Damon qui veut faire passer son projet en force. Même intrusion du monde avec l'arrivée de l'équipe de basket qui met fin à la réunion.
14h10 : Sylvain George, cinéaste
 |
 |
|
capitalism slavery (Ken Jacobs, 2006, 3')
|
|
Ken Jacobs travaille en numérique depuis 1999. Il a dépassé la querelle des anciens et des modernes sur l'argentique et le numérique et s'est approprié ce dernier médium. Il procède ici à une manipulation numérique sur une image de l'époque victorienne trouvée, presque décomposée. On découvre à la fin du film que celui-ci a été obtenu à partir de deux photographies sépia : des esclaves noirs d'une plantation surveillés par un contremaître à cheval.
Les effets stroboscopiques permettent de donner du relief à ce qui n'est que sur un plan. Ils permettent une illusion de la profondeur et un contraste entre l'arrière-plan fixe et le premier plan mobile pour, au final, donner un nouvel arrangement spatio-temporel. Les deux photogrammes donnent lieu à un nouvel arrangement des plans dans le temps. Ils redonnent une actualité, une virtualité à la mémoire. On sort de la reproduction pour laisser place à l'imagination.
Voilà ce qui passionne Sylvain George : au monde visible, où rien ne semble possible de faire, substituer un monde dans lequel on aurait prise et ainsi pouvoir de le modifier. "Je veux me déplacer dans le monde et non pas suivre une histoire. Tant que le cinéma permet cela, il m'intéresse" déclare Sylvain George.
Le travail de Ken Jacobs s'encre sur de l'idéologie. Il s'empare
du médium pour parler du monde. Il y a contraste entre le matériau
trouvé, son caractère arbitraire, et cette poétique et
politique de l'image par la création d'un mouvement imperceptible et
pourtant profond qui restitue les images manquantes.
"Qu'est-ce que le cinéma ?", c'est répondre à la question "Comment voyons-nous ?", comment décrire ce qui est vu entre la précision photographique et l'insuffisance de la vision humaine. Le passé n'est jamais vraiment loin et le travail de Jacobs remet en selle les enjeux contemporains les plus cruciaux. Retrouve ce moment du Faust de Murnau ou Faust montre à Gretchen la foule en contrebas. Prendre une photo oubliée pour prendre en charge des questions contemporaines
14h30 : Patrick Leboutte, critique, spécialiste du cinéma
documentaire, essayiste, enseignant de cinéma à l’INSAS
(Bruxelles), directeur de collection aux Editions Montparnasse
 |
 |
|
Et
la vie... (Denis Gheerbrant, 1991) : quand le personnage prend
en charge le recit avec le cinéaste et font qu'ainsi 1+1=3
|
|
Patrick Leboutte promet de faire bref, lui pour qui le record en matière d'intervention courte est de 2h07... Il reprend à Fernand Deligny l'idée que le cinéma c'est le geste de filmer avec une caméra. L'objet film, l'idée du cinéaste metteur en scène de son film, l'intéresse moins que la beauté du geste de filmer. Le cinéma c'est ce geste plus que l'objet final, le film. L'obligation d'avoir un objet final est dû au cinéma commercial. Il n'y a qu'au cinéma que l'acte de filmer dérive du produit fini. Un musicien compose et non musique ; un peintre peint et non tableaute, un sculpteur sculpte et non statufie....
Le cinéma, c'est le moment où quelque chose surgit. C'est ce qui arrive en plus de ce que l'on avait préparé. C'est surtout du moins : moins de lourdeur, moins d'équipe technique, moins de découpage... c'est le regard caméra qui intervient en plus dans Monika, c'est la brune d'Adieu Philippine qui se met soudainement à danser. Elle le fait pour Rozier en dehors de son personnage. Voilà ce qui arrive après deux mois de tournage. Le cinéma c'est la trace de ce qui arrive au cinéaste qui a alors l'art de mettre en forme ce qui arrive, c'est le geste cinématographique.
Apres l'extrait du début de Et la vie... Patrick Leboutte s'interroge : est-ce qu'il y a besoin de faire cinq ans d'IDHEC pour ça ? Pour promener sa caméra à gauche quand survient un passant puis à droite quand arrive une voiture ou même avoir la chance que voiture et passant sortent du cadre en même temps ? Que voit-on ? Qu'en Belgique il ne fait pas beau. C'est le personnage qui va venir au secours du cinéaste. Ce Jean-Luc voit que le cinéaste a besoin de lui. Il va prendre soin du cinéaste. Il y a de l'écoute, il va parler et tout va se déposer. "C'est nous le peuple" dit Jean-Luc "On est dans un sale état". Le cinéaste permet ce nous, il y a de la coprésence. Gheerbrant met en forme de ce qui vient d'arriver. Il contre le capitalisme qui veut nous soustraire du nous car là, ce qui remonte en nous, c'est de l'humain. Avec la coprésence, nous sommes réunis 1+1=3.
Denis Gheerbrant, présent dans la salle est très ému et ne sait quoi ajouter : "Tu m'as coupé l'herbe sous le pied" dit-il à Patrick Leboutte.
14h50 : Claire Simon, cinéaste
 |
 |
|
Les
bruits de Recife (Kleber Mendonça Filho, 2013) : la hélas
nécessaire introduction de la fiction
|
|
Claire Simon est intéressée, comme l'a formulé Robert Kramer, par "faire des films en bas de chez soi". C'est ce que fait aussi Kleber Mendonça Filho dans Les bruits de Recife. Ce n'est pas de l'auto-fiction mais le cinéaste connait bien le lieu où il vit. Il y a à la fois de l'intérêt pour le proche et pour le monde. Il montre les classes sociales ensemble et non pas seulement les pauvres ou seulement les riches.
Même si le film commence par de vieilles photos d'une plantation qui explique la richesse de certains et la pauvreté des autres, tout reste mystérieux dans la géographie de cette rue que le cinéaste arpente à l'horizontale sans soucis de la verticalité de l'histoire.
Le premier extrait est complètement dans la géographie, l'horizontalité des lieux : il montre le déplacement mystérieux du personnage depuis son domicile à la plage avec cet aperçu dans le plan d'un panneau indiquant la présence de requins. Le second extrait montre ce que l'on est obligé de faire : rassembler, faire histoire faire appel à une histoire de vengeance en-dessous des images que l'on voit.
"Qu'est-ce que le cinéma ?" C'est ce qu'il faut accepter de faire pour financer son film : accepter la fragmentation si, à la fin, on rassemble les morceaux. Les financiers exigent que la verticalité de l'histoire ordonne la géographie du film. Tout ce qui n'est pas intéressant par rapport à l'essentiel du film : la perception des uns et des autres de leur voisinage.
15h10 : Jean-Michel Frodon, journaliste, critique, essayiste, enseignant
de cinéma à Sciences Po Paris, ancien directeur des Cahiers
du Cinéma
 |
 |
|
Still
life (Jia Zhang-ke, 2006)
|
|
Un extrait de Still life pour montrer comment le cinéma peut rendre compte de l'accession de la Chine comme bientôt première puissance mondiale tout en analysant aussi l'impact sur sa population locale. Jia Zhang-ke prend en charge cet événement et fait circuler ses personnages entre des paysages et territoires urbains et non urbains.
Cinéaste éminemment moderne mais qui n'abdique aucune des potentialités du cinéma. Au sein d'un quasi documentaire sur les conséquences de la construction du monumental barrage des trois gorges, il fait preuve d'inventions formelles étonnantes. Ainsi ce personnage principal habillé en caleçon comme souvenir-gag du documentaire, Dong, réalisé précédemment. Son partenaire dans la séquence ressemble à ce que peut faire Belmondo chez Godard : imiter Chow Yun-Fat dans son personnage de frère Monk (Le syndicat du crime, John Woo) dont il prend le surnom.
N'abdiquer aucune potentialité du cinéma, c'est aussi, au sein de paysages regardés avec attention, de descriptions très précises des conflits sociaux, introduire une soucoupe volante qui traverse deux plans afin de relier l'histoire du premier des personnages principaux, le mineur venu chercher sa fille, au second, la femem venue divorcer de son mari. C'est garder Méliès et le numérique et, plus tard dans le film, faire décoller un immeuble comme une fusée.
Le ton et un regard sur la Chine sont mélancoliques mais pas nostalgiques. Comme pour le départ de Geneviève du Café des Images : une page se tourne mais le livre s'écrit toujours.
15h30 : Belinda Cannone, romancière, essayiste, enseignante
de littérature comparée à l’Université de
Caen
 |
 |
|
Kaos, contes siciliens (Paolo
et Vittorio Taviani, 1984)
|
|
Belinda Cannone doit son prénom à l'actrice anglaise Belinda Lee (1935-1961) qu'aimaient beaucoup ses parents dont le héros de cinéma préféré était Maciste. Elle a toujours reconnu au cinéma cette capacité à incarner des sentiments complexes notamment sur le visage d'un acteur. Ainsi dans l'extrait de Kaos, ce mélange sur le visage de la jeune fille de résignation, désir, lutte du bien et du mal. Il faudrait des pages pour décrire cette complexité. Lorsqu'elle commence à grimper on ne voit plus qu'elle dans le plan, désir de vivre, se libère de sa mère, libération atteinte au sommet : élan, joie et extase quand elle plonge dans la mer.
Cette capacité de raconter des sentiments complexes dans un temps bref, la littérature savait aussi la produire. C'était la "Meraviglia" (la merveille) des Italiens du XVe siècle: quelque chose qui frappe dans un texte, qui saisit avec peu de mots.
La séquence entière est proche de la "Meraviglia", le sens et l'émotion avec la création de la bulle poétique de Pirandello souvenir de la mère dans le souvenir du fils. Le choix de la musique y participe, l'arietta 'L'ho perduta' dans Les noces de Figaro, la servante qui perd une épingle et se trouve un moment hors du temps.
15h50 : Pause café
16h10 : Jean-Charles Fitoussi, cinéaste et scénariste,
ancien pensionnaire de la Villa Médicis- rétrospective de ses
films à la Cinémathèque française en janvier 2014
 |
 |
|
Cape
et poignard (Fritz Lang, 1946), L'argent
(Robert Bresson, 1983), La
maison des bois (Maurice Pialat, 1972)
|
|
En voyant l'extrait précédent du Kaos des frères Tavernier, Jean-Charles Fitoussi a eut l'impression d'être devant une croûte. Qu'est-ce qu'une croûte en peinture ? C'est facile : c'est l'anti-art, c'est ce que l'on voit place du Tertre. Avec l'extrait des frères Taviani, il a aussi eut cette émotion que l'on peut ressentir devant une croûte... "Mais d'autres seront indifférents ou étanches à ce que j'aime" concède-t-il.
Pour contrer cette Impression de remplissage plus que juxtaposition et chocs des plans Jean-Charles Fitoussi aurait aimé nous montrer un extrait de Tip Top (Serge Bozon, 2013). Mais comme le film n'est pas sorti en DVD, il a choisi de nous montrer ce choc des plans au travers de trois extraits de film : 47 plans de Cape et poignard (Fritz Lang, 1946), 3 plans de L'argent (Robert Bresson, 1983) et, paradoxalement, un seul plan de La maison des bois (Maurice Pialat, 1972).
16h30 : Dominique Païni, critique, théoricien du cinéma,
essayiste, ancien directeur de la Cinémathèque française,
de la fondation Maeght à Saint-Paul de Vence, commissaire d’exposition
 |
 |
|
Juve
contre Fantomas (Louis Feuillade, 1913)
|
|
"Seul le cinéma" est une expression d'Elie Faure. Elle provient d'un chapitre de De la cinéplastique (1922). Pour Langlois auss,i le cinéma était "essentiellement un art plastique" d'où son désintérêt pour la sauvegarde des intertitres des films muets pour lesquels on lui reprochait de ne pas être suffisamment soucieux. Pour Dominique Païni, le cinéma c'est essentiellement le cinéma muet. C'est tout Feuillade et, par exemple, cet extrait du 2e épisode de Fantomas : Juve contre Fantômas (1913) qui commence par la lecture d'une lettre par Fandor. L'imaginaire passe en effet souvent par les lettres dans le cinéma muet où elles sont un relai efficace pour faire avancer l'histoire.
On trouve dans cet extrait un équilibre entre le programme et l'aléa, entre ce qui est pensé et ce qui advient. Il y a lutte entre l'intensité de la fiction, au 1er plan, et l'indifférence de l'arrière-plan, son étonnante agitation. Ce qui pourrait être pesant, appuyé est contrebalancé par une matière aléatoire non voulue par le metteur en scène. Le cinéma y est pleinement art de la profondeur plus qu'un art de la surface. Il y acquiert sa plasticité propre vis-à-vis de la peinture et du théâtre, entre le programmé et l'accident. L'acteur court ainsi pour crever les pneus du taxi qui s'arrête. Mais un livreur est là dans le plan, en face du taxi et non intégré à la fiction. Cette prise de vue du cinéma muet révèle sa capacité d'accueillir toute la réalité dans le plan. Plus tard, ce sera un chien qui traverse l'écran ou le cordonnier qui nous regarde. Période perdue qui ne cherchait pas à faire le vide dans la réalité pour restituer de la vérité. Ainsi souvent le démolissage d'une rue d'un quartier de ville pour un tournage. C'est à une écologie du tournage qu'en appelaient de nouveau Jean-Marie Straub et Daniel Huillet qui ne quittaient jamais un site de tournage sans s'être assuré que rien n'avait été modifié.
Chez Feuillade, les personnages sortent de la bouche obscure de la gare, ombres qui obscurcissent le plan, trou noir de l'image. Et, soudain, cinéma art du devenir, ce carton "Cependant Fandor..." Simultanéité de l'attente en terrasse, poste d'observation du monde ; cueillette, herborisation du bitume, femmes qui passent dans l'obscurité d'un plan, fabrique des ruines du temps, feuilletage de la perception.
Lorsque Ford accepte de garder l'ombre d'un nuage qui passe juste au-dessus de la fosse où Custer et ses hommes sont retranchés dans Le massacre de fort Apache, il garde cette ombre comme une préfiguration de la vague indienne. Ford dernier héritier de Feuillade.
16h50 : Denis Gheerbrant, cinéaste
 |
 |
|
La
vie est immense et pleine de dangers (Denis Gheerbrant , 2003)
|
|
Le cinéma c'est un homme qui filme un autre homme avec une caméra au milieu. Ainsi est conçu La vie est immense et pleine de dangers où Denis Gheerbrant a suivi pendant un mois la maladie de Cédric, condamné à rester enferme dans une chambre stérile de 9m2. "Parler avec lui, c'était comme la leçon de tricot que m'enseignait ma grand-mère".
La franchise, parler d'égal à égal avec l'enfant, apprendre auprès de lui sont essentiels. Si le documentaire est là pour apprendre quelque chose ce pourrait être la tension entre la fiction imaginée et la fiction du personnage filmé.
Le film est soutenu par Les enfants de cinéma, l'association qui met en œuvre le dispositif École et cinéma qui permet aux enfants et aux enseignants de l'école élémentaire et préélémentaire d'aborder ou d'approfondir un travail sur le cinéma. C'est un film qui peut aider à vivre mais qui pourtant se heurte aux réticences de certains devant le sujet du film.
17h10 : Nicolas Philibert, cinéaste
 |
Nicolas Philibert rend hommage à Marcel Hanoun pour qui filmer des hommes et des femmes dans un documentaire c'est "montrer ce qu'ils ne sont pas encore" et à Van der Koken pour qui la dimension du non-savoir est essentielle, ce savoir qui est la peste du cinéma documentaire. Lors de ses études, Nicolas Philibert s'est intéressé à la sémiologie de Christian Metz mais est arrivé à la conviction que, pour faire des films, mieux vaut ne pas trop en savoir. Bresson disait que lors du tournage il fallait se mettre dans un état d'ignorance. Pour Le pays des sourds (1992), il a appris des rudiments du langage des signes mais n'a pas rencontré des spécialistes de la psychologie afin de préserver sa curiosité, de garder de l'appétit pour le tournage.
Il s'agit moins de trouver un sujet que de s'aventurer de garder un point d'invisibilité en parallèle à son propre travail. Contrairement à ce que l'on a dit pour ses tournages dans la clinique de La Borde dans La moindre des choses (1996) ou dans Etre et avoir (2002), il n'a pas eu besoin de trois mois d'immersion avant de tourner. Cela a commencé des le premier jour. Les enfants ont été intrigués par la caméra mais, au bout de deux heures, ils l'ont oublié et se sont mis au travail. Pas se faire oublier, pas de période préalable, pas de fiches inutiles. Comme le dit Marc Chevrie : "Au cinéma, la beauté ne se convoque pas sur rendez-vous". Philibert se contente de dire "Faites comme si j'étais là, mais pas de regards caméras complaisants".
Le lieu n'est qu'un prétexte. Philibert ne réalise pas un film "sur", avec un sujet, mais un film "grâce à", où l'on observe la comédie humaine. Philibert ne cherche pas le conflit, espère un fil politique qui pourra se dégager de visages, de voix d'une écoute. Faire preuve d'intelligence comme le fait Wiseman avec Art Barkley.
17h30 : Echange avec la salle
Ressent le cinéma comme une dialectique faire sans dogmatisme à l'intérieur d'un seul plan ou avec 47 plans dialoguer des plans et des choses entre elle dans la fiction ou le documentaire. Le cinéma se rapproche de la psychanalyse.
9h40 : accueil café
10h00 : Introduction par Carole Desbarats
10h20 : Ginette Dislaire, fondatrice de l’Association Les Enfants
de Cinéma, du festival Du Grain à démoudre au Havre,
productrice et ancienne directrice de la salle nationale du Havre.
 |
 |
|
La
nuit du chasseur (Charles Laughton, 1955) : descente de la rivière
|
|
Initier les enfants aussi aux choses obscures, aux choses trop grandes pour eux. Chaplin peut être applaudi sans médiation mais souvent il faut un adulte pour accompagner un film. C'est le cas pour les magnifiques La vie est immense et pleine de dangers, Le petit prince a dit (Christine Pascal) où La nuit du chasseur. il faut canaliser les émotions du film qui relèvent de l'intime, de l'inconnu, de ce qui résiste.
Pour "réfléchir à ce à quoi on n'est pas sûr de trouver une réponse", Ginette Dislaire, emportée par le mouvement initié par Raoul Ruiz, est parvenue à montrer plus de 2000 films avec des stages de trois jours avec Godard et Wiseman avec Carole Desbarats, Charles Tesson, Alain Bergala et Jean Douchet et d'autres passeurs encore. Alors "qu'est-ce que le cinéma ?" : ça se fabrique dans une réflexion, ensemble.
10h40 : Alain Guiraudie, cinéaste
 |
 |
|
Happiness (Todd Solondz, 1998)
|
|
"J'ai longtemps adhéré à la doxa qu'il faut aimer ses personnages", déclare Guiraudie. Mais avec Solondz, il s'est aperçu que l'on pouvait dire quelque chose en étant très cruel avec ses personnages. Le propos du film est assez diffus : un Œdipe tordu par l'intermédiaire du chien, une vision très singulière de la famille.
Brassage entre l'idéal et ce qu'on a, entre le rêve et le quotidien. Le réel l'emporte toujours à la fin. Je suis dans cet aller et retour, dans ce brassage. Bresson déclarait que le film est tué une première fois sur le papier, revit au tournage, est tué sur la pellicule et revit au montage. C'est d'autant plus probable que chaque étape se vit differemment. L'écriture se vit en solitaire, le tournage est communautaire et le montage conjugal, en couple tout du moins.
Il aime aller voir du côté des grandes histoires qui parlent à tout le monde. Jean Vilar déclarait qu'il faut donner aux gens ce dont ils ne savent pas encore qu'ils ont envie. Cet impératif s'applique à tous les arts sauf, qu'au cinéma la projection en salle permet la communion du public. Ce vivre ensemble s'éprouve pour les films comiques mais aussi pour le thriller où l'on sent l'émotion partagée.
A la question "Est-ce que quelque chose peut davantage surgir si l'on est dans un territoire donné ?" Guiraudie répond qu'on est toujours imprégné de ce que l'on connait mais que partir au Larzac, s'était aussi partir explorer un territoire inconnu associé à des légendes, ici à des luttes. L'inconnu du lac, contrairement à d'autres de ses films, a été tourné ailleurs.
Ce qu'il aime dans Hapinness c'est le glamour perverti de l'intérieur par le jeu sur le vrai et le faux dans la direction d'acteur.
11h00 : Jacques Doillon, cinéaste
 |
 |
|
Faces
(John Cassavetes, 1968)
|
|
Jacques Doillon présente un extrait de Faces.
Le cinéma, c'est filmer les gens qu'on aime; faire le meilleur portrait
possible de la personne qu'on aime. Doillon souhaite réussir à
travailler avec eux. Il a envie de travailler avec eux, envie de tourner avec
eux... encore un peu. Et il soupçonne que même Alain Cavalier
peut en avoir envie. Le problème c'est que les acteurs veulent beaucoup
d'argent. Et lorsque le réalisateur est payé dix fois moins,
il n'est pas toujours en capacité de les faire travailler. Les producteurs
veulent des acteurs dans le Top10 et c'est devenu très compliqué
de faire des films en dehors du divertissement.
"Qu'est-ce que le cinéma ?" Jacques Doillon répond par "C'est surtout quand on n'en fait pas". Sur toute sa carrière, Jacques Doillon estime son temps total de tournage à quatre ans. "C'est moins qu'un peintre du dimanche ! Quand je ne tourne pas, c'est donc bien plus de quatre ans et ce ne sont que des rêves et des cauchemars. Presque toutes les nuits, je suis en train de tourner. Ces cauchemars se termineront avec ma vie."
De l'argent, il y en a plein mais pas pour faire ses films. Invité au Japon, il a vu un jeune cinéaste se plaindre qu'avec 12 millions de dollars, il n'arriverait pas à faire son film. "Mes budgets, c'est un million d'euros en moyenne, avec deux ou trois plus cher et une dizaine très en dessous. Pour le dernier, Mes séances de lutte, il n'avait que 800 000 euros. Il a ainsi tourné chez lui pendant quatre semaines avec beaucoup de répétions avant. Il a aussi dû, faute de temps, se passer bien évidemment de deux heures pour éclairer un plan.
"Je pensais présenter mon film dans 15 villes mais 3 villes seulement m'ont invité". Doillon ne pense pas au spectateur en faisant le film. Il est comme un mécanicien qui travaille et qui veut que cela fonctionne.
11h20 : Jean Douchet, cinéaste, historien, écrivain,
critique, essayiste, cinéaste, conférencier à la FEMIS
et à la Cinémathèque Française.
 |
 |
|
Règlement
de comptes (Fritz Lang, 1953)
|
|
Jean Douchet, monument de la critique et grand passeur de cinéma rencontre beaucoup de cinéastes qui sollicitent son avis. "Je donne un avis mais je fais en sorte qu'on ne m'écoute pas" ironise-t-il, des remarques en "peut-être que.. ", ça suffit."
Qu'est-ce que le cinéma ? C'est pour Jean Douchet chercher à représenter, à saisir "qu'est-ce que c'est que la vie en train de vivre". La vie est là mais jamais elle ne se donne. Avant 1895 et la naissance du cinéma, jamais la vie n'avait été prise en direct. Le cinématograph,e c'est cette mécanique capable de saisir la vie : c'est un drap sur lequel se promène la vie, même si ce n'est que l'illusion de la vie. Et il y a de multiples façons de regarder la vie en train de vivre et Jean Douchet se propose de nous montrer celle classique d'entre les classiques : le début de Règlement de comptes. En Allemagne, Fritz Lang est immensément respecté, c'est l'homme que le führer aurait aimé nommer à la tête de son cinéma. Lorsqu'il émigre aux Etats-Unis, il est sous la coupe des producteurs et doit se montrer humble. Mais comme il est très fier, il décide de se montrer le plus humble des humbles et c'est sous une apparente neutralité qu'il cache la virtuosité de sa mise en scène.
Carole Desbarats et la salle vont alors demander à Jean Douchet de commenter en direct son extrait. Comme il a su si bien nous faire participer à la fabrication de la création des six plans du procès de Furie ou au début de M. le maudit, Jean Douchet accepte de se lancer dans le commentaire en direct de tout ce que l'on peut voir de la volonté d'un cinéaste dans une séquence de cinéma :
Le 1er plan est celui d'un revolver. Le public attend un film policier et Lang lui propose l'objet parfait du genre : un revolver, mais posé sur un sous-main qui indique que l'on n'est pas dans n'importe quel milieu. Dans le second plan, la main entre dans le champ et se saisit du revolver. Lang exécute la volonté du spectateur de voir l'arme entrer en action et c'est comme s'il lui faisait saisir l'arme pour enclencher le drame qui s'effectue off. Le spectateur entend le coup de feu avant de voir le corps s'écrouler, il distingue alors clairement l'insigne du policier et la lettre posée devant lui.
Classiquement, après le coup de feu, une femme alertée descend les escaliers. Elle se fige pourtant et reste immobile avec l'horloge verticale à l'arrière plan. Le public reconnait alors peut-être l'actrice tragique qui jouait lady Macbeth dans le Macbeth de Welles. Lang joue sciemment de cette dureté puisqu'il donne au personnage le nom de madame Duncan. Alors qu'elle se fige, Lang a déjà cadré le mort. Et, en faisant alors entrer l'actrice dans le champ lors du plan suivant, suggère que c'est elle qui, loin d'être entrainée par le tragique de la situation, va mener le jeu. Son entrée dans le champ masque la lumière et le contre-jour alors généré laisse supposer une action obscure. Elle se saisit de la lettre et prend soin de fermer le rideau avant de téléphoner. On est en 1953 et il est loisible d'y voir une allusion aux dénonciations du maccarthysme tout comme l'appel à l'homme de main du gangster, alors en robe de chambre avant de se diriger vers la chambre de son patron, peut laisser planer un doute sur une homosexualité latente.
Jean Douchet allait alors amorcer son analyse de la seconde séquence lorsqu'il constate, désolé comme nous, qu'il ne peut déborder davantage sur son temps de parole.
11h40 : Carole Desbarats, agrégée de lettres, essayiste, enseignante de cinéma, ancienne directrice des Etudes à la FEMIS, actuelle directrice de la communication à l’Ecole Normale Supérieure
 |
 |
|
Le parrain
III (Francis Ford Coppola, 1990) : Fin du film, le cri muet et le
long hurlement de douleur
|
|
Le cinéma a partie liée avec le mal et nous aide aussi à affronter le mal. Le nuage qui survole la fosse de Custer dans Fort Apache, l'interrogation de Fritz Lang sur la place à accorder dans le film à la jouissance des bourreaux sont les objets même du cinéma. Le mélodrame nous offre le plaisir paradoxal de voir des personnages accablés par un destin qui va les clouer. C'est un fait objectif, le malheur des autres peut nous aider. Et, à ceux que ne concerne pas la tragédie grecque et son fatum, reste le mélodrame, la tragédie pour ceux qui ont le loyer à payer selon un mot célèbre. Summum de la douleur le cri muet d'Al Pacino à la fin Parrain III (Francis Ford Coppola, 1990)
11h55 : Marc Voinchet, journaliste, producteur et animateur de l’émission
Les Matins à France-Culture
 |
 |
|
24hoursofhappiness
(We Are From LA, 2013)
|
|
Le cinéma a partie liée avec la joie. La salle de cinéma est ce lieu où on se réunit pour faire communauté. Partager la joie d'être dans une salle obscure pour nous dire quelque chose. Souvenir de ce qu'il nous a donné : sauter à pied joint dans une flaque comme dans Chantons sous la pluie, fredonner quand on voit un cireur de chaussure danser comme dans Tous en scène.
Faire ce que l'on veut, se réapproprier, répéter quelque chose qui existe. 24 heures une caméra dans la rue filmer la durée d'une chanson et on ne s'arrête plus, dans une ville et prendre le risque du flou, du contre-jour, de la fatigue et ne jamais couper. Morceau choisi, play-back du duo Fred Astaire et Gene Kelly qui se disputent sur un banc, vieillissement et essoufflement.
24hoursofhappiness est un clip interactif de 24 heures réalisé pour Pharrell Williams pour le titre Happy, extrait de la bande originale de Moi, moche et méchant 2. Durant 24 heures se succèdent 360 plans-séquences. Clément Durou et Pierre Dupaquier, qui forment le duo We Are From L.A., ont filmé Pharrell 24 fois quatre minutes, et les 336 autres personnes apparaissent chacune dans une séquence. Les internautes peuvent ainsi se déplacer sur une timeline de 24 heures, pour découvrir tous ces artistes dansant sur le même morceau. Et ce sans aucune interruption dans la musique ou de l'image qui relie chaque clip par un plan permettant une jointure invisible
Marc Voinchet souhaite une bonne rublascore à Geneviève Troussier.
12h20 : Echange avec la salle
14h40 : Alain Bergala, critique, essayiste, réalisateur, enseignant
de cinéma à la FEMIS, commissaire d’expositions
 |
 |
|
La
comédie de Dieu (João César Monteiro, 1995)
|
|
Alain Bergala se souvient de deux venues mémorables au Café des images. L'une lorsqu'il était venu avec Jonas Mekas, alors inconnu en France, et où ils étaient presque plus nombreux devant l'écran que sur les sièges. L'autre fois, il était venu avec Dominique Païni, Godard et Anne-Marie Mieville dans une salle comble pour For ever Mozart (1996). Dans le train, Godard avait lu un article du Monde sur Nos funérailles et Bergala lui avait vanté Ferrara comme une sorte de Rossellini contemporain. Godard était allé voir le Ferrara dans une autre salle du café des Images pendant que l'on projetait son film. Juste avant le débat, il était ressorti en disant sa déception à Bergala : Ferrara c'est pas du Rossellini
Le cinéma, pour Bergala, c'est ce qui l'a sauvé socialement et culturellement. C'est l'utopie qui lui a permis de sortir de là où il est né en lui donnant une croyance efficace dans le réel. Bergala n'a pas eu d'initiateur mais s'est construit une utopie dans ce monde contre ce qu'il comporte de triste et de désespérant.
Dans La comédie de Dieu, où Jean Douchet joue un personnage qui s'appelle Jean-Pierre Léaud, on a aussi la construction d'une petite utopie qui réussit à résister au monde. Jean de Dieu prend toute la dureté du monde sur lui qu'il compense en organisant de petits rituels personnels. Il y a dans l'extrait de La comédie de Dieu presque tout ce qui l'intéresse au cinéma
Ainsi le rapport du créateur à sa créature. On le trouve dans Les enchaînés (Hitchcock, 1946), Partie de campagne (Renoir, 1936), Je vous salue Marie (Godard, 1985) ou dans tous les films avec Ingrid Bergman chez Rossellini. Il a là comme un rapt d'actrice où la place du créateur vis à vis d'elle dépasse celui qu'il a avec le personnage.
Il y a aussi le contraste entre ce qui relève du dispositif et les éléments variables qui peuvent y prendre place. Il faut un dispositif, un piège, rigoureux sans quoi on n'attrape rien, ainsi la rigueur du cadre, mais il y a aussi beaucoup d'aléas dans ce qui est filmé : ainsi ce jeu d'enfant, des billes qui roulent sur un miroir.
Autant que ce cinéma de l'enfance, Bergala aime cet art pauvre, réalisé avec une petite équipe. Monteiro avait pour une fois de l'argent qui lui permettait de tourner en cinémascope. Au bout d'une semaine, il décide d'arrêter et de revenir à ses conditions habituelles de tournage. Bergala aime aussi cette captation de quelque chose de passager : ce moment, ces six mois, où le corps va changer. La jeune fille n'est pas spécialement belle, pas plus belle que l'état de la nature.
Le flou, seule une mèche est nette, c'est ce qui touche, pas le point sur le visage, émotion qui nait du flou, le petit détail qui grippe la mécanique. Renoir disait que rien n'est plus ennuyeux que la perfection.
Bergala a horreur de l'arrogance des gens qui parlent du cinéma. Le cinéma de Monteiro est un cinéma minoritaire, qui parle doucement, qui chuchote, qui donne du plaisir sans le proclamer.
15h00 : Patricia Mazuy, cinéaste
 |
 |
|
Les
hommes préfèrent les blondes (Howard Hawks, 1953)
|
|
Patricia Mazuy aurait voulu présenter un western ou un film noir mais elle a eu peur de Jean Douchet et Alain Bergala pour parler devant eux de Hawks et Ford. Pour parler du travail de Geneviève, Patricia Mazuy a pensé au thème de Cinéma et de l'argent, tant elle sait que le métier d'exploitant consiste à aller chercher de l'argent pour boucler le budget d'une salle de cinéma.
Geneviève va à la plage, lui aurait presque semblé convenir pour illustrer ce qui n'est parfois qu'une pauvre mascarade pour avoir de l'argent. Dominique Sanda en brune à fourrure dans Une chambre en ville aurait aussi pu convenir, Eliot Gould dans Le privé aussi. Mais elle s'est finalement rabattue sur Les hommes préfèrent les blondes tant elle a souvent remarqué que Geneviève, sans en avoir l'air, cherchait à se donner des airs de Marylin Monroe.
15h20 : Agnès Devictor, essayiste et enseignante de cinéma
à Paris 1, chercheure associée à l’Institut Français
de Recherches en Iran (IFRI)
 |
 |
|
Devoirs
du soir (Abbas Kiarostami , 1989)
|
|
Agnès Devictor découvre Devoirs du soir, cette commande en 1988 de l'état Iranien sur le système éducatif alors qu'elle est jeune chercheuse. Elle est abasourdie que l'état ait autorisé et financé cela neuf mois après la révolution en Iran : on y montre que les enfants ont trop de devoirs, que leurs parents sont très sévères et par ailleurs souvent illettrés et il n'est pas caché l'existence de la polygamie.
Kiarostami filme avec deux caméras et alterne, dans une salle de classe, les plans des élèves interrogés sur leur pratique des devoirs et des plans sur le réalisateur en posture d'interrogateur. Il filme aussi la cour de récréation : comment le rituel du deuil, ce geste vers le cœur qui commémore le deuil du crime qui aboutira à la séparation des sunnites et des chiites, est re-instrumentalisé. Cette culture du deuil transformée en exaltation du sacrifice en temps de guerre, les enfants semblent l'appliquer mécaniquement et sans conviction.
C'est ce film qui décide de la carrière d'Agnès de Victor qui partit alors en Iran étudier dans quelles conditions Kiarostami avait pu donner aux spectateurs une place de citoyen alors que la censure régnait partout.
15h40 : David Vasse, critique, essayiste, enseignant de cinéma
à l’université de Caen.
 |
 |
|
Nouvelle
vague (Jean-Luc Godard, 1990)
|
|
Où mieux poser la question "Qu'est-ce que le cinéma ?" que dans un lieu qui lui est consacré. D'un autre coté, on risque de tourner en rond. C'est pourquoi David Vasse se propose plutôt de tenter de donner une réponse à " Où y-a-t-il du cinéma ?". Voir ce qui se passe, comprendre, prendre avec, cela n'est tout apprendre ou tout savoir. Tout ce qui est su est perdu pour le désir.
Un film de cinéma, c'est quelque chose qui m'arrive. C'est pouvoir dire "Un film existe, je l'ai rencontré". C'est, au début de Nouvelle vague, le plan d'approche de la voiture avec les appels de phares avant la rencontre fatidique. Cette rencontre rappelle la parole de Serge Daney en 1988 à propos de Witness et Drôle d'endroit pour une rencontre : " Un film de cinéma doit ressembler à un drôle d'endroit pour une rencontre" (Devant la recrudescence des vols de sacs à main). Et là, après l'accident, l'homme et la femme vont faire connaissance auprès de l'arbre de la connaissance. C'est un petit miracle et, pour David Vasse, une vraie rencontre avec un film, juste après le choc revient vers l'inconnu et lui prend la main. C'est comme La cathédrale de Rodin qui s'anime.
Les réponses apportées avec modestie à la question "Pour vous, qu'est-ce que le cinéma?" n'ont probablement pas couvert l'ensemble du territoire du cinéma. Mais c'est sans doute heureux car ce sont par ces trous que les questions pourront encore se poser et le débat se prolonger. Néanmoins la palette proposée par les intervenants fut assez large. Un seul film, La nuit du chasseur, a été pris pour exemple deux fois. Géographiquement, il y a certes eu une majorité de films américains et français mais aussi du Brésil (Les bruits de Recife) ou de l'Iran (Les devoirs du soir). La période de temps couverte fut aussi très étendue, depuis le Fantômas de Feuillade en 1913 jusqu'à Happy en 2014. Il y eut aussi une majorité de fictions mais aussi beaucoup de documentaires.
Les thèmes majeurs furent celui de la rencontre, de l'enfance et du lieu, sans doute par l'importance donnée dans ce colloque au documentaire. Il fut aussi question d'argent, même si c'est souvent celui empêche de filmer. La politique, signe des temps, fut peu présente ce qui ne fut pas le cas du thème de la communauté, envisagé dans son rapport avec la salle (1+1=3). L'angle d'approche fut parfois celui de la maîtrise (Le parrain de Coppola) mais plus souvent celui de l'acceptation de l'aléatoire et souvent encore celui de la modestie : Païni et son cinéma comme une fabrique des ruines du temps; Patricia Mazuy exaltant la simplicité de Hawks; Denis Gheerbrant concevant dans Et la vie son dialogue avec l'enfant comme une leçon de tricot. Le réel, c'est ce qui m'arrive, le réel peut faire effraction.
Textes complets des interventions
Jean-Luc Lacuve (texte initial, mais coupé car trop long pour 10 minutes !!)
Qu'est-ce que le cinéma, pour vous ? Un fabuleux champ de signes,
toujours à organiser et réorganiser pour mieux aimer les films.
Par rapport aux autres arts, le cinéma est celui qui offre le plus
facilement des signes. La littérature en procure mais de façon
plus parcimonieuse (on est immergé dans une histoire et un style mais
moins souvent réveillé par un signe). La peinture aussi est
plus parcimonieuse : elle ne propose qu'une scène au regard. La musique
offre beaucoup de signes mais ils sont moins partageables (en parler nécessite
une technique que je n'ai pas). Et le théâtre et le l'opéra
sont quand même moins facilement accessibles que le cinéma.
Le signe, c'est, pour moi, quelque chose qui se révèle brusquement et qui me procure même une sensation toute particulière, celle du frisson dans le dos, qui surgit soudainement à la vision d'un plan de cinéma. Ces signes sont de trois natures ou du moins surgissent souvent de façons différentes selon que l'on voie le film une fois, deux fois ou trois fois ou peut-être, comme le suggérait Truffaut, qu'il s'agisse d'une vision paire ou impaire. C'est pourquoi, je me propose de prendre appui sur Lettre d'une inconnue, le film de Max Ophuls de 1948 qui a donné lieu à un débat ici en février dans le cadre des séances de ciné-club et que j'ai revu deux fois supplémentaires pour cette occasion. L'histoire est tirée de la nouvelle du même nom de Stefan Zweig : Un pianiste célèbre et vieillissant, Stefan Brand, reçoit un soir une lettre adressée par une inconnue. Celle-ci lui révèle qu'elle lui voua, dès son adolescence, un amour exclusif, sans qu'il ne s'en aperçût jamais.
1-Le signe musical
Le premier des trois types de signes que je repère dans un film est
le signe que j'appelle, faute de mieux sans doute "musical". Musical,
car il fait résonner une image avec une autre, vue précédemment.
On éprouve le frisson musical dès la première vision
du film. C'est un peu comme la grâce qui frappe le spectateur et, comme
la grâce, elle frappe d'abord une fois pour rien avant de se manifester
pour de bon en rappelant la première séquence qui nous avait
intriguée mais sans vraiment nous émouvoir. Le frisson, la grâce,
frappe par surprise (dans le dos, disait Alain Bergala lors de sa conférence
sur le sacré au cinéma ici même en 1999 et auquel j'emprunte
le rapprochement "grâce qui tombe" sur le personnage et "frisson"
que le spectateur éprouve).
Les scènes de gare du film ne sont pas chez Zweig. On en voit déjà trois avant la fameuse scène du départ de Stefan. C'est ensuite la quatrième qui intrigue, qui intrigue sans bouleverser encore. Lisa à 18 ans. Stefan qui est désormais son amant promet de revenir dans quinze jours après sa tournée de concerts. Il court et répète deux fois "two weeks", "two weeks". "Two weeks, conclut Lisa, comme vous vous connaissez mal" avant de repartir seule, sachant qu'elle va être abandonnée. Le frisson surgit lors de l'ultime scène de gare. Dix ans plus tard, Lisa envoie son fils à la montagne pour être libre de revoir son père. Elle ne sait pas que le train est contaminé par le typhus comme un contrôleur en a averti le spectateur. Son fils la rassure : "quinze jours, la séparation ne sera pas trop longue" et, quand le train s'ébranle, l'enfant lance à sa mère les deux mêmes mots "two weeks", deux fois. Même position le long du quai de Lisa, même habit, si ce n'est que, cette fois, la musique est dramatique et que la fumée du train envahit l'écran. Le frisson marche à tous les coups.
Les effets de rimes, l'occasion d'éprouver le frison musical, sont nombreux dans Lettre d'une inconnue : Le film commence par une calèche emmenant Stefan chez lui et se clôt par une calèche emportant Stefan vers le duel. La première vision de Stefan par Lisa se fait derrière une vitre et c'est dans cette position qu'il la revoit mentalement avant de partir au duel. Le soir de la fugue à douze ans, Lisa le voit ramener une conquête d'un soir dans un plan en plongée suivi d'un mouvement de grue le long de l'escalier. Plongée et mouvement de grue qui seront repris lorsqu'elle se donnera à Stefan. Le frisson musical, ou de résonnance, c'est donc la répétition d'une séquence dont l'intensité maximum est aussi parfois soulignée par la musique ou des paroles. C'est l'image modifiée dont Carole Desbarats nous avait parlé dans les séminaires du dimanche à propos du plan de John Wayne dans l'embrasure de la porte dans La prisonnière du désert.
2- Le signe esthétique
Mais il existe un deuxième type de signe (de frisson) : le signe esthétique,
celui que le cinéphile éprouve je crois en reconnaissant ce
qui fait la marque de fabrique d'un cinéaste et auquel il est sensible
à la deuxième vision de l'histoire. Comme Truffaut en parlait
déjà, je vais toujours voir un bon film deux fois : la première
fois où je suis prisonnier de l'histoire et une seconde fois pour regarder
comment il est fait.
J'avais ainsi lu, avant de revoir le film, dans l'analyse de Lettre d'une inconnue de Jacques Lourcelles le passage suivant : "La caméra ophulsienne se promène dans les couloirs des maisons, remonte les escaliers, longe les quais des gares, passe d'un personnage à l'autre avec autant de virtuosité que de naturel. C'est le triomphe de ce baroque fluide, qui capte et communique au public les émotions les plus intimes des personnages, à partir de leur évolutions et de leurs déplacements dans l'espace"
Rien d'étonnant alors d'être ému par le premier plan
séquence lors du premier flash-back. Il démarre sur la base
de la harpe que le déménageur sort du camion alors que Lisa,
qui la voyait jusqu'alors depuis la fenêtre, va le rejoindre à
sa sortie pour examiner toutes les belles choses qui vont entourer Stefan.
Autre plan-séquence émouvant, celui où Lisa, en blanc,
perdue dans ses rêves de Vienne, est dérangée par son
prétendant de Linz avec une charrette burlesque, des murs sales et
les parents lourdauds qui obstruent à un moment le premier plan.
3- Le signe théorique
Enfin il y a le frisson théorique, c'est celui qui relie frisson musical
et frisson esthétique, celui qui saisit quand on croit, à tort
ou à raison, avoir compris la structure globale du film, le noyau créateur
de l'œuvre, cher à Jean Douchet.
On peut alors organiser les signes pour être ému, exalté par le film tout entier. On s'est déjà détaché du personnage avec le frisson esthétique mais là il faut, je crois, basculer complétement dans la peau du réalisateur (virtuellement heureusement) et tenter de voir le film de son point de vue (conscient ou inconscient). C'est ce que tente l'historien du cinéma et critique américain, Tag Gallagher, dans le bonus du DVD Carlotta. Il fait d'Ophuls avec ce film un précurseur du féminisme :
" Lettre d'une inconnue est un film dans le film, où Lisa mène le jeu de bout en bout. Elle retrace sa vie dans un spectacle qu'elle écrit, met en scène et interprète tout à la fois. Nous ne la voyons jamais au travers du regard d'autrui. Nous voyons le passé qu'elle se remémore en écrivant. Au lieu de voir son attente nuit après nuit pendant un an à l'âge de 18 ans, qui passerait pour pure folie, on ne voit que le soir de sa rencontre qui légitime son action. Lisa se présente comme tombée du ciel : Stefan est dans la pénombre, elle est lumineuse. Elle s'observe rentrant avec Stefan comme elle observait Stefan rentrer chez lui. Nous la voyons comme elle se voit ; comme une sainte romantique dont la passion perdure avec le temps (...) Elle sait que son mari tuera Stefan et elle nous montre qu'il voit qu'elle rentre chez Stefan. L'amour passion en détruit l'objet, conclut-il. Quand elle est morte, Stefan peut devenir le sujet et répondre. Ces deux-là partagent une maladie commune : le désespoir.'
En écoutant cette analyse très fine qui met de très nombreux moments en valeur, j'ai néanmoins été gêné par la conclusion de réunir Lisa et Stefan dans le seul désespoir. Que tout soit vu du point de vue de Lisa est exagéré. Et c'est bien plus vrai dans la nouvelle ; pas de quoi alors en faire le fil conducteur de la mise en scène. Cette interprétation ne donne, en plus, pas assez d'importance à Stefan. Ophuls a notablement étoffé son rôle : sans nom et prénom dans la nouvelle, Ophuls lui a donné celui du romancier. Il en a fait un dandy décadent qui a besoin de Lisa et non un écrivain à succès qui ne se souviendra de l'inconnue que comme d'une musique lointaine sans en être outre mesure affecté : le drame dans la nouvelle n'est vécu que Lisa.
Pour que, pour moi, résonne le frisson théorique j'ai dû relire Gilles Deleuze. Pour lui, les films d'Ophuls sont des cristaux parfaits. Cette théorie est évidemment assez compliquée et je ne citerai que le passage qui m'a permis de me mettre sur la piste du signe théorique générateur du frisson ressenti lors de l'extrait que je vous présenterai juste après. "Les facettes du cristal sont des miroirs qui réfléchissent l'image actuelle, le présent du personnage, dans un prisme, où l'image dédoublée de ses différentes époques ne cesse de courir après soi pour se rejoindre. Dans le cristal ou sur la piste, les personnages emprisonnés ne peuvent guère que tourner sans fin : ainsi la ronde des épisodes mais aussi des couleurs sur la piste de cirque de Lola Montes, les valses mais aussi les boucles d'oreille de Madame de ou le manège de La ronde'.
Extrait : 4e retour au présent, Stefan vient de terminer la lettre. Vous voudrez bien être attentifs aux bords du cadre d'abord et voir ensuite si une figure se répète. (2'43")
La ronde des souvenirs que les rimes avaient préparée est matérialisée dans ce rond de fumée qui entoure les souvenirs de Stefan. Et Stefan participe lui aussi au spectacle voulu par Lisa en acceptant son destin matérialisé par la roue du carrosse qui s'arrête, la roue du destin qui se fige. Ce qui génère pour moi le frisson c'est d'une part de voir que le rond de fumée n'est pas dû à Stefan qui fumerait mais à une invention formelle d'Ophuls qui lie les images mentales dans une ronde et surtout qu'il répète la figure de la ronde par celle de la roue du carrosse ; liant ainsi Lisa et Stefan dans le fameux cristal dont ils ne peuvent ni ne veulent s'échapper. L'amour de Lisa peut être jugé comme désespéré, tout comme la déchéance de Stefan mais Ophuls magnifie leur parcours dans un destin tragique et magnifique qu'il nous présente comme un spectacle, un cristal dont il n'y pas moyen de s'échapper.
On peut alors redonner de l'importance aux travellings d'Ophuls qui n'ont jamais une fonction libératrice mais tournent dans des lieux clos ou bornés et être sensible aux signes du spectacle qu'Ophuls propose avec les multiples rideaux du film : le tapis qui s'effondre au début dégageant l'espace de la cour, le rideau qui s'ouvre dans le salon privé du restaurant où Lisa a son premier rendez-vous avec Stefan ou celui qui s'ouvre encore quand Lisa est chez la modiste le jour du départ de Stefan. Enfin et surtout on peut réintroduire la merveilleuse scène du Prater avec ses toiles peintes qu'actionne le vieux mécanicien, image possible d'Ophuls.
Le cinéma c'est pour moi revoir plusieurs fois un film que j'aime afin d'en organiser les signes. Je remercie ainsi tous les membres du ciné-club de Caen, et Geneviève au premier chef qui soutient cette expérience depuis sept ans. Une fois par mois à une trentaine ou dans une salle pleine (surtout la petite !) nous traquons signes de mise en scène et sens possibles du film. La discussion me permet à chaque fois de réécrire complétement ma critique initiale.... des signes à réorganiser toujours, tel est pour moi le cinéma.
Olivier Baudry architecte du Café des Images
Le bâtiment du café des images construit par Bias dans les années 1970 a pour lui l'atout de la sobriété mais manquait de visibilité, handicap majeur pour un bâtiment qui doit drainer le public.
Olivier Baudry s'inspire d'un de ses travaux antérieurs, le concours de l'Opéra Bastille pour lequel il a été primé. Le cahier des charges imposait une référence au rideau de Parade dessiné par Picasso. Olivier Baudry avait décidé d'inscrire sur les façades du bâtiment les figures simplifiées du dessin de Picasso. Ce qui était alors lisible c'était ainsi d'appeler, dès l'extérieur, à venir vérifier l'expression, les émotions et même les textures de l'opéra.
Le choix de l'étoile pour le Café des images répond au même impératif de procurer une icône qui pourra servir de support de communication. L'architecture extérieure fait écho à ce qui se passe à l'intérieur, lieu où sont vénérées les stars sur l'écran. L'écran au milieu de l'étoile sur la façade extérieure suggère que l'Etoile sort de l'écran, va de l'intérieur de la salle pour conquérir le public à l'extérieur.
Sur la façade côté rue, l'étoile est matérialisée par un néon bleu et le grand rectangle de l'écran qui est inclus laisse la place à six rectangles verticaux, supports des affiches du cinéma. C'est peut-être la dimension sacrée de l'art qui est mise en évidence, l'étoile pouvant aussi figurer la couronne d'épines et le six affiches être un équivalent aux six ailes des séraphins.
L'architecture intérieure est aussi fondamentale et Olivier Baudry
pense à l'immersion du spectateur dans le spectacle qu'il suggère
par les tissus à fleurs qui envahit fauteuils et murs de la salle comme
un nid autour du spectateur.
Olivier Baudry prolongera ces expériences notamment au studio 43 de
Dunkerque, à la cinémathèque française et au Ciné
Manivel, cinéma associatif de cinq salles à Redon.
Pour la 3e salle du café des images, la contrainte était l'impossibilité de construire à côté du bâtiment existant, faute de place. L'unique solution était de surélever le bâtiment. La coupole évoque le globe oculaire avec le choix de mettre l'axe principal parallèle à celui de la rue où se construit alors le tram. L'idée du parcours est ainsi mise en valeur avec le trajet du spectateur au-delà de la salle de cinéma. Même idée de parcours pour raconter une histoire dans la déambulation intérieure qui conduit à la salle coupole.