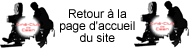|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Vincent Amiel , José Moure

Cette histoire vagabonde n'est pas une histoire du cinéma d'un seul mouvement, un récit surplombant, unique et linéaire. Vincent Amiel et José Moure, professeurs en études cinématographiques à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne proposent quatre grands axes de lecture pour penser le cinéma à partir de motifs (visages, corps, paysages, villes, histoires, documents); à partir des matériaux (Plans, couleurs, sons, récits, points de vue, mises en scène), à partir d'éléments constitutifs de la fabrication d'un film (Auteurs, tournages, Acteurs, actrices ; Animations; Effets spéciaux ; Montages), à partir des effets des films sur le spectateur (Spectateurs, spectatrices ; rires; Larmes ; Horreur ; Luttes; Théorie)
Ces grands axes pour penser le cinéma sont développés à partir d'une centaine de films, parfois canoniques, parfois moins connus : soit quatre films pour chacune des six parties de chacun des quatre grands axes de lecture (4 axes x 6 chapitres x 4 films).
L'histoire est vagabonde car les tournants sont spécifiques à chacun des 24 chapitres. Le récit se modernise à un moment, les lumières et le son à un autre. Il s'agit de saisir ces tournants spécifiques, leurs rythmes et leurs vitesses. Chaque fois, ce sont quatre films emblématiques et même, plus précisément un photogramme particulier de chacun d'eux, qui déclenche l'évocation historique. Ce sont ces images caractéristiques, la plastique de ces photogrammes qui permettent de développer les moments importants, de tirer les multiples fils qui tissent la pensée du cinéma.
Car si elle est vagabonde cette histoire est très documentée, citant environ 800 films de toutes époques et de tous pays, pour rendre concrètes les relations entre les formes, le contexte et les significations possibles. De ces 626 pages se dégage une compréhension, une émotion du monde par le cinéma sans cesse renouvelée.

1 - Images des hommes et du monde
Visages : 1915, Naissance d'une nation : le visage portrait du cinéma muet ; 1933, La reine Christine : le visage glamour du cinéma classique ; 1972, Cris et chuchotements : le visage vérité du cinéma moderne ; 1986 La mouche : le visage défiguré de la postmodernité.
Corps : 1923, Retour à la maison (Man Ray) : plastique d'avant garde ; 1959, Shadows, les corps emportés ; 1963, Le mépris : une réflexion morale ; 2013, Under the skin : décomposition.
Paysages : 1925, Visages d'enfants : le paysage comme un décor; 1949, Stromboli : le paysage comme sujet ; 1999, Le vent nous emportera : la construction d'un paysage ; 2005, Le nouveau monde: un territoire à penser.
Villes : 1927 Berlin symphonie d'une grande ville : rythmes urbains ; 1945, Rome ville ouverte : la ville néoréaliste ; 1976, Taxi driver : New York, ville sous influence ; 2001, Mulholland drive : Los Angles, la ville cinéma
Histoire : 1902 Le sacre d'Edouard VII : une reconstitution historique anticipée ; 1928, La passion de jeanne d'Arc : la fabrique de héroïnes; 1942, To be or not to be : l'histoire immédiate aux prises avec la comédie
Documents : 1922 : Nanouk l'Esquimau : mise en scène des documents ; 1929, L'homme à la caméra : la conscience des images ; 2007 : En sursis (Harun Farocki) : Le respect des archives et des évènements.
2 - Formes et matériaux des images
Plans, Couleurs, Sons, Récits, Points de vue, Mises en scène
3 - Création et fabrique des films
Auteurs, tournages, Acteurs-actrices ; Animations;
Effets spéciaux : 1896 : Escamotage d'une dame au théâtre Robert Houdin : Méliès ou l'invention du trucage ; 1941 : Citizen kane : le trucage comme écriture cinématographique; 1977 : La guerre des étoiles : d'un monde à l'autre ou la renaissance des effets spéciaux ; 2002 : Panic Room : vers une virtualisation de la caméra, ou la traversée numérique des apaprences.
Montages : 1902 : La vie d'un pomper américain : au commencement du montage narratif; 1927 : Octobre : le montage intellectue ; 1972 : Le parrain : le montage alterné ; 2000 : Requiem for a dream : le champ-contrechamp détourné.
4 - Spectacle et émotions.
Spectateurs, spectatrices ; Rires; Larmes ; Horreur ; Luttes; Théorie
1915, Naissance d'une nation : le visage portrait du cinéma muet
Quand Georges Demeny, en 1981, se place devant l’objectif de son phonoscope et se "chronophotographie" prononçant la phrase : "Je vous aime", c’est le mouvement de la physionomie et de la bouche lors de l’émission de sons qu’il entend reproduire et étudier "Chercher à obtenir une série d’images d’un homme qui parle, explique-t-il, cela revient à faire une série de portraits dans des temps très courts". Plus étonnant est le portrait animé que propose Laurie Dickson, en 1894, du visage d’un homme en train d’éternuer, L'éternuement de Fred Ott.
Cette pratique du portrait animé qui étudie le mouvement non plus simplement à travers des données spatiales et graphiques, comme le faisait Etienne-Jules Marey, mais dans son caractère expressif et proprement humain, institue dès avant le cinéma, le gros plan –le terme n’était pas encore en usage- comme forme pour ainsi dire autonome. Elle inaugure la constitution d’un corpus d’images en mouvement organisées autour du seul visage humain, de sa mobilité et de son expressivité que le cinéma ne cessera d’enrichir en faisant de la possibilité de s’approcher des visages une de ses qualités distinctives
Ces premiers expérimentateurs venaient presque tous de la photographie, où les portraient en plans rapprochés étaient une pratique courante sinon dominante. Quand les frères Lumière filment en 1895, avec leur cinématographe, Repas de bébé, c’est sans doute leur expérience de la photographie qui les conduit à capter sur le vif et dans une grosseur permettant au spectateur d’apprécier les mouvements et mimiques en perpétuel devenir qui s’y dessinent, ce visage de bébé à qui son père essaie de faire avaler son déjeuner. (…)
La disproportion et la proximité de ces visages coupés du reste du corps, extraits de la scène et qui occupent presque tout l’écran troublent et même semblent violer le bon goût traditionnel. Elles peuvent avoir quelque chose d’obscène, si l’on en juge par le scandale que provoqua The kiss, tourné en 1896 par William Heise.


Il y a une double obscénité dans ce court film : celle de l’objet filmé (le baiser certes mais surtout celle, inadmissible et monstrueuse de son filmage (l’agrandissement et le grossissement du plan rapproché. Cette démesure ("gargantuesque») des deux visages collés l’un contre l’autre est finalement jugée insupportable, à la fois illégitime et de mauvais goût.
C’est à des fins d’expressivité comique qu’en 1901, dans L’homme à la tête de caoutchouc, Georges Méliès joue avec l’effet attractionnel du grossissement du visage (...)

( Georges Méliès, 1901)

(Edwin Stratton Porter, 1903)
Le visage filmé en plan rapproché ou gros plan devient dans le courant des années 1910 un visage plus ordinaire. Un visage dont on veut se rapprocher, comme le peintre se rapproche de son modèle mais dont il s’agit surtout d’intégrer la valeur expressive et la fonctionnalité narrative dans la continuité de la représentation filmique.
Ce visage muet sera incarné ou plutôt idéalisé par Lilian Gish et filmé par D. W. Griffith. Si ce dernier n’a certes pas inventé le gros plan, il serait le premier avec Thomas Ince, selon l’historien du cinéma Jean Mitry à l’avoir incorporé à l’action au tournant des années 1910, puis en avoir formalisé l’usage en créant une harmonie entre les gros plans de visage de son héroïne et les plans moyens ou d’ensemble qui inscrivent les personnages dans le décor et l’action.
Encore rare au milieu des années 1910 et souvent isolé à la faveur d’un iris qui enserre harmonieusement le visage au sein de l’écran noir de l’écran, le gros plan place le visage au centre du récit et au cœur du drame tout en le fétichisant et en le détachant des aléas du monde et de l’histoire. Ainsi apparaît le visage pensif de Lilian Gish dans ce qui est le premier gros plan de Naissance d'une nation (1915), un plan médaillon raccordé sur le regard d’un des personnages principaux du film, Le petit colonel, soldat sudiste qui, dans un champ de coton, contemple à la dérobé le portrait ovale de sa bien-aimée nordiste. Dans ce visage photographié, filmé en gros plan, sublimé par le regard amoureux du protagoniste (et aussi sans doute du réalisateur) et intégré à la chaîne des plans dont il est le maillon essentiel, c’est une partie de l’histoire du visage au cinéma qui s’ébauche : une histoire héritée de la photographie inséparable du gros plan et de ce désir de voir mieux, plus grand et plus près, qui a conduit ceux que l’on n’appelait pas encore des cinéastes à interrompre la continuité de la vue ou du tableau pour insérer un plan rapproché et agrandi, et, ce faisant, à inventer, grâce au montage, une nouvelle continuité faite de la discontinuité des plans et de leurs taille, qu'on appela découpage.

(George Albert Smith, 1900)

(James Williamson, 1901)
Ces pionniers qui ont ouvert la voie à Griffith en Europe ont pour nom en Europe, George Albert Smith et James Williamson, représentants de l’école de Brighton qui, les premiers, ont brisé le mode de représentations primitif hérité du spectacle de scène (avec La loupe de grand maman, 1900 pour l’un et The big swallow, 1901, pour l’autre) par l’intégration de plans très rapprochés, souvent subjectifs, fonctionnant comme des inserts. Ils s’appellent aux Etats-Unis, Edwin Stratton Porter qui, dans le fameux Vol du grand rapide (1903), afin de surmonter le caractère impersonnel des silhouettes lointaines qu'il filmait et d’apporter une dimension humaine à ses personnages ; propose un plan rapproché de Barnes, le chef des hors-la-loi qui regarde et tire sur le spectateur. « L’impression est remarquable » précisait la maison de production qui, dans les informations qu’elle donnait aux exploitants, ajoutait que ce plan emblème (doublement transgressif pas sa grosseur et par le regard caméra) pouvait être placé au début ou à la fin du film, c’est à dire aux deux uniques moments où il n’aurait pas troublé le sectateur en interrompant la continuité de l’histoire et de sa représentation.
Du plan-emblème de Barnes au plan–médaillon de Lilian Gish, au fur et à mesure que la caméra se rapproche, des personnages, et ce très rapidement à partir des années 1913-14, pour le filmer en alternant plans d’ensemble et plans plus rapproché » ce qui se joue c’est l’intégration du gros plan et avec lui du visage dans le régime narratif et dans la chaine filmique. Il s’agit de laisser l’expression naturelle du visage opérer comme véhicule de sens et d’émotion sans parasiter la fluidité narrative.
Il y a comme le souligne Gilles Deleuze équivalence en très gros plan et visage :" Il n’y a pas de gros plan de visage, le visage est en lui-même gros plan, le gros plan est pour lui-même visage. Le gros plan c’est le visage" p125. Cela ne signifie pas que le gros plan soit le seul cadre adéquat pur traiter le visage, mais que le visage, tout visage est en lui-même gros plan et cela qu’il soit, selon la distinction proposée par Deleuze, un visage réflexif ou réfléchissant ou un visage intensif.
La caméra a servi à explorer la silhouette humaine et à se concentrer sur le visage, qui en est l’essence la plus précieuse. Monstrueusement agrandie sur l’écran, la face humaine doit être traitée comme un paysage. Il faut la voir comme si les yeux étaient des lacs, le nez une colline, les joues des prairies, la bouche un sentier fleuri, le front un fragment du ciel, les cheveux des nuages. Comme dans un paysage, le visage doit changer selon les variations de l’ombre et de la lumière. De même qu’on recouvre les arbres de peinture d’aluminium pour donner de la vie à la verdure, qu’on filtre le ciel pour graduer son éclat, qu’on braque la caméra sur le reflet d’un lac, la face humaine et les valeurs qui l’encadrent doivent être vues objectivement, comme si elles n’étaient qu’une surface inanimée. La peau doit refléter et non effacer la lumière, qui à son tour doit caresser, et non aplatir ce qu’elle frappe » (Joseph Von Sternberg, Souvenirs, 1963-1964, trad. M. Paz, Robert Laffont, 1966)
1933, La reine Christine : le visage glamour du cinéma classique
Ces artifices recommandés par Sternberg sont ceux là même qui ont caractérisé le cinéma hollywoodien, notamment à partir des années 1930, le style glamour, ce supplément de charme et d’évanescence issu de la photographie publicitaire que des techniques photographiques telles que le détourage des profils, le "soft focus"», les éclairages rasants et autres effets de dramatisation lumineuses ont ajouté aux visages des stars.
Avec celui de Dietrich, le visage de Garbo est sans doute celui qui incarne le mieux ces admirables visages-objets que le cinéma hollywoodien, au sommet de son art, a proposé aux spectateurs fascinés. Inspiré par la reprise de La reine Christine (Rouben Mamoulian, 1933), Roland Barthes lui consacre en 1955 un texte magnifique :
"Garbo appartient encore à ce moment du cinéma où la saisie du visage humain jetait les foules dans le plus grand trouble, où l’on se perdait littéralement dans une image humaine comme dans un philtre, où le visage constituait une sorte d’état absolu de la chair, que l’on ne pouvait ni atteindre ni abandonner." (Roland Barthes, Mythologies, 1957, in Œuvres complètes I. Livres, textes, entretiens 1942-1961, Editions du Seuil, 2002. Page 724) son visage « représente ce moment fragile, où le cinéma va extraire une beauté existentielle d’une beauté essentielle, où l’archétype va s’infléchir vers la fascination de figures périssables, où la clarté des essences charnelles va faire place à une lyrique de la femme. »
Le visage de Greta marque ainsi un moment de transition entre deux âges du cinéma : « passage de la terreur au charme », transition d’une beauté essentielle, contemplée comme une idée dans le modelé muet du masque à une beauté existentielle, saisie comme événement individuel et personnifié par le visage d’Audrey Hepburn… Du gros plan de Greta Garbo qui clôt La reine Christine, cette femme quia tout perdu, son amant, son royaume et qui, à la proue de son navire l’emportant vers l 'exil, fixe l’horizon au gros plan d’Audrey Hepburn, assise au rebord de la fenêtre de son appartement qui chante rêveusement Moon river en s'accompagnant à la guitare dans Diamants sur canapé (Blake Edwards, 1961) c’est tout un pan de l’histoire du visage au cinéma qui se déploie;

(Rouben Mamoulian, 1933)

(Blake Edwards, 1961)
1972, Cris et chuchotements : le visage vérité du cinéma moderne
Au visage lisible du cinéma classique, le cinéma qu’on a appelé moderne, né en Europe du traumatisme de la seconde guerre mondiale, oppose un visage qui perd sa lisibilité pour prendre en charge, derrière le masque du personnage et les artifices du jeu de l’acteur, la recherche inconditionnelle d’une vérité humaine. Il s’agit littéralement de mettre à nu le visage de le rendre à son opacité immanente pour laisser advenir ou traquer une émotion, une vérité qui s’expose sur le mode du passage et de l’affleurement.
Un gros plan de Cris et chuchotement questionne magistralement cette condition du visage moderne condamné à n'être qu’un signe indifférent, à ne réfléchir que lui-même ou le regard de l’autre. David, le médecin (Arland Josephson) convie Maria (Liv Ullmann) qui a été sa maîtresse à s’approcher d’un miroir et à observer. Commence alors un gros plan qui se décompose en quatre temps, quatre cadres qui déconstruisent l’illusion d’une transparence du visage :
1 - La caméra cadre d’abord en gros plan le visage de David qui après avoir invité Maria à se regarder dans le miroir lui dit : « Tu es belle, peut-être plus que de notre temps. Mais tu as changé »
2 sur cette dernière phrase, un bref mouvement de caméra fait passer du visage de David à celui de Maria en très gros plan qui fixe intensément son reflet dans le miroir tandis que l’homme, désormais hors champs continue de parler : « Je veux que tu voies : Tu jettes maintenant des coups d'œil en coin, vifs, calculateurs. Autrefois, tu avais le regard doit, ouvert, sans dissimulation. Ta bouche a pris un pli de mécontentement et de faim. Elle si douce avant. Ton teint est pâle, ta peau est sans couleur. Tu te maquilles. Ton front, si pur, est griffé au-dessus des sourcils, tu ne le vois pas sous cet éclairage. Mais ça se voit en plein jour. Sais-tu d’où viennent ces griffures ? De l’indifférence. »
3- En prononçant ces paroles, David se place sur la droite de la femme et ses lèvres entrent dans le champ : « Et cette ligne fine de l’oreille, au menton n’est plus si parfaite. C’est la marque de ton indolence. Regarde la base de ton nez. Pourquoi te moques-tu si souvent ? Le vois-tu ? Tu te moques trop souvent. Le vois-tu Maria ? Sous tes yeux, les rides acérées, presque imperceptibles, de l’ennui et de l’impatience. Maria l’interrompt et lui demande : "Tu vois vraiment tout ça sur mon visage ?" "Non, répond l’homme, je le sens quand tu m’embrasses." Maria : "Tu plaisantes. Je sais où tu les vois." David : "Où donc ?". Maria : "Tu le vois en toi."
4- Un léger mouvement de caméra élargit le champ, incluant à droite du visage de Maria celui de David. Celui-ci, approchant de son propre visage une bougie qui jusque là n’était pas dans le cadre, demande : "Tu veux dire par l’égoïsme ? La froideur ? L’indifférence ?", puis souffle sur la bougie qui éclairait le plan.
A première vue, ce plan accrédite l’hypothèse du visage comme miroir de l’âme. David lit sur les traits de Maria les signes censés exprimer le changement intérieur de celle qu’il a aimée. Mais à peine affirmée, cette lecture est niée, renvoyée à la subjectivité de celui qui interprète le visage de l’autre et ne voit que le reflet de lui-même. La description devient interprétation, le portrait autoportrait. Et le beau visage de Maria, rendu un moment transparent et lisible au spectateur, se défait en pure apparence visible. Il retrouve sa vibrante et humaine opacité et redevient une carte de signes indifférents, un visage in-envisageable.
1986, La mouche : le visage défiguré de la postmodernité.
Humain trop humain, ce visage moderne du cinéma qui ne peut rien réfléchir ni traduire sinon l’affleurement imprévisible du travail du temps, est soumis depuis les années 60 et plus encore les années 1990 et 2000 à un inexorable processus d’altération qui tout en prenant des formes multiples, résulte d’une mise en crise de la figuration humaine. Il ne s’agit plus d’exalter la puissance auratique ou d’incarnation d’un visage, ou de traquer derrière le vernis fictionnel du personnage une vérité documentaire de l’acteur, mais de liquider le visage de lui "faire la peau" en lui infligeant les violences de la défiguration.

(George Franju, 1960)

Cette entreprise progressive de dévisagéification trouve une de ses expressions les plus emblématiques dans le chef-d'œuvre du genre de Franju Les yeux sans visage. Avec ces peaux, privées de toute mobilité, de toute expression propre et qui passant d'un visage à l’autre se dégradent, c’est l’effacement et le devenir inhumain du visage qui se donne à voir.
Aucun autre cinéaste sans doute n’est allé aussi loin que David Cronenberg dans l’exploration des limites de la visagéité. A l'instar de Crimes of the future qui se déroule dans la Maison de la peau , institut pour riches patients atteints de pathologies dermatologiques induite par l’usage de produits de beauté, de Scanners (1981) qui montre le gonflement et l’implosion des visages sous l’effet d’une entreprise télépathique ou les béances informes et la déréliction d’une chaire en décomposition dans La mouche (1986)
Les effets spéciaux relèvent de techniques multiples que l’on peut néanmoins classer en deux catégories. Les effets spéciaux proprement dits qui incluent, les effets physiques réalisés en direct sur le plateau (maquillage, animatronique, pyrotechnie), et les effets visuels, anciennement trucages qui sont dorénavant produits numériquement en post-production.
Parmi les effets spéciaux proprement dits, on peut distinguer :
- Les effets optiques qui peuvent être créés à partir de techniques de maquillage (La planète des singes, Franklin Schaffner, 1968) ou de maquettes (Métropolis, Fritz Lang, 1927) ou de décors peints sur toile ou sur verre (la peinture sur verre, glass painting, utilisée des 1907, a notamment été employée pour certains décors d’Autant en emporte le vent de Victor Flemming en 1937).
- Les effets mécaniques qui ont pour but d’actionner mécaniquement des marionnettes (le géant d’A la conquête du pôle, Georges Méliès, 1912, des robots (King Kong, Ernest B. Schoedsack-Cooper, 1933) ou tous types de créatures qu’on désigne sous le terme « animatroniques » : les corbeaux des Oiseaux (Hitchcock, 1963), le requin des Dents de la mer (Steven Spielberg, 1975) et E.T., l’extraterrestre (Steven Spielberg, 1982).
- Les effets chimiques qui sont utilisés pour vieillir un décor ou susciter sans danger tout type de phénomènes (incendie, explosion, fumée, brume…)
Les effets visuels, anciennement trucages, sont produits par des opérations sur l’image
- Les techniques "traditionnelles" d’arrêt de caméra (ou trucage par substitution) de prise de vue image par image, d’inversion du défilement de pellicule, d’accéléré, de ralenti, de retouche et découpage d’image (du rotoscope et pictograpghe aux effets réalisés par ordinateur, en images 2D ou 3D).
- Les désormais très nombreuses et complexes techniques d’utilisation d’images numériques qui tendent à remplacer els effets mécanique comme le mapping, le morphing, en permettant toutes sortes d’effets d’incrustations de personnages dans un décor (ou chroma key) de colorisation, d’incrustations d’objets 2D ou 3D, d’insertion d’un personnage ou d’un objet entièrement créés numériquement.
Dans sa vue kinétoscope L'exécution de Mary, reine des Ecossais, Alfred Clark Fait usage d’un truc par arrêt de la caméra pour représenter la mise à mort de Mary Stuart : la hache du bourreau s’élève puis s’abat lourdement sur la nuque de la reine. La tête se détache du corps et tombe sur le sol. Pour réaliser ce truc le moteur de la caméra a été arrêté au moment où le bourreau brandit la hache à al verticale ; le comédien incarnant Mary Stuart se retire de la scène pour être remplacé par un mannequin avec une tête postiche ; l’appareil de prises de vues est remis en marche et le bourreau produit son mouvement de décapitation. Afin de rendre le truc invisible, une manipulation sur la pellicule est alors nécessaire : les quelques photogrammes surexposés au moment de l’arrêt et du redémarrage du kinétographe sont coupés puis les deux morceaux de pellicules collés.
Le truc est ici mis au service d’une narration plus réaliste et ici plus saisissante pour le spectateur, la représentation d’une action. Cependant, c’est d’abord utilisé comme une fin en soi, comme attraction, que le trucage par arrêt sur caméra s’est rependu dans la cinématographie des premiers temps grâce à Georges Méliès :
"Veut-on savoir comment me vint la première idée d’appliquer le truc au cinématographe ? Bien simplement, ma foi. Un blocage de l’appareil dont je me servais au début (appareil rudimentaire dans lequel la pellicule se déchirait ou s’accrochait souvent et refusait d’avancer) produisit un effet inattendu, un jour que je photographiais prosaïquement la place de l’Opéra ; une minute fut nécessaire pour débloquer la pellicule et remettre l’appareil en marche. Pendant cette minute, les passants, omnibus, voitures, avaient changé de place, bien entendu. En projetant la bande, ressoudée au point où s’était produite la rupture, je vis subitement un omnibus Madeleine-Bastille changé en corbillard et des hommes changés en femmes. Le truc par substitution, dit truc à arrêt, était trouvé, et deux jours après j’exécutais les premières métamorphoses d’hommes en femmes et les premières disparitions subites qui eurent, au début, un si grand succès » (Georges Méliès, Revue du cinéma, 15 octobre 1929).
Dans Escamotage d'une dame au Théâtre Robert Houdin, Georges Méliès transpose l’illusion la plus célèbre et la plus imitée dans les années 1880, la « femme évanescente » du magicien Buatier de Kolta qui faisait disparaitre et réapparaitre sa partenaire sur scène. L’artiste recouvrait la dame d’une nappe, exécutait des passes magiques, enlevait la nappe : la dame avait disparue, à sa place un squelette ; il repositionnait la nappe, la dame avait réapparu. Pour réaliser ce tour, Buatier de Kolta recourait à une trappe camouflée par une fausse feuille de journal en caoutchouc fendue en son milieu sur laquelle il posait une chaise dotée d’une invisible structure de fil de fer arrondie permettant à la nappe avec laquelle il recouvrait sa partenaire de conserver sa forme au moment de l’escamotage. La dame s’asseyait puis, une fois cachée sous la nappe, passait sous la chaise truquée en en faisant basculer le siège et glissait ainsi par la trappe dissimulée sous un faux journal qui quand le prestidigitateur retirait la nappe retrouvait son apparence normale grâce à l’élasticité du caoutchouc.
Dans la transposition cinématographique, bien que Méliès expose au début de son film les accessoires dont avait besoin Buatier de Kolta, la trappe dissimulée en journal et la chaise truquée sont devenus inutiles pour escamoter la dame. Seul un arrêt caméra est nécessaire pour obtenir chaque disparition. Ou plutôt semble nécessaire car le trucage par arrêt de la caméra suppose une coupure des photogrammes surexposées à l’arrêt et à la reprise de la caméra.
Un truc en amène un autre ; devant le succès du nouveau genre, je m’ingéniais à trouver des procédés nouveaux et j’imaginais successivement les changements de décors fondus, obtenus par un dispositif spécial de l’appareil photographique.
La Truca est assurément l’outil qui incarne le mieux l’évolution technologique et la généralisation des effets spéciaux au stade de la postproduction. Construite en France par André Debrie des 1929, cette tireuse optique spécialisée offrait la possibilité de réaliser toute une variété de trucages, des plus simples aux plus compliqués, d'un fondu d'ouverture ou de fermeture, ou d'un fondu enchaîné, d'un accéléré ou d'un ralenti par répétition des mêmes images, d'une marche arrière, la gamme était complète. La surimpression de deux plans ou d'un titre, le sous-titrage complétaient ces possibilités. La plus complexe était la confection d'un couple cache/contre-cache pour diviser l'image en plusieurs zones, aussi bien pour réaliser un split-screen, une image où apparaissent simultanément plusieurs plans, que pour introduire un élément de décor ou un personnage fabuleux (un monstre par exemple) dans un plan où s'activent des comédiens en chair et en os.
A Hollywood, dès le début des années 20, chaque grand studio fonde son département d'effets. Comme en Europe mais dans un cadre plus industriel, beaucoup de trucages optiques mis au point pendant ces années concernent la reconstitution artificielle du décor et l'insertion des personnages dans ce décor :
- La transparence (back ou rear projection) qui repose sur la rétroprojection d’un film de décor sur un écran semi transparent (appelé écran de transparence) placé derrière els acteurs qui jouent leur scène en studio
- Le travelling matte (ou cache mobile), trucage par cache/contre-cache
King Kong est l’emblème de cet âge d’or des effets spéciaux qui s’ouvre à Hollywood a l’orée du parlant. Produit par la RKO avec comme responsable aux effets spéciaux Linwood G. Dunne, co-inventeur avec Vernon L. Walker, d’une tireuse optique révolutionnaire achevée en 1932 et abondamment utilisée pour sa réalisation, le film impliquait d’incruster des acteurs au premier plan, non seulement devant un décor de jungle, mais aussi devant des scènes tournées image par image avec des marionnettes. Pour ce faire, en plus des effets traditionnels de cache contre cache, Dunn combine toute une série de trucages optiques (la transparence, le travelling mate, mais aussi l’animation image par image de modèles réduits, les peintures sur verre, les miniatures, les marionnettes articulées)
2002 : Panic Room : vers une virtualisation de la caméra, ou la traversé numérique des apparences.
L'explosion des effets numériques au milieu des années 1990 change radicalement la donne et autorise la réalisation de trucages beaucoup plus complexes grâce notamment à de nouveau procédés de fabrication d'image, en particulier des images générées par ordinateurs et le digital compositing
Dans Panic Room, la caméra virtuelle, devient une des figures principales du film, un personnage immatériel, intrusif, omnipotent qui investit et hante par ses mouvements continus et multidirectionnels et par son regard autonome et sans corps "l'esprit" de la maison où, retranchées dans une pièce refuge pour échapper à des cambrioleurs, s'enferment Mag Altman (Jodie Foster) et sa fille Sarah (Kristen Stewart). Le plan de deux minutes et quarante secondes qui intervient à la quinzième minute du film, au moment où les trois cambrioleurs explorent toutes les voies possibles (porte, fenêtre, baie vitrée, puits de lumière...) pour s’introduire par effraction dans la demeure est assurément la manifestation la plus spectaculaire des pouvoirs de la caméra virtuelle.
La caméra part du lit où est allongée Jodie Foster, descend le long d'une cage d'escalier jusqu'au rez-de-chaussée, glisse vers une fenêtre d'où l'on voit au travers des barreaux arriver dans l'obscurité des cambrioleurs; elle s'avance vers une porte dont elle semble vouloir traverser la serrure qu'un cambrioleur essaie en vain de forcer; accompagnant de l'extérieur les déplacements des cambrioleurs qui, à l'extérieur de l'appartement, cherchent un moyen de pénétrer les lieux, elle longe la fenêtre à barreaux puis traverse rapidement la cuisine, survole le plan de travail, se faufile à travers l'anse d'une cafetière pour rejoindre une porte-fenêtre qu'un des voleurs essaie d'ouvrir; alors que l'on voit le voleur s'engager dans les escaliers de l'immeuble, la caméra, dans un mouvement continu et fluide, le suit à l'intérieur, monte les étages en traversant le plancher, passe devant la chambre où dort Jodie Foster et s'élève jusque sous le puits de lumière au dessus de l'appartement où un cambrioleur, introduisant une barre dans une trappe en fer qui finit par céder (fin du plan), déclenche un signal que Jodie Foster endormie n'entend pas.
Dans ce plan qui, tout en suivant l'intrusion des cambrioleurs dans la maison, construit l'espace scénique, à la fois visuel et mental, dans lequel va se dérouler le huis clos, aucune coupe visible, aucun obstacle matériel ne semble pouvoir stopper le déplacement continu et fluide de la caméra. Celle-ci voit son rôle et son statut redéfinis. Libérée des contraintes physiques, elle exhibe son immatérialité et affiche son mouvement comme pur effet spécial ne cherchant plus à mimer un regard humain ou à simuler, comme souvent dans les films en images de synthèses, les travellings, panoramiques et effets de mise au point d'une caméra réelle
Dans les années 2010, les avancés de l'image de synthèse ou CGI (image de synthèse générée par ordinateur souvent la voie à la perspective d'un cinéma d'animation pure qui, tout en proposant une représentation photographique de la réalité, pourrait entièrement se passer de prise de vues réelles et donc d'effets spéciaux, car tout son processus de production serait en lui même un effet spécial.
Pour Gravity (2013) Alfonso Cuaron a d'abord réalisé son film entièrement en animation; puis les acteurs, en particulier les visages ont été filmés, enfin les images de synthèse générées par ordinateur (ou CGI) et les prises de vues réelles ont été assemblées et fusionnées dans la mise en scène de manière à ce qu'elles se confondent. Le plan d'ouverture de plus de quinze minutes d'une impressionnante fluidité montre l'approche de la station Hubble qui d'abord microscopique dans l'univers, finit au terme d'un mouvement très lent par occuper tout l'écran, puis fait découvrir, passant de l'un à l'autre sans montage, trois astronautes cadrés en plan moyen et rapproché, attelés à des travaux de maintenance en extérieur, avant de se centrer en très gros plan sur une vis minuscule qui échappe à Sandra Bullock. Dans cette métamorphose continue de l'image qui fait passer du plan général de la station noyée dans l'immensité du cosmos au très gros plan de la vis, non seulement les notions de plans et d'échelle de plans sont bouleversées mais surtout les codes visuels du spectateur et sa manière d'appréhender et d'habiter l'espace-temps filmique. Si le spectateur sait encore plus ou moins ce qu’il regarde, il ne sait plus d'où et comment et pourquoi il regarde. Comme si l'effet spécial suprême ou l'ultime aventure du cinéma consistait à couper le fil de plus en plus ténu qui relie l'expérience filmique à l'expérience du monde, à renoncer à l'attraction terrestre pour immerger le spectateur dans un bain de sensation sidéral.