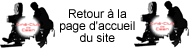|
|
|
|
|
Nanouk l'esquimau




 La vie quotidienne de Nanouk et de sa famille, esquimaux de la région
d'Ungawa, sur la rive orientale de la baie d'Hudson (Nanouk en langue esquimau
signifie "ours").
La vie quotidienne de Nanouk et de sa famille, esquimaux de la région
d'Ungawa, sur la rive orientale de la baie d'Hudson (Nanouk en langue esquimau
signifie "ours").
La recherche perpétuelle de nourriture exige une vie nomade. L'été durant, ils voyagent sur le fleuve pour pêcher le saumon et le morse. L'hiver, ils trouvent de la nourriture après avoir bien souvent frôlé la famine. La nuit, toute la famille construit l'igloo, puis ils se glissent dans des vêtements de fourrure pour dormir, utilisant leurs habits de jour en guise d'oreiller. Le lendemain, la quête reprend et la vie continue.


 Nanouk l'esquimau
est un film historiquement important : s'il participe, comme le rappelle André
Bazin dans son article "Le cinéma et l'exploration", à
un filon de l'époque que le critique nomme les films "blancs"
et qui rencontre le succès à la suite du film d'Herbert G. Pounting,
L'éternel silence, "Nanouk de R. Flaherty demeure le chef
d'œuvre."
Nanouk l'esquimau
est un film historiquement important : s'il participe, comme le rappelle André
Bazin dans son article "Le cinéma et l'exploration", à
un filon de l'époque que le critique nomme les films "blancs"
et qui rencontre le succès à la suite du film d'Herbert G. Pounting,
L'éternel silence, "Nanouk de R. Flaherty demeure le chef
d'œuvre."
De fait, le film pose les bases du "cinéma-vérité" (repris plus tard par Jean Rouch, Pierre Perrault ou, sur des modes différents, Joris Ivens et plus récemment Denis Gheerbrant ou Lisandro Alonso dans son film La Libertad) et, plus spécifiquement, du cinéma ethnographique. Nanouk reste par ailleurs un film de référence, souvent cité par Godard, peu apprécié par Truffaut qui, pourtant, selon Rivette, réalisera avec Les 400 coups, un film ressemblant drôlement à du Flaherty, analysé par Bazin afin d'appuyer sa théorie du "montage interdit ", pris enfin comme exemplaire de la structure des films de l'image-action (Situation - Action - Situation) par Gilles Deleuze.
Le documentaire : entre réalité et fiction…
Godard raconte : "Quand on lit le récit du tournage de Nanouk de Flaherty, qu'on prend pour un documentaire, on apprend que Flaherty a payé ses Esquimaux, il s'est disputé avec eux, il les a forcés à pêcher du poisson tous les jours alors qu'ils n'en avaient pas envie, bref, il a fait une équipe de cinéma avec eux et ce fut du coup un ethnologue formidable."
Ces propos anecdotiques laissent entendre que la vérité documentaire ne peut pas s'atteindre par un rapport direct de la caméra à la réalité, rapport toujours illusoire, mais par un travail de cinéma, de mise en scène et de choix qui organise le propos. De fait, si Nanouk l'Esquimau s'attache à retracer la vie des Esquimaux, parfois par des panneaux très didactiques, si Flaherty travaille au plus proche du geste quotidien (la chasse, la construction de l'igloo, la vie familiale, la lutte contre le milieu), enfin si certains plans sont réalisés clairement en prise directe sans travail de mise en scène immédiat (on pense notamment aux visages souriants regardant la caméra), il n'empêche que le travail de fiction n'est jamais loin.
Flaherty, par les panneaux qui rythment le film, crée une narration appuyée : dès sa préface, le film est présenté sous l'angle du mythe dont le héros sera le personnage exemplaire de Nanouk, simple, courageux et brave. Le cinéaste construira son film autour de grandes séquences à "suspense", comme il est dit dans une scène de chasse, qui mettent en scène l'homme et sa famille face à une épreuve qui demandera à être combattue : chaque scène devient alors une petite dramaturgie de la lutte (lutte contre le froid, contre le terrain inhospitalier, contre l'abondance blanche qui menace l'estomac des petits Esquimaux, contre le milieu animal) et trouvera sa résolution (la construction d'un igloo, " l'huile de crin " pour l'estomac du petit, la dégustation de la bête chassée…). Bref, le réel est cadré par la narration et chaque scène a sa structure propre de petit épisode comportant situation initiale, élément menaçant ou à combattre et résolution. On est bien, comme l'a souligné Deleuze, dans un "tête-à-tête avec le milieu" marqué par le "duel" caractéristique de l'image-action, duel si important pour le montage interdit.
Flaherty cherche à saisir la puissance de résistance de l'homme dans un milieu qui ne lui laisse pas de place et qui, par la glace blanche et le ciel tout aussi blanc (énorme "synsigne"), semble vouloir étouffer toute trace de vie. En dramatisant les épisodes du quotidien, Flaherty insiste donc sur le conflit et sur l'héroïsme de son personnage. Après tout, cette dimension mythique et héroïque du personnage ne pouvaient qu'être au centre du film puisque ce dernier est présenté par Flaherty, dans son avant-propos, comme une rescapé (le film a brûlé plusieurs fois et le cinéaste a dû le retourner), lui aussi pris dans une petite dramaturgie de la lutte pour une existence faite de perturbations et de résolutions. La notion de documentaire est donc problématique : la voix de la narration est très présente, fiction et réalité, mise en scène, organisation dramatique (par le montage notamment) et impressions de prises sur le vif se mêlent et ouvrent sur un lyrisme de la réalité marqué par la lutte contre les éléments.
… à la recherche du geste vital : la parole ethnologique
Ce lyrisme, lutte contre le vent, la neige, le froid ou la faim (Kurosawa s'en souviendra peut-être dans le troisième rêve de Rêves, " la tempête de neige "), trouve sa plus grande justesse et sa plus grande beauté sans doute dans les longues scènes de chasse aux phoques ou de traversée de l'étendue blanche. Là, la narration se fait moins présente ; l'image prend son temps pour, dans la longueur, saisir le geste vital. Il peut être simple : une ruse de chasse (se mettre à plat ventre pour ne pas se faire remarquer par les morses, faire bouger verticalement sa canne à pêche pour attirer le poisson), un apprivoisement du milieu (trouver le chemin le plus sûr par un regard sur l'étendue), un geste (découper la peau du phoque pour en extraire la nourriture, nettoyer et réchauffer ou embrasser le plus petit de la famille, etc…).
L'ensemble du film joue sur la proximité entre animalité et humanité. Les humains sont emmitouflés dans des fourrures épaisses à travers lesquelles transparaissent à peine les visages ; Nanouk a pour surnom "l'ours", la dégustation du phoque, par un jeu de montage qui plaira sans doute à Eisenstein qui reconnaît sa dette envers Flaherty, met en parallèle humain et husky pour jouer sur la minime différence entre les deux.
Mais ce que Flaherty filme plus précisément, c'est justement ce qui fait l'humain. Et pour faire simple, nous pourrions dire que ce qui fait l'humain, c'est la saillie, ce qui fait pointe, de manière surprenante, contre un plan monotone. La force de l'homme se manifeste en effet par sa capacité à se dresser, à se tenir debout, par sa verticalité donc qui s'oppose à l'horizontalité du milieu blanc. Et les gestes vitaux seront pour la plupart verticaux : les mouvements de la canne à pêche dans l'eau pour attirer le poisson, le coup de lance dans l'entonnoir du phoque, la remontée à la surface du phoque, la marche sur l'étendue blanche. Si l'homme doit se mettre à l'horizontal, ce ne sera que par ruse, pour tromper le morse, pour se rapprocher de l'eau du poisson ou lorsqu'il baissera sa garde pour le sommeil.
Autres traits d'humanité saillant, le découpage du phoque au couteau qui permet de couper pour la nourriture ; enfin les visages rompant l'amas de fourrures. L'homme se révèle alors, et c'est sans doute la force ethnologique du film, comme ce qui vient rompre une continuité de lignes (l'horizontalité), de tissus (la peau du phoque ou les fourrures). Lorsqu'il s'intégrera à son milieu, lorsqu'il se fera morse ou glace (par la salive déposée sur le couteau en vue d'un meilleur tranchant), ce ne sera que pour mieux tromper le milieu et rompre son équilibre.
Flaherty filme donc la vie dans ce qu'elle a de tranchant et d'opposition à un milieu. D'où sans doute le grand nombre de plans qui montreront l'avancée des Esquimaux, par exemple sur la barque, par une diagonale qui vient rompre l'homogénéité d'une surface, ici l'eau, c'est-à-dire par une ligne de trajet qui coupe le plan en deux. Rechercher la surprise de la vie donc dans ce qu'elle a de déroutant et de surprenant : c'est sans doute le sens de ce plan, au début du film, durant lequel la barque ne cesse de se vider d'habitants cachés dans sa coque et dont on ne soupçonnait pas la présence jusque là. Eux aussi, par leur surgissement, viennent rompre notre attente. La vie est là où on ne l'attend pas. La stature, le sourire sous les fourrures, et enfin, le noir des corps qui s'inscrit sur le blanc de la neige, de la pellicule, ce noir du foyer que l'on voit poindre avant la fermeture de l'igloo, noir profond contre le blanc du dehors hostile, voici donc la vie montrée par Flaherty grâce à des procédés épurés, géométriques pourrions-nous dire, ou, pour ce qui est de ce noir des corps se détachant du blanc de la banquise en plan large, proche du jeu d'ombres
Un documentaire à double fond : geste de vie, geste de cinéma
La vie est donc réduite à sa simplicité de résistance : des lignes verticales s'opposent à l'horizon, une tache plus sombre sur la pellicule contraste contre le blanc. La primitivité de la vie des Esquimaux serait en quelque sorte rendue par une primitivité du geste cinématographique. En quelque sorte, la trace d'humanité, c'est ce qui fait signe à partir de l'univers blanc ; la possibilité du cinéma, c'est l'inscription d'un signe, d'un corps qui fera ombre sur la pellicule blanche. La révélation de la vie entrerait alors en écho avec la révélation cinématographique.
Ces plans de lignes noires sur l'étendue blanche représenteraient alors une simplification parfaite du cinéma, projection sur l'écran d'ombres imprimées sur la pellicule. Si Flaherty, toujours dans sa préface, se dit "novice" en cinéma, on voit bien que la nécessité de refaire le film marque également l'apprentissage des moyens du cinéma jusqu'à une mise en œuvre subtile. Le film est donc à double fond : à la fois documentaire sur la vie en milieu hostile et réflexion sur ce qu'est le cinéma. Filmer la banquise, le milieu blanc, c'est filmer la possibilité de la vie tout autant que la possibilité du cinéma.
Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le geste de vie de la découpe
de la peau du phoque s'accordera avec le geste de cinéma d'une découpe
de la scène par un montage parallèle entre l'homme et le loup
: le geste est le même, on coupe pour se nourrir d'un côté,
pour faire sens de l'autre. Le dernier jeu sur ce double fond (ethnographie,
cinématographique) qu'on relèvera, tient dans cette scène
de la finition de l'igloo. D'un côté, le milieu blanc hostile
à la vie, de l'autre, le noir du foyer. Nanouk ira alors découper
un bloc de glacer pour faire une fenêtre dans l'igloo et éclairer
l'intérieur afin de rendre la vie possible. La vie ne serait possible
que dans l'interaction entre le noir du foyer, de l'homme et le dehors blanc,
la lumière. Le foyer n'est pas vivable s'il n'est que ce noir. Il ne
l'est que dans un échange entre la communauté humaine et le
milieu, que par une confrontation entre dedans et dehors, noir et blanc. Mais
c'est aussi le fonctionnement du cinéma qui se lit dans cette scène
: la vie ne pourra se révéler que par une lumière passant
par la fenêtre de la caméra pour s'inscrire sur la pellicule
d'abord enfermée dans le foyer de la caméra puis développée
dans la chambre noire : c'est suite à ce passage de la lumière
par la glace vers le foyer jusque là opaque, que le spectateur pourra
voir la scène d'intérieur.
Cette adéquation de Flaherty aux principes premiers du cinéma demeure jusqu'à la toute fin du film. Il se clôt sur une tempête de neige qui vient couvrir les visages de ses héros. Flaherty en cela anticipe et annonce, ce qu'il sait arriver après chaque fin de film : un écran qui redevient blanc.
Antoine Bertot le 16/01/2011