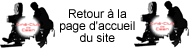|
|
|
|
|
La belle noiseuse




 Accompagné de son amie Marianne (Emmanuelle Béart), Nicolas
(David Bursztein), un jeune peintre au talent prometteur, se rend en Provence,
durant un été caniculaire, afin de visiter l'atelier du grand
maître Frenhofer (Michel Piccoli) qui, depuis plusieurs années,
vit reclus avec sa femme Liz (Jane Birkin), sans plus jamais exposer son travail.
Dans l'atelier de Frenhofer, Nicolas et Marianne découvrent plusieurs
toiles inachevées, parmi lesquelles La Belle Noiseuse, sa dernière
grande oeuvre abandonnée voilà plusieurs années et pour
laquelle Liz servit de modèle. Son galeriste suggère à
Frenhoher de reprendre La Belle Noiseuse en faisant poser Marianne, et Nicolas
conclut l'affaire en l'absence de la jeune femme. Lorsqu'elle apprend que
son amant l'a en quelque sorte "cédée"au grand peintre,
pour qui elle devra poser nue, Marianne se fâche contre Nicolas et,
mue par un désir de provocation ou une réelle curiosité,
elle décide de relever le défi.
Accompagné de son amie Marianne (Emmanuelle Béart), Nicolas
(David Bursztein), un jeune peintre au talent prometteur, se rend en Provence,
durant un été caniculaire, afin de visiter l'atelier du grand
maître Frenhofer (Michel Piccoli) qui, depuis plusieurs années,
vit reclus avec sa femme Liz (Jane Birkin), sans plus jamais exposer son travail.
Dans l'atelier de Frenhofer, Nicolas et Marianne découvrent plusieurs
toiles inachevées, parmi lesquelles La Belle Noiseuse, sa dernière
grande oeuvre abandonnée voilà plusieurs années et pour
laquelle Liz servit de modèle. Son galeriste suggère à
Frenhoher de reprendre La Belle Noiseuse en faisant poser Marianne, et Nicolas
conclut l'affaire en l'absence de la jeune femme. Lorsqu'elle apprend que
son amant l'a en quelque sorte "cédée"au grand peintre,
pour qui elle devra poser nue, Marianne se fâche contre Nicolas et,
mue par un désir de provocation ou une réelle curiosité,
elle décide de relever le défi.


 Il ne fait
pas de doute, en apparence, qu'à l'intérieur d'une seule et
même Belle Noiseuse, ce sont deux films qui cohabitent, le premier (qui
s'ouvre sur ce prologue-hameçon à la belle virtuosité
entre Marianne et Nicolas) prenant appui sur un marivaudage qui deviendra
plus grave au fur et à mesure de son frottement au second film, ce
film presque documentaire sur les séances, les journées (au
sens presque sadien du terme) que le peintre Frenhofer (joué par Piccoli
mais dont la main n'est autre que celle du peintre figuratif Bernard Dufour)
passera en atelier avec Marianne pour essayer de mener une nouvelle fois à
terme la réalisation d'un tableau, La Belle Noiseuse. Cela ne fait
nul doute (et la version courte du film, Divertimento, corrobore cette scission
entre deux films distincts) et pourtant, à bien les regarder, ces deux
noiseuses n'en finissent jamais de s'entrecroiser, de brouiller leur piste,
de donner - l'une dans le romanesque, l'autre dans le document brut - des
informations l'une sur l'autre. Sans doute parce que, plus de dix ans après
L'Amour fou et en prenant (ce n'est pas un hasard) une fois encore le temps
de s'immiscer dans le processus créatif immense, ici celui qui lie
un peintre à son modèle, avec l'ambiguïté et la
fragilité que le nu impose à l'intérieur même de
cette relation, La Belle Noiseuse ne pose qu'une question déclinée
sous ses diverses formes : la possession est-elle possible ? l'idée
de posséder quelqu'un, sinon quelque chose de quelqu'un, n'est-elle
pas pure folie ?
Il ne fait
pas de doute, en apparence, qu'à l'intérieur d'une seule et
même Belle Noiseuse, ce sont deux films qui cohabitent, le premier (qui
s'ouvre sur ce prologue-hameçon à la belle virtuosité
entre Marianne et Nicolas) prenant appui sur un marivaudage qui deviendra
plus grave au fur et à mesure de son frottement au second film, ce
film presque documentaire sur les séances, les journées (au
sens presque sadien du terme) que le peintre Frenhofer (joué par Piccoli
mais dont la main n'est autre que celle du peintre figuratif Bernard Dufour)
passera en atelier avec Marianne pour essayer de mener une nouvelle fois à
terme la réalisation d'un tableau, La Belle Noiseuse. Cela ne fait
nul doute (et la version courte du film, Divertimento, corrobore cette scission
entre deux films distincts) et pourtant, à bien les regarder, ces deux
noiseuses n'en finissent jamais de s'entrecroiser, de brouiller leur piste,
de donner - l'une dans le romanesque, l'autre dans le document brut - des
informations l'une sur l'autre. Sans doute parce que, plus de dix ans après
L'Amour fou et en prenant (ce n'est pas un hasard) une fois encore le temps
de s'immiscer dans le processus créatif immense, ici celui qui lie
un peintre à son modèle, avec l'ambiguïté et la
fragilité que le nu impose à l'intérieur même de
cette relation, La Belle Noiseuse ne pose qu'une question déclinée
sous ses diverses formes : la possession est-elle possible ? l'idée
de posséder quelqu'un, sinon quelque chose de quelqu'un, n'est-elle
pas pure folie ?
De même que l'amoureux se trompe en croyant posséder celle qui est l'objet de son amour (Nicolas et Marianne, Liz et Frenhofer), de même que le peintre s'illusionne lorsqu'il croit s'emparer des secrets intimes de son modèle en la regardant, lentement, avidement, et de si prés, en la re-produisant, l'artiste se fourvoie en croyant achevée l'oeuvre qui le maintient en vie. C'est sur cette leçon, laissée ouverte, sur les possessions impossibles que le film prend soin de ne pas se clore, avec douceur et en bon terme avec son intelligence, en ne montrant pas le tableau achevé, en posant comme anecdotique le désir de vouloir s'affranchir par le regard d'un travail accompli. C'est cette fin ouverte qui donne à La Belle Noiseuse son horizon, sa respiration, cette façon de vouloir croire un peu encore à cette illusion d'une oeuvre à faire, alors que tout dans son cheminement repose sur une bien plus grande liberté, sur un pari bien plus risqué : laisser le temps écrire le roman des hommes, celui de leurs amours, de leur attirance comme de leur répulsion, laisser à la mise en scène le soin de capturer sur la longueur les fils invisibles que tissent entre eux les êtres. Le film tient tout entier dans son tracé, jamais dans l'achèvement.
Passionnant document sur le travail de l'art en train de se faire, formidable projet d'un film en forme de "work in progress" guidé par ses instincts, tentative ébouriffante de rejoindre une fois encore par la pratique l'axiome que Rivette, jeune critique aux Cahiers du cinéma, avait posé sur le cinéma suivant lequel "tout film est un documentaire sur son propre tournage" (belle idée fixe, qu'il ne trompera jamais), idéal exemple d'un cinéma moderne épris d'image-temps selon la découpe deleuzienne, La Belle Noiseuse (adapté d'un texte de Balzac, Le Chef-d'oeuvre inconnu) est, l'un dans l'autre, un des films les plus courageux qui soient sur les passions humaines et leur mise à nu.
Jacques Rivette, Le Monde, 23 avril 2002, entretien avec Jean-Michel Frodon :
« Il y a la version longue, pour le cinéma, et la version courte,
appelée Divertimento, pour la télévision. Il ne s'agit
pas que de coupes, j'ai monté d'autres prises des mêmes scènes,
ce qui fait un film très différent. Et les contraintes du raccourcissement
(de 240 à 120 minutes) changent l'esprit du récit, la place
et l'enjeu du travail du peintre, l'importance du personnage de Jane Birkin...
Il y a deux oeuvres différentes à l'arrivée. »
« On pense que c’est un intellectuel, un éternel étudiant. Pas du tout. Il est très ludique et il a une main de fer. Je l’ai baptisé “le moine gai”. » C’est ainsi que Michel Piccoli décrivit Jacques Rivette, qui venait de le diriger dans LA BELLE NOISEUSE. Une collaboration que le comédien n’espérait plus : « Je croyais ne pas faire partie de son monde. » Aussi, lorsque Martine Marignac, productrice de tous les films de Rivette depuis LE PONT DU NORD (1982), annonça à Piccoli que le cinéaste songeait à lui confier le rôle principal de LA BELLE NOISEUSE, l’acteur s’empressa de répondre : « Dis à Jacques que je fais le peintre ou le modèle, ça m’est complètement égal ! »