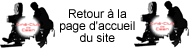|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
1600

1948

1963

1973

1980

1987

1990

1996

2002
Scène I — Relève de la garde à Elseneur par une froide nuit d'hiver. À minuit, l'officier Bernardo remplace le soldat Francisco. Il est rejoint par Marcellus, officier de la garde et Horatio, ami d'Hamlet. Ils aperçoivent le spectre muet du roi défunt et se rappellent les exploits de celui-ci : il a vaincu le roi de Norvège Fortinbras au cours d'un combat chevaleresque, emportant toutes ses terres par un pacte conclu à l'avance. Le Danemark se prépare à la guerre, car le fils de Fortinbras rassemble des troupes aux frontières pour reprendre les terres de son père.
Scène II — Château d'Elseneur. Le roi Claudius envoie Cornélius et Valtemand chez le roi de Norvège pour qu'ils mettent fin aux agissements de son neveu, le jeune Fortinbras. Claudius permet à Laërte, fils de Polonius, de retourner étudier en France mais refuse à Hamlet de retourner étudier à Wittemberg. Hamlet est amer car son oncle s'est marié avec sa mère peu après les funérailles de son père. Bernardo, Marcellus et Horatio révèlent la vision du spectre à Hamlet qui se résout à le voir lui-même.
Scène III — Laërte, sur le départ, met sa sœur Ophélie en garde contre les avances d'Hamlet. Polonius fait de même.
Scène IV — Minuit. Horatio, Marcellus et Hamlet aperçoivent le spectre qui fait signe à Hamlet de le suivre seul. Horatio et Marcellus suivent Hamlet en cachette.
Scène V — Le spectre du roi révèle à Hamlet que Claudius l'a assassiné en lui versant un poison dans les oreilles, après avoir commis l'adultère avec la reine ; le spectre demande à Hamlet de le venger mais d'épargner sa mère, puis il disparaît. Horatio et Marcellus rejoignent Hamlet et lui demandent de révéler ce qu'a dit le spectre. Hamlet refuse mais les prévient qu'il se fera désormais passer pour un fou et leur fait jurer de ne rien révéler de ce qu'ils ont vu cette nuit.
Scène I — Polonius envoie son serviteur Reynaldo à Paris pour espionner son fils dont la conduite laisse à désirer. Ophélie raconte à son père une scène où Hamlet lui a semblé agir comme un fou. Polonius décide de mettre Claudius au courant.
Scène II — Claudius et Gertrude, inquiets du comportement de Hamlet, envoient ses amis d'enfance, Rosencrantz et Guildenstern, auprès de celui-ci pour le ramener à la raison. Voltemand informe Claudius que le roi de Norvège a mis fin aux préparatifs du jeune Fortinbras et redirigé l'attaque contre la Pologne, sollicitant le droit de passer par le Danemark. Polonius explique à Claudius et Gertrude que la folie de Hamlet est due au fait qu'Ophélie a repoussé ses avances. Les dialogues de Hamlet avec Polonius, au cours duquel il compare Polonius à Jephté, puis avec Rosencrantz et Guildenstern, confirment les soupçons de folie. Entre alors une troupe de comédiens à qui Hamlet demande de jouer le lendemain le meurtre de Gonzague en y insérant une tirade écrite par lui. Dans un monologue, seul, Hamlet espère que la pièce amènera son oncle à avouer son crime.
Scène I — Claudius et Polonius assistent, cachés, au monologue To be or not to be de Hamlet puis au dialogue avec Ophélie où il lui reproche son immodestie et lui enjoint de rejoindre un couvent. Claudius projette d'envoyer Hamlet en Angleterre pour réclamer un tribut et le guérir, mais Polonius le persuade de laisser la reine lui parler avant de prendre une décision.
Scène II — Hamlet donne ses conseils aux comédiens et demande à Horatio d'observer la réaction du roi lors de la représentation. La pièce, qui raconte l'histoire d'un meurtre à Vienne, commence et Hamlet ne cesse de faire des commentaires tel un chœur antique. Claudius interrompt subitement la pièce au moment de l'empoisonnement et se retire avec la reine. Polonius convoque Hamlet auprès de la reine.
Scène III — Claudius, pressentant le danger, charge Rosencrantz et Guildenstern d'accompagner Hamlet en Angleterre. Seul, Claudius médite sur le meurtre de son frère et implore le ciel de lui pardonner. Hamlet le surprend mais décide de ne pas tuer Claudius à l'instant où il prie, pensant que cela l'enverrait au paradis, et reporte la vengeance à plus tard.
Scène IV — Hamlet reproche à sa mère son attitude et, à l'instant où il se fait plus violent, Polonius, qui écoutait secrètement, appelle à l'aide. Hamlet, pensant surprendre Claudius, se trompe et le tue. Hamlet accuse maintenant sa mère d'avoir tué son père. Le spectre du roi apparaît à Hamlet mais la reine ne le voit pas. Hamlet ordonne ironiquement à sa mère de révéler la supercherie de sa folie à Claudius. Elle jure de taire leur conversation. Hamlet s'en va avec le corps de Polonius, dans l'intention de répondre de sa mort.
Scène I — Gertrude raconte le meurtre de Polonius par Hamlet — mais pas la supercherie de la folie — à Claudius qui envoie Rosencrantz et Guildenstern se saisir du cadavre.
Scène II — Rosencrantz et Guildenstern s'enquièrent du corps de Polonius auprès de Hamlet qui répond de manière sibylline et demande qu'on le conduise auprès de Claudius.
Scène III — Hamlet comparaît devant Claudius qui réclame le corps de Polonius. Hamlet finit par indiquer l'endroit et feint de se résoudre à embarquer pour l'Angleterre. Dans un monologue, Claudius révèle qu'il a demandé au roi d'Angleterre de tuer Hamlet.
Scène IV — Hamlet rencontre Fortinbras en partance pour la Pologne et médite sur la futilité de la guerre.
Scène V — Dialogue énigmatique entre la reine, le roi et Ophélie qui semble avoir perdu la raison et chante. Laërte, persuadé que Claudius est responsable de la mort de son père, arrive avec une fronde pour renverser le roi. Claudius promet des explications.
Scène VI — Des marins remettent à Horatio une lettre de Hamlet, prisonnier de pirates, qui l'invite à le rejoindre.
Scène VII — Le roi, qui vient de révéler à Laërte que c'est Hamlet qui a tué son père, reçoit des lettres de Hamlet : une pour lui-même et l'autre pour la reine. Hamlet annonce son retour et le roi ourdit avec Laërte un assassinat maquillé en accident lors d'un combat d'escrime où l'épée de Laërte doit être empoisonnée ; si le stratagème échoue, Claudius promet de donner un breuvage empoisonné à Hamlet. La reine annonce qu'Ophélie est morte noyée.
Scène I — Deux fossoyeurs discutent le suicide apparent d'Ophélie alors qu'ils creusent sa tombe. Hamlet arrive avec Horatio et discute avec le fossoyeur d'un crâne qu'il a mis au jour, celui d'un bouffon de l'enfance de Hamlet, Yorick. La procession funéraire d'Ophélie approche, menée par Laërte. Lui et Hamlet en viennent aux mains, mais la bagarre est brisée.
Scène II — Hamlet raconte à Horatio comment il s'est échappé et comment Rosencrantz et Guildenstern sont morts. Un courtisan, Osric, les interrompt et invite Hamlet à se battre avec Laërte. Le combat commence alors que l'armée de Fortinbras se rapproche d'Elseneur. Laërte blesse Hamlet avec une lame empoisonnée, mais au cours d'un corps à corps ils échangent leurs armes, et Hamlet à son tour lui porte un coup que le poison rend fatal. Gertrude boit accidentellement du vin empoisonné et meurt. Dans ses derniers moments, Laërte se réconcilie avec Hamlet et révèle le complot meurtrier de Claudius. Avant de mourir, Hamlet parvient à tuer Claudius et nomme Fortinbras comme son héritier. Quand Fortinbras arrive, Horatio raconte l'histoire et Fortinbras ordonne de rendre hommage à Hamlet.
1900 : Clément Maurice, Le duel d'Hamlet. Avec : Sarah Bernhardt
(Hamlet), Pierre Magnier (Laertes), Suzanne Seylor (Un page). 2'
1907 : Georges Méliès (Film perdu).
1910 : William G. Barker, Hamlet. Avec : Charles Raymond.
1910 : Henri Desfontaines, France
1910 : Mario Caserini, Italie
1910 : August Blom, Danemark
1912 : André Calmettes, France
1912 : Hay Plumb, G.-B.
1912 : Charles Raymond, G.-B.
1914 : Arrigo Frusta, Italie
1914 : James Young, U.S.A.
1915 : W. P. Kellino, G.-B.
1916 : Earl Metcalfe, U.S.A
1916 : Fred Evans (Pimple as Hamlet) U.S.A., burlesque
1916 : Carmine Gallone, Italie
1917 : Eleutario Rodolfi, Italie
1919 : J. Franz, U.S.A., parodie
1920 : Svend Gade, Heinz Schall, Allemagne
1922 : Lau Lauritzen, Danemark, parodie
1925 : Robert Wiene, Autriche
1933 : Robert E. Johnes, Margaret Carrington, U.S.A.
1935 : Shorab Modi, Inde).
1937 : William Watson, U.S.A.).
1948 : Laurence Olivier. Hamlet.
Avec : Laurence Olivier (Hamlet), Eileen Herlie (Gertrude), Basil Sydney (Claudius),
Jean Simmons (Ophelia). 2h35.


1950 : Jorgen Roos, Danemark, c.m.
1952 : Giorgio Simonelli, Italie, parodie
1954 : Kishore Sahu, Inde).
1955 : Philip Dunne, U.S.A.).
1958 : Gene McKinney, G.-B., c.m.
1959 : Helmut Käutner, RFA, transposition
1959 : John Barnes, U.S.A., doc.
1960 : Franz Wirth, RFA
1960 : Akira Kurosawa (Les salauds dorment en paix), Japon, transposition
1963 : Claude Chabrol. Ophelia. Avec : Alida Valli (Claudia Lesurf), Claude Cerval (Adrien Lesurf),
André Jocelyn (Yvan Lesurf), Juliette Mayniel (Lucie). 1h35.


1964 : Gregori Kosintzev, Gamlet. Avec : Innokentiy Smoktunovskiy (Hamlet), Mikhail Nazvanov (Claudius), Elza Radzina (Gertrude), Yuri Tolubeyev (Polonius). 2h28.


1964 : Bill Colleran, John Gielgud, U.S.A.
1964 : Terry Bishop, Ghana
1968 : Enzo Castellari, Italie
1969 : Tony Richardson, G.-B.
1970 : David Giles.
Téléfilm BBC. Avec : Faith Brook (Gertrude), Susan Fleetwood (Ophelia), Ian McKellen (Hamlet), John Woodvine (Claudius)
1970 : Ozualdo Ribeira Candeias, Brésil
1973 : Carmelo Bene, Un Amleto di meno . Avec : Carmelo Bene (Hamlet), Luciana Cante (Gertrude), Sergio Di Giulio (William), Franco Leo (Horatio), Lydia Mancinelli (Kate), Luigi Mezzanotte (Laertes), Isabella Russo (Ophelia), Giuseppe Tuminelli (Polonius), Alfiero Vincenti (Claudius). 1h10.


1976 : Celestino Coronada, G.-B., m.m.
1980 : Rodney Bennett, Hamlet. Téléfilm BBC. Avec : Derek Jacobi (Hamlet), Patrick Stewart (Claudius), Claire Bloom (Gertrude). 3h40.


1983 : Rick Moranis, Dave Thomas, Canada-USA.
1987 : Aki Kaurismaki, Hamlet
goes business. Avec : Pirkka-Pekka Petelius (Hamlet), Kati Outinen (Ofelia),
Esko Salminen (Klaus), Elina Salo (Gertrud), Esko Nikkari (Polonius). 1h26.
transposition.


1990 : Franco Zeffirelli, Hamlet : Avec : Mel Gibson (Hamlet), Glenn Close (Gertrude), Alan Bates (Claudius),
Paul Scofield (le Fantôme), Ian Holm (Polonius), Helena Bonham Carter (Ophelia),
Stephen Dillane (Horatio), Nathaniel Parker (Laertes), Sean Murray (Guildenstern),
Michael Maloney (Rosencrantz). 2h15.
1990 : Tom Stoppard (Rosencrantz et Guildenstern sont morts, G.-B.
1990 : Mark Olomaker, U.S.A.
1992 : Natalya Orlova, Russie
1993 : John Mc Tiernan (Last action hero), U.S.A., citation du film de Laurence
Olivier.
1994 : Gabriel Axel, Prince of Jutland (Danemark).
1996 : Kenneth Branagh, Hamlet.
Avec : Kenneth Branagh (Hamlet), Riz Abbasi (l'assistant de Claudius), Richard
Attenborough (l'Ambassadeur anglais), Kate Winslet (Ophelia), David Blair
(l'assistant de Claudius). 2h05.
1999 : Andrew Tsao, U.S.A.
2000 : Michael Almereyda, U.S.A.
2002 : Peter Brook, The
tragedy of Hamlet. Téléfilm .Avec : Adrian Lester (Hamlet),
Jeffery Kissoon (Claudius, le spectre), Natasha Parry (Gertrude), Bruce Myers
(Polonius, le fossoyeur), Scott Handy (Horatio), Shantala Shivalingappa (Ophélie).


Brook coupe, comme d'habitude, dans le texte et renomme son film La Tragédie d'Hamlet, avec un casting de seulement huit acteurs dont Adrian Lester jeune acteur noir britannique.
![]() Comme
elle est très longue, il est rare que la pièce ne soit pas coupée.
La première grande question, la première grande ligne de partage,
quand il s'agit d'interpréter Hamlet est de savoir si la pièce
est "la tragédie d'un homme incapable d'agir", comme Laurence
Olivier le pose dès l'ouverture de son Hamlet (1948), ou le parcours d'un combattant luttant contre le monde ? Longtemps,
c'est l'image romantique et mélodramatique qui a prévalu : le
Hamlet en pourpoint de velours noir, le regard tourné vers ses tourments
intérieurs, tel que représenté par Eugène Delacroix
dans son Autoportrait
en Hamlet de 1821 et dans nombre de mises en scène du XIXe siècle.
Comme
elle est très longue, il est rare que la pièce ne soit pas coupée.
La première grande question, la première grande ligne de partage,
quand il s'agit d'interpréter Hamlet est de savoir si la pièce
est "la tragédie d'un homme incapable d'agir", comme Laurence
Olivier le pose dès l'ouverture de son Hamlet (1948), ou le parcours d'un combattant luttant contre le monde ? Longtemps,
c'est l'image romantique et mélodramatique qui a prévalu : le
Hamlet en pourpoint de velours noir, le regard tourné vers ses tourments
intérieurs, tel que représenté par Eugène Delacroix
dans son Autoportrait
en Hamlet de 1821 et dans nombre de mises en scène du XIXe siècle.
La décision de faire jouer Hamlet par une femme est souvent allée
dans ce sens d'une vision névrotique et fragile du personnage. Dès
le XVIIIe siècle, Hamlet a régulièrement été
interprété par une actrice, en Angleterre comme en France :
Sarah Siddons, lançant le mouvement outre-Manche dès 1777, a
été suivie, à partir de la fin du XIXe siècle,
au pays de Molière, par Sarah Bernhardt (dès 1886), bien sûr,
mais aussi par Suzanne Desprès (1913), Marguerite Jamois (1928) ou
Esmé Beringer (1938). En 2000, l'iconoclaste metteur en scène
allemand Peter Zadek confiait le rôle à l'actrice Angela Winkler.
Avec elle, Hamlet était un enfant observant froidement, autour de lui,
un monde plus médiocre que tragique, tout en gardant une forme d'innocence.
"Le théâtre dans le théâtre n'est pas pour
rien le centre et l'apogée de la pièce, remarquait Peter Zadek
au moment de la création de son spectacle. C'est comme dans la vie,
tous jouent des rôles comme des fous, pour empêcher que d'autres
les reconnaissent, et en espérant qu'ils détermineront ainsi
leur propre identité. Mon Hamlet vit dans un monde chaotique, un monde
d'apparence, il joue des rôles et observe d'autres personnes qui jouent
des rôles. Il interroge le monde, qui ne s'arrête jamais assez
longtemps pour donner des réponses convaincantes." Hamlet était
un enfant, encore, mais là rempli de larmes, dans la mise en scène
d'Antoine Vitez, qui elle aussi a fait date, en 1983. Richard Fontana portait
une douleur inguérissable, tout son corps appelant le moment de "se
perdre et se dissoudre en rosée", selon un vers de la pièce.
Mais, au XXe siècle, un certain nombre d'acteurs ont tranché
avec cette vision de la fragilité et de l'indécision d'Hamlet.
Dès 1964, Richard Burton livrait une magnifique interprétation
où il montrait le prince de Danemark comme un fauve en cage, électrisant
l'air autour de lui, puissant, pervers, moderne, en pull et pantalon noirs
– la version, signée par John Gielguld, a été filmée
et éditée en DVD aux Etats-Unis, des extraits en sont visibles
sur YouTube. En 1983, Bruno Ganz, dans la mise en scène de Klaus-Michael
Grüber, portait "une douleur inhumaine, contre laquelle il se défend[ait]
par la merveilleuse mécanique de l'intelligence, par une énergie
barbare qui éclat[ait] en colère rauque, s'égar[ait]
sur les chemins de fuite du sarcasme", écrivait la critique de
théâtre Colette Godard dans Le Monde du 13 janvier 1983. Et puis
il y a eu Gérard Desarthe dans la mise en scène historique de
Patrice Chéreau, en 1988. Dans la nuit d'Avignon, puis dans les clairs-obscurs
du Théâtre des Amandiers de Nanterre, c'était un Hamlet
qui tranchait absolument avec ce qu'on avait vu jusque-là, un cheval
noir et fou, d'une lucidité et d'une puissance inoubliables.
L'autre question centrale qui préside aux interprétations du
rôle, c'est de savoir si le héros de Shakespeare est fou, s'il
joue au fou ou si le rôle du fou finit par lui coller à la peau,
à force de le jouer. En 2008, quand il a monté "son"
Hamlet au Festival d'Avignon, le grand metteur en scène allemand Thomas
Ostermeier en a livré une vision saisissante, avec un Hamlet, interprété
par l'extraordinaire Lars Eidinger, dont on voyait la raison se fissurer sous
nos yeux.
"Souvent, on présente Hamlet en personnage romantique intègre
dans un monde corrompu, analysait Thomas Ostermeier au moment de la création.
Je ne pense pas que ce soit si simple et j'ai eu envie de me mettre en colère
contre Hamlet parce qu'il n'agit pas. J'avais envie de le violenter un peu
et de lui mettre un bon coup de pied aux fesses ! Ce qui m'intéresse
aussi, c'est l'éternel problème de la folie d'Hamlet, et j'ai
envie d'émettre l'hypothèse que la folie prend possession d'Hamlet
et qu'il ne peut plus se cacher derrière le masque du fou dont il s'est
couvert au début de la pièce." L'interprétation
du personnage était le reflet de la réflexion qui sous-tendait
la mise en scène : "On a dit qu'avec Hamlet on entrait dans la
période de l'homme moderne, de celui qui a la conscience de la complexité
des actions, dans une période où s'opposaient une société
de guerriers et une société de penseurs, d'intellectuels, précisait
Thomas Ostermeier. Cette conscience de la complexité des actions possibles
pourrait rendre les gens fous, de même que la philosophie des Lumières
en France, au XVIIIe siècle, a pu le faire en développant trop
le raisonnement. Trop réfléchir entraînerait obligatoirement
une paralysie de l'action. Il me semble que c'est un sujet très actuel
pour nous qui savons très bien analyser les problèmes nés
de l'injustice sociale mais qui n'arrivons pas vraiment à agir politiquement
et globalement contre. Cette non-action peut nous rendre fous, puisque nous
en avons conscience et que nous nous maintenons dans l'impuissance."
Denis Podalydès, dans la mise en scene de Dan Jemmett (2013) pense que la question de la démence d'Hamlet "doit rester indécidable". "Au début, il décide de manière volontariste d'endosser le manteau de la folie, remarque le comédien. Mais dans la scène avec sa mère, on a l'impression qu'il passe de l'autre côté du miroir. Ce qui est beau, et j'en reviens à la dimension de mise en abyme théâtrale de la pièce, c'est qu'Hamlet met à distance la folie par le théâtre, en jouant. Ce qui n'est pas le cas d'Ophélie : si elle sombre, elle, totalement, c'est parce qu'elle ne sait pas jouer, qu'elle n'est pas actrice du tout..." Folie du monde, qui rend ses enfants fous... de rage, d'impuissance blessée et meurtrière : c'était la vision du jeune metteur en scène Vincent Macaigne, dans l'adaptation fracassante qu'il a donnée de la pièce, au Festival d'Avignon de 2011, sous le titre Au moins j'aurai laissé un beau cadavre. Hamlet, joué par le jeune comédien Pascal Rénéric, s'y cognait, comme tous les personnages de jeunes gens de la pièce, contre un monde boursouflé d'insignifiance et de cynisme, ubuesque. Un Hamlet absolument d'aujourd'hui, détruit par ce monde "hors de ses gonds" qui est le nôtre, comme au temps de Shakespeare. Hamlet est toujours là, quand il s'agit de dire qu'il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark.
Fabienne Darge, Hamlet, avatars d'un prince, Le Monde du 3 octobre 2013.
Hommages et parodies
Dans To be or not to be (Ernst Lubitsch, 1941), le jeune lieutenant aviateur (Robert Stack ) quitte chaque soir sa place pour filer dans la loge de la belle Maria Tura, dès que Joseph Tura, le mari, attaque le grand monologue de Hamlet, "To be or not to be".
La poursuite infernale (John Ford, 1946). Doc termine le monologue de Hamlet à la place d'un acteur shakespearien à la mémoire défaillante qui est obligé d'interpréter le rôle devant des cow-boys hostiles.


Dans Docteur Jerry
et mister Love (Jerry Lewis, 1963) Warfield, le directeur de l'université,
se ridiculise en interprétant Hamlet face à Love qui le fait monter
sur la table, l'éclaire avec le lustre de la pièce, lui fait porter un parapluie
en guise d'épée et un chapeau cassé pour la couronne et qui le secoue jusque
lui faire baisser son pantalon.