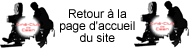|
|
|
|
|
L'homme à la caméra



 Les cartons du
générique annoncent le film comme étant le journal de
bord, d'un opérateur de cinématographe, un essai de diffusion
cinématographique de scènes visuelles, sans recours aux intertitres,
à un scénario, à des décors ou des acteurs. Cette
œuvre expérimentale a pour but de créer un langage cinématographique
absolu et universel complètement libéré du langage théâtral
ou littéraire.
Les cartons du
générique annoncent le film comme étant le journal de
bord, d'un opérateur de cinématographe, un essai de diffusion
cinématographique de scènes visuelles, sans recours aux intertitres,
à un scénario, à des décors ou des acteurs. Cette
œuvre expérimentale a pour but de créer un langage cinématographique
absolu et universel complètement libéré du langage théâtral
ou littéraire.
Prologue : une caméra géante, un opérateur surgit sur elle et enregistre l'avancée des nuages sur un immeuble. Il s'en va et pénètre dans une salle de cinéma. Le projectionniste prépare la séance. La salle est vide. Il place la bobine sur le projecteur, prépare l'allumage des charbons. L'ouvreuse (elle porte une montre) ouvre le rideau, défait le cordon qui condamnait la porte et se déplace sur la gauche permettant aux spectateurs d'entrer dans la salle. Les fauteuils s'animent, semblent attendre les spectateurs. Les musiciens, immobiles devant les instruments, se préparent. Les charbons se touchent et, quand la lumière surgit, les musiciens jouent leur partition.
1-La projection commence par un travelling avant sur une fenêtre. À ce premier plan répond un lampadaire. Par le montage, la jeune fille endormie est reliée à la ville. Les mendiants sont couchés sur des bancs, les cochers dans leur fiacre, les nouveau-nés dans la maternité. Mannequins inanimés dans une vitrine. Comme les humains, les objets sont au repos : le boulier, l'ascenseur, la machine à taper, l'automobile, la fileuse, les automates sont inertes comme le loup empaillé. Seul le vent dans les arbres anime certains plans. Dans la chambre de la jeune fille une reproduction du Pécheur, tableau de Vassili Pérov une affiche où L'homme, d'un doigt sur la bouche, ordonne le silence. Immobile, la bague de la jeune femme indique qu'elle dort. Sur la place des Maréchaux de Moscou, vide, une banderole porte le nom de Maxime Gorki.
Une automobile vient chercher le cameraman à son hôtel. L'affiche de l'homme ordonnant le silence est à nouveau montrée, comme pour souligner que la ville reste plongée dans le sommeil. L'opérateur prend des risques en filmant, l'œil sur les rails, l'arrivée du train. Son pied heurte un rail. La femme se réveille. L'opérateur est sain et sauf. Le train tout juste passé. La jeune femme se lève brusquement et s'habille pendant que le caméraman s'éloigne. Habillée, elle fait sa toilette pendant que la ville est nettoyée à grandes eaux. Le réveil de la femme s'accompagne de celui des mendiants qui fixent l'objectif, souriants ou indifférents à cette présence du cinéma. Toute la ville se réveille. L'image qui montre une femme endormie sur un banc relève du voyeurisme, comme le montre le gros plan sur ses jambes et son agacement en découvrant la caméra. A cette occasion, apparaît pour la première fois l'image de l'œil sur la caméra. Dans la chambre, les battements de paupières de la femme renvoient aux stores qui s'ouvrent et se referment. La vision floue et la mise au point de la caméra retrouvent la sensibilité de l'œil humain. Le cameraman passe devant l'affiche Le réveil de la femme (1927), présentée dans son intégralité à la devanture d'un cinéma. Les tramways circulent de plus en plus, la place est pleine. La journée de travail peut commencer.
Tandis que le cameraman grimpe en haut d'une cheminée d'usine, toutes les machines se mettent en marche. Le téléphone, le boulier, la fileuse, les automates que l'on avait vus au repos sont actionnés. On suit le mouvement du charbon, de son extraction dans les mines à sa combustion dans les cheminées d'usine. Le cameraman est montré aussi bien en haut d'un échafaudage qu'au milieu de la foule où il suit la tenue du marché en s'intéressant aux visages de femmes et à leurs discussions.
Revenant de la gare, Mikhaïl Kaufman suit les bourgeois (dont la NEEP a permis l'émergence) en calèche à partir d'une voiture décapotable. Brusquement, les images se figent. Des plans fixes se succèdent avant que n'apparaissent des bandes de pellicules perforées dans la salle de montage où officie Elizaveta Svilova. La monteuse s'active tandis que le cameraman court la ville. Elle observe les images qu'elle coupe, anime et annote avant de les déposer sur des étagères portant les inscriptions "circulation de la ville", "usine", "machines", "bazar". Sur les pellicules déployées, on peut voir le visage de la jeune femme qui appellera les secours au moment de l'accident et les enfants que l'on retrouvera lors de la séquence du magicien chinois. Le film reprend son cours là où il s'était arrêté.
Un bureau de mariage et de divorce. On passe d'un plan d'ensemble où les nouveaux mariés officialisent leur union à un découpage en gros plans sur les visages de l'homme et de la femme qui divorcent après que la caméra se soit brusquement retournée. Une image réunit deux rues différentes et un plan d'ensemble montre deux tramways qui se séparent comme en écho à cette séquence. Le visage caché d'une femme au bureau de mariage est suivi par une vieille dame au cimetière enfouissant sa tête dans son bras. Les fleurs d'un enterrement renvoient au bouquet que porte une jeune mariée qui descend de la calèche avant que n'apparaisse l'image d'un accouchement qui devient un élément central de la composition. C'est autour de cet épisode que sont montrés le retour de la mariée dans la calèche et la suite des funérailles filmées en plan d'ensemble.
À travers ces plans, Vertov résume le cycle d'une vie : naissance, mariage, enterrement, deuil. En suivent d'autres sur la circulation de la ville. Une séquence met en avant les figures géométriques qui résultent de ce ballet : les tramways se croisent à l'horizontale quand l'ascenseur monte et descend, l'ombre de la porte devant laquelle passent les clients de l'hôtel réunit un demi-cercle et un rectangle, des ballons devant un tramway introduisent des cercles. Vertov va jusqu'à diviser un plan en deux pour créer un angle.
Un œil mobile est montré en contrechamp aux plans de la ville. Sans qu'il soit établi une relation de cause à effet, on peut voir dans ce regard celui de l'homme qui sera bientôt accidenté. La serviette qui entoure sa tête résonne avec la coiffe sophistiquée que porte une jeune femme qui cache son visage au bureau de mariage, comme le fera plus tard une cliente dans l'institut de beauté.
Le cinéaste entrecoupe les plans de soins esthétiques par l'image de mains lavant le linge. Plus que l'attrait des visages, c'est le travail des mains qui intéresse Vertov. À travers celles-ci, des analogies s'établissent. Ainsi peut-on voir le rasoir du barbier et la hache du bûcheron qui sont tous deux affûtés horizontalement, le mouvement de rotation du séchoir et le geste du cameraman qui tourne la manivelle. Le travail de la monteuse est assimilé à d'autres gestes, comme celui des couturières, des esthéticiennes, des manutentionnaires ou des standardistes. Après l'œil qui observait la ville, le film rend hommage à la main qui s'active pour confectionner des objets.
À ce travail tertiaire répond le travail primaire de la mine et celui, secondaire, de la sidérurgie. Un rapport de taille met en relation le gros plan sur le paquet de cigarettes et le caisson en bois qui transporte l'opérateur. De même le roulis du fleuve résonne avec le tournoiement de la fileuse. La forme et le mouvement créent une analogie entre les images. Le cameraman apparaît au milieu de machines qui s'emballent dans un rythme effréné. Si le train marquait la fin du sommeil, ce chaos d'images annonce le terme du travail. En fin d'après-midi, les ouvriers stoppent leur outil et se nettoient le visage et le corps pour entamer la dernière partie de la journée.
Au train qui marquait le réveil de la ville répond le départ du paquebot pour Odessa (dans les premiers plans, une agence de voyage proposait une traversée sur le bateau "Lénine"). Avant que le cameraman n'arrive à Odessa, des corps allongés sont montrés sur la plage. Des nageurs s'entraînent sur la terre ferme puis dans l'eau, le magicien répète les tours qu'il accomplira devant les enfants, les chevaux de bois apparaissent sous la bâche du manège. Le journal mural, Le Réalisateur, évoque les loisirs. Les exploits sportifs sont montrés à travers des ralentis et des arrêts sur image. On voit une alternance du masculin au féminin entre les spectateurs ou spectatrices et les sportifs ou sportives. Mais aussi un passage entre le plan d'ensemble au ralenti sur les athlètes et le gros plan à vitesse normale sur les visages des spectateurs. Ces derniers sont mis en valeur.
Le cameraman débarque avec les passagers du paquebot. Plus tard, il prend un bain de boue sans quitter sa caméra. Une femme mûre s'applique avec précaution du rouge à lèvres sur le visage quand des jeunes filles se couvrent le corps de boue pour se protéger du soleil. Ce parallèle rappelle un passage dans l'institut de beauté où des femmes riches étaient rattachées par le montage à une vieille dame travaillant la boue. D'autres plans montrent des cures d'amaigrissement. Le magicien chinois accomplit ses tours devant les enfants. Dans le public, on reconnaît les deux frères ainsi que la petite fille aux boucles noires dont les rushes étaient vus dans la salle de montage
Le manège des chevaux de bois est mis en parallèle avec le circuit de motos. Le cameraman est montré en train de participer à l'un comme à l'autre. La conduite professionnelle est ainsi mise en relation avec un mécanisme automatique dans un même mouvement de rotation. Plusieurs sports sont convoqués : l'haltérophilie, le basket-ball, le javelot, le football, le saut en longueur. La pellicule se déchire comme rompue par un effort démesuré.
On revient au cinéma avec La Jeune Manuela (Dupont, Allemagne, 1923) que programme une salle qui a pour nom Le Prolétaire. Dans un bar à bière, une écrevisse s'échappe d'une assiette comme si elle était consciente de la menace qui l'attend et que semble ignorer une femme entourée d'hommes. Les bouteilles se suivent sous l'œil d'une affiche représentant un visage de femme. Tenant une coupe de champagne, celle-ci semble trinquer. La mousse des bouteilles lui dessine une larme sous l'œil. Son nez et sa bouche reçoivent régulièrement des éclaboussures. Comme en écho à la bouteille géante au début du film, le cameraman apparaît dans un verre à bière qui se remplit. Au terme de la séquence, la caméra titube comme sous l'effet de l'alcool.
Près d'une église désaffectée, on trouve le Club Vladimir Ilitch Oulianov de la gare d'Odessa où des jeunes gens lisent des journaux, jouent aux échecs ou aux dames. Dans un stand de tir, Vertov anticipe sur le contexte politique international en montrant une croix gammée et un slogan antifasciste sur lesquels s'exerce une jeune fille à chignon. Le cinéaste semble opposer une autre tireuse aux cheveux courts à la femme du bar en remplaçant les figurines fascistes par une rangée de bouteilles. La lutte contre l'alcoolisme revient ainsi à plusieurs reprises. De façon significative, Mikhaïl Kaufman quitte un marchand d'alcools pour entrer dans le Club culturel Lénine du Premier Plan (Yalta). Ce club est équipé d'un poste de radio. Le son est personnifié : à l'accordéon succèdent le chant et le piano. Une musique populaire d'objets est improvisée au milieu des bouteilles et des cuillères et rassemble différentes personnes.
Ce chaos d'images est suivi d'un premier retour dans la salle de cinéma avec la caméra qui vient saluer les spectateurs en tournant sa manivelle. Dans un cours de danse, l'image est divisée en quatre avec une action simultanée qui réunit le piano, les danseuses et la professeur. À cette danse classique répond un cours de jazz.
Les images se répètent dans la salle de cinéma. On retrouve le cameraman sur sa moto, le train qui fonce vers les spectateurs, la circulation des tramways. Le théâtre du Bolchoï, symbole de l'art académique, se brise en deux. L'horloge s'affole. Le rideau s'ouvre comme pour signifier une nouvelle ère. À partir de ce moment, les plans seront en accéléré. Vertov semble vouloir anticiper la naissance d'un nouvel art et d'une nouvelle société. Le cameraman apparaît dans la voiture d'où il suivait les bourgeois en calèche. Le public de la salle répond à la foule de l'écran. On retrouve la monteuse Elizaveta Svilova dont les yeux se confondent avec les panneaux de signalisation de la place des Maréchaux. L'œil sur l'objectif se referme avec le diaphragme.


 L'homme
à la caméra est l'expression la plus achevée de ce
que Dziga Vertov attend à la fois du cinéma et de la vie après
la révolution russe d'octobre 1917. Dans le manifeste Nous
(1922) et Kinok. revolution (1923) et
dans le film ciné œil de 1924, il
avait déjà proposé la définition d'un cinéma
et d'un homme nouveau. Bien moins théorique, ce film-ci essaie d'entraîner
le spectateur à devenir un homme nouveau en lui faisant ressentir
une nouvelle façon de voir le monde s'il accepte de devenir un ciné-œil.
L'homme
à la caméra est l'expression la plus achevée de ce
que Dziga Vertov attend à la fois du cinéma et de la vie après
la révolution russe d'octobre 1917. Dans le manifeste Nous
(1922) et Kinok. revolution (1923) et
dans le film ciné œil de 1924, il
avait déjà proposé la définition d'un cinéma
et d'un homme nouveau. Bien moins théorique, ce film-ci essaie d'entraîner
le spectateur à devenir un homme nouveau en lui faisant ressentir
une nouvelle façon de voir le monde s'il accepte de devenir un ciné-œil.
Le spectateur transformé
C'est en effet à une véritable expérience sensorielle qu'est appelé le spectateur qui le transformera en kinok, homme à la caméra des temps modernes. Au début, le spectateur entre dans la salle, inconscient des pouvoirs du cinéma. L'homme à la caméra, Prométhée moderne, lui a ramené les images du ciel. Le projectionniste lui a préparé la séance. Même les sièges sont prêts à recevoir le spectateur. Mais celui-ci est encore passif et attend simplement que la lumière s'éteigne. Avec l'expérience de la projection, le spectateur pourra, ainsi le montre l'apothéose finale, partager l'émotion de l'homme à la caméra, et sera lui-même devenu un kinok.
Devenir un ciné-œil suppose que l'on soit soit prêt à se défaire des habitudes anciennes, à prendre des risques, à s'émerveiller et tirer partie de ce que l'on voit. Les plans des spectateurs regardant le sport et des enfants regardant le magicien préfigurent les spectateurs de cinéma attentifs. A ces conditions seulement, on pourra voir le monde autrement.
L'homme moderne est à la fois un géant, capable de prendre de la hauteur (plan initial puis lors de la séance avec laquelle débutent les loisirs du soir dont le cinéma). C'est aussi un homme capable de se glisser dans les objets et d'en saisir la perception (verre de bière). C'est enfin un homme en forme qui prend des risques (couché sur les rails, sous les brouettes des travailleurs, escaladant les échafaudages, une cheminée d'usine, se rapprochant des hauts fourneaux, suspendu sur un barrage, poursuivant ambulance et pompiers, descendant dans la mine, filmant au milieu de la circulation alors que le danger est manifesté par le klaxon de la voiture). D'où l'importance considérable accordée dans le film à la toilette, aux soins du corps et au sport.
Cette prise de risques permet de voir le monde autrement : ce que l'on croyait séparé, participe du mouvement de la vie. L'essentiel des gestes de montage consiste à suggérer des ressemblances et des connections de manière à former une continuité permanente ainsi qu'à proposer des métaphores stylistiques. Les ressemblances suggérées sont ainsi objectives (forme, trajets, fonction) ou subjectives (identité d'impression, coexistence, causalité) et presque toujours s'opposent à nos habitudes intellectuelles (par exemple nous sommes habitués à voir plutôt une opposition entre le fait d'entrer et de sortir ou bien entre naître et mourir).
Une bonne partie de ces couples apparaissent en lutte contre la fausse différence. Ce que l'on croit autre ou en opposition est en réalité similaire lorsqu'on le regarde à une autre échelle, conceptuelle et non plus fonctionnelle. Fausse différence entre le corps biologique et l'objet mécanique. Le corps humain s'entretient comme une ville ou comme une machine ainsi des plans alternés entre la jeune femme faisant sa toilette et les employés municipaux lavant à grande eau le mobilier urbain ou fonctionne comme une machine : la jeune femme bat des paupières et les persiennes inclinent leurs lamelles, équivalence entre aiguiser un rasoir ou une hache, cirer ses chaussures, et limer des ongles, la paysanne qui lave du linge dans une bassine et les cheveux lavés dans le salon de coiffure.
Fausse différence, à une plus large échelle encore, entre objets naturels et artefacts créés par l'humain, ainsi du bouillonnement d'une chute d'eau et le bouillonnement des bobines de fils sur le métier à tisser rotatif ou mise en parallèle de l'eau qui suit la déclinaison arrondie d'une chute et le papier qui passe entre les cylindres d'une rotative. La surimpression est souvent utilisée pour associer l'organique et le machinique. L'œil sur l'objectif est l'image la plus célèbre. On peut citer par ailleurs l'oreille et la bouche sur le phonogramme comme un autre rapprochement de l'organique et du machinique, mais aussi le visage de la secrétaire sur le clavier de la machine à écrire ou celui de la fileuse dans le cercle du métier à tisser. Ces surimpressions peuvent s'accompagner de changements d'échelles : le cameraman apparaît dans un verre à bière qui se remplit, de la même manière qu'il domine la foule innombrable qui se déplace à ses pieds à la fin du film. La surimpression peut concerner plus de deux images, comme la scène qui réunit cuillères, bouteilles et pianos dans un café.
Fausse différence entre les lieux de transit (panneau dans un carrefour, et aiguillage d'une porte à tambour) et les comportements qu'ils induisent (entrer / sortir ; arriver / partir ; monter/descendre; se croiser/ aller dans le même sens).
Fausse différence entre les grandes étapes de la vie (signature d'un certificat de mariage / signature d'un certificat de divorce) (on enterre un défunt / le bébé naît).
Des éléments que l'on croyait ainsi, par habitude de pensée, indépendants l'un de l'autre, sont en réalité liés par la causalité, mais à condition de prendre de la hauteur ou tout autre point de vue défamiliarisant.
De l'oeil humain à l'oeil machine.
Cette transformation du spectateur est possible car il existe une correspondance entre l'oeil humain et l'homme machine. Toutes les possibilités du vrai cinéma sont offertes alors au spectateur/homme moderne.
L'oeil accommode sa vision comme l'objectif de la caméra. Les persiennes qui s'ouvrent plus ou moins sur l'arbre dans la cour sont une métaphore de la paupière qui s'ouvre plus ou moins. Tout comme l'objectif effectue sa mise au point pour obtenir des images de fleurs plus ou moins floues ou nettes, la jeune femme accommode ses yeux à la lumière.
Plus essentiellement, le cinéma a les moyens techniques de décrire la vie. C'est ce qu'il prouve en se confrontant à l'expérience d'une journée de la vie d'un soviétique. Le matin, au repos, ce sont des plans fixes. Ce qui n'empêche pas des rapprochements saugrenus, comme des images mentales du sommeil : le cou d'une femme puis les arbres balayés par le grand vent ou même l'humour. Alors que la jeune femme s'est réveillée, le ciné œil nous fait découvrir sur un mur, l'affiche du film aperçue trois fois et qui s'intitule Le réveil d'une femme (Das Erwachen des Weibes de Fred Sauer, 1927). Cette découverte tardive fonctionne comme un clin d'oeil au spectateur.
Quand la jeune fille se lève, le monde se révèle en pleine activité (accéléré) avec multiplication des points de vue (split screen horizontaux et verticaux surimpressions et décadrages) le regard malade (perte des repères), l'observation attentive (le ralenti sur les sportifs).
Le soir c'est est fini des dangers de la journée et vient le temps de l'amusement Vertov multiplie alors les effets : rembobinage (partie de dames et d'échecs) incrustations (image dans l'image pour évoquer ce que l'on écoute) et animations. Certes, dès le début, les sièges qui se déplient dans la salle de cinéma pour accueillir les spectateurs sont des séquences animées. Bien plus élaborés cependant sont, au moment des loisirs, les quilles qui se rassemblent pour former un carré, le journal géant qui se hisse de lui-même sur le mur, l'écrevisse s'échappant d'un plat, les bouteilles disparaissant dans le stand de tir. Enfin, la caméra sort de sa boîte pour s'installer sur son trépied et saluer les spectateurs.
Par ces procédés, Vertov rend grâce à la magie du cinéma, à son pouvoir d'émerveiller comme un magicien émerveille les enfants.
L'oeil machine est celui du vrai cinéma
Cette vitalité du monde que la caméra peut saisir comme un oeil neuf n'est possible que lorsque le cinéaste s'en empare sans la parer d'un faux drame, de scénario, d'intertitres contraignants. C'est ce qu'indique le générique
L'homme à la caméra, enregistrement sur pellicule en 6 bobines, production VOUFKOU, 1929, extrait du journal de bord d'un opérateur de cinématographe. A l'attention des spectateurs. Le film que vous allez voir est un essai de diffusion cinématographique de scènes visuelles. Sans recours aux intertitres (le film n'a pas d'intertitres), sans recours à un scénario (le film n'a pas de scénario), sans recours au théâtre (le film n'a pas de décor, pas d'acteurs, etc.) Cette œuvre expérimentale a pour but de créer un langage cinématographique absolu et universel complètement libéré du langage théâtral ou littéraire. Auteur et conducteur de l'expérimentation : Dziga VERTOV, chef opérateur : M. Kaufman, assistante monteuse : E. Svilova.
Les scènes visuelles doivent donc avoir été prises sur le vif dans des limites que Vertov indique. Celle du voyeurisme d'abord ; Parmi les personnes endormies qui s'éveillent, la caméra vient filmer une jeune femme endormie sur un banc. Alors qu'elle dort encore, un plan rapproché se concentre tout particulièrement sur les jambes que la jupe retroussée permet de voir. Réveillée, la femme réagit à la caméra comme à un regard d'homme indiscret, elle a une mimique d'agacement et part rapidement.
De plus, la présence d'une caméra sur les lieux transforme le monde autour d'elle. L'expression "la vie en flagrant délit" annonce aussi la difficulté de ceci : la possible réticence de cette vie à être saisie par la caméra. Après le couple qui se marie et celui qui divorce, nous découvrons devant le même guichet un couple dont nous ne savons pas quels documents il signe. Alors que l'homme jette des regards amusés vers la caméra, la femme se cache le visage avec une main. Le ciné œil ne fuit pas devant cette réticence, mais la fixe au contraire. Cette réaction du monde à la présence de la caméra était pensée par Vertov dès l'origine du projet : "Où qu'il apparaisse, les curieux entourent immédiatement d'un cercle étanche la caméra, regardent dans l'objectif, touchent et ouvrent les boîtiers avec la pellicule."
Le travail de la monteuse est de retrouver des correspondances que l'opérateur à su saisir sur le vif. Son travail est d'objectiver ces correspondances en rapprochant les objets filmés. Le film recueille en effet des plans de Moscou, de Kiev, de Kharkov, mais aussi d'Odessa (Club Lénine, tramways, plages) de Yalta (Club du premier plan) et du Dniepr (le barrage). Les plans de Moscou sont identifiables par leurs monuments : on reconnaît la façade de l'hôtel Métropole, le carrefour de la place des Maréchaux, le théâtre du Bolchoï, les bureaux des Izvestia.
Vertov avait affirmé cette possibilité du cinéma en déclarant : "Aujourd'hui, en l'an 1923, tu marches dans une rue de Chicago et je te force à saluer le camarade Volodarski qui marche, en 1918, dans une rue de Petrograd et ne répond pas à ton salut"." Par cette pratique, le cinéaste établit des relations dans le temps et l'espace, faisant du "ciné-œil" un "constructeur".
Une transformation contestable et une critique peu visible
Dziga Vertov considère que le travail du cinéma est d'interpréter le réel pour le spectateur. Au chaos de la vision humaine, il oppose la vision organisée du ciné œil (fusion parfaite entre les possibilités techniques d'une caméra et la capacité d'interprétation idéologique de l'être humain), la caméra doit selon lui "entraîner" l'oeil du spectateur.
Vertov bien souvent assimile ainsi l'homme à la machine. Cette mise en relation de différents niveaux - souterrain, terrien et aérien - est caractéristique du cinéaste, comme le montrait déjà La Onzième Année et se rapproche des futuristes italiens. Cette apologie de la machine non plus folle mais maîtrisée est à contre-courant des dénonciations de la machine dans Les temps modernes (Chaplin, 1936) ou des propositions moins héroïques tel le burlesque Cameraman (Keaton, 1928).
Les séquence de la femme à la malle, des bourgeois en calèche, la différence entre les activités des bourgeois dont il faut s'occuper (les maquiller, les raser, les coiffer) et les ouvriers actifs puis entre plaisirs alcoolisés et ceux que l'on trouve dans le club communiste peuvent donner lieu à une lecture politique critique contre la NEP. Ils sont toutefois seulement signalés et passent après l'idée que tous concourent au même mouvement.
Avec son "montage des attractions" Sergei Eisenstein se veut plus percutant. Il veut "rendre compréhensible le message, la conclusion idéologique de l'oeuvre". Il veut surprendre le spectateur par une association d'images inattendue, mais également s'assurer que, par cette juxtaposition même, le sens de ce que voit le spectateur devient univoque et parfaitement compréhensible.
"Le montage des attractions", premier manifeste d'Eisenstein, est publié dans le troisième numéro de la revue Lef, en même temps que le texte Kinoks - Révolution de Vertov. Les deux hommes semblent alors proches et ce d'autant plus que la même année Sergueï Eisenstein réalise son premier court métrage, Le Journal de Gloumov, supervisé par Vertov, pour la pièce de théâtre Un Sage d'Alexandre Ostrovsky.
La situation évolue l'année suivante avec leur premier long métrage, La grève, et Ciné-oeil. Vertov reproche à Eisenstein d'emprunter des éléments au Ciné-œil pour l'appliquer au cinéma de fiction, abandonnant les faits pour l'art. Eisenstein lui répond :
"Le Ciné-oeil n'est pas seulement le symbole d'une vision, mais aussi d'une contemplation. Or, nous ne devons pas contempler, mais agir. Ce n'est pas un Ciné-œil qu'il nous faut, mais un Ciné-poing. Le cinéma soviétique doit fendre les crânes ! Et ce n'est pas "par le regard réuni de millions d'yeux que nous lutterons contre le monde bourgeois"
Dans La grève (1924) le "montage des attractions " s'incarne dans le montage parallèle rapprochait les images d'ouvriers fuyant devant la force armée de celles d'une boucherie. Mais là où Eisenstein tient à la lisibilité métaphorique, symbolique, voire linguistique du raccord, Vertov fonctionne plus par des associations d'images. Mais les effets de rupture forment également un dessin rythmique essentiel pour Vertov qui parle alors d'intervalles. Dans sa définition, l'intervalle est " le passage d'un mouvement à un autre ". Les intervalles créent ainsi le tracé rythmique du film, pris entre deux pôles extrêmes (immobilisation et mouvement étourdissant). Mais il serait erroné de comprendre l'intervalle comme un élément seulement rythmique. Il rend également compte des hiatus visuels et même sensuels entre images qui permettent de rapprocher des éléments a priori incompatibles comme un insert sur le cou d'une femme endormie et le plan d'une place déserte (corps humain contre lieu vide, plan très rapproché contre plan large, plan immobile contre mouvement du vent dans les arbres).
Tous deux se réclament de l'art révolutionnaire hérité d'Octobre, mais divergent sur le recours ou non à la fiction. Comme La grève, Le Cuirassé Potemkine (1925) emprunte, selon Vertov, des éléments au ciné-œil. L'utilisation d'un acteur dans le rôle de Lénine pour Octobre (1927) provoque une polémique. Dans Mon Octobre, Eisenstein défendra son choix en parlant d'un cinéma "par-delà le joué et le non joué". À propos de l'utilisation du ralenti dans L'Homme à la caméra, Eisenstein écrit : "il ne s'agit que de coq-à-l'âne formalistes et de pitreries gratuites dans l'emploi de la caméra". De son côté, Vertov parlera de son film comme un pas supplémentaire vers un "Octobre de la non-fiction" . Cette opposition est caractéristique des années 1920, quand l'art révolutionnaire s'interrogeait sur la forme qu'il devait prendre, avant que l'État soviétique n'établisse une esthétique officielle avec le réalisme socialiste qui condamnera aussi bien le formalisme de Vertov que celui d'Eisenstein.
L'influence de L'homme à la caméra est perceptible dans À propos de Nice de Jean Vigo (1930) dont le cameraman Boris Kaufman n'est autre que le plus jeune frère de Dziga Vertov. Sous-titré " Point de vue documenté ", le film cite L'homme à la caméra à travers le plan du cireur de chaussures, les cheminées d'usine ou le travail sidérurgique. L'approche sociale est là aussi nettement plus critique que celle de Vertov.
Vertov marginalisé et réhabilité.
Les films de Vertov ont suscité un grand intérêt en Europe. En novembre 1925, Ciné œil obtient la médaille d'argent à l'Exposition universelle de Paris. Chaplin félicite Vertov pour Enthousiasme ou La symphonie du Donbass. A peine terminé, Les trois chants sur Lénine est présenté partiellement et primé au second festival de Venise de 1934.
Dziga Vertov se retrouve cependant rapidement dans une position inconfortable et se voit vite décrier, voire rejeter. Cela vient tout d'abord de la fermeté de sa position contre toute forme de fiction et de mise en scène qui exclut une large part des cinéastes soviétiques. Cette exclusion prend des formes d'expression véhémentes comme dans l'appel du 1er janvier 1923 où Vertov interpelle les autres cinéastes soviétiques : "Cinq bouillonnantes années d'audaces mondiales sont entrées en vous et ressorties sans laisser la moindre trace. Les modèles "artistiques" d'avant la révolution sont accrochés chez vous comme des icônes et c'est vers eux seulement que se sont ruées vos tripes dévotes." Dziga Vertov multiplie les publications et les déclarations qui condamnent le cinéma de fiction.
En 1926 dans son ouvrage Ciné-chronique et comment la filmer Grigori Boltianski, responsable du département de ciné-chronique du comité de Petrograd, parle du talent des kinoks et de l'importance de leurs films, tout en qualifiant leur position théorique de "sectarisme formel" qui "cherche à dicter la politique de l'art cinématographique".
En 1967, le sketch Jean-Luc Godard pour Loin du Viêtnam a pour titre Camera oeil, en référence au ciné-œil de Dziga Vertov. Chris Marker qui est à l'origine du projet avait rendu hommage à Vertov peu de temps auparavant en publiant un poème en anglais intitulé "Let us praise Dziga Vertov". Après Mai 68, Jean-Luc Godard lance avec Jean-Pierre Gorin le Groupe Dziga Vertov, en concurrence au Groupe Medvedkine imaginé par Marker. Le cinéma russe devient ainsi une référence pour ces deux auteurs français qui s'éloignent ainsi du cinéma hollywoodien auquel ils avaient pourtant rendu hommage en 1963 à travers La jetée et Le mépris.
L'homme à la caméra, documentaire et symphonie urbaine
Les symphonies urbaines constituaient un genre important du cinéma documentaire d’avant-garde. Après New York 1911 du suédois Julius Jaenzon (1911), le deuxième film à proposer le portrait d’une ville est Manhatta du photographe Paul Strand et du peintre Charles Sheelers (1921) d’après le poème éponyme de Walt Whitman qui se décline sur un panneau représentant l’île de Manhattan. Commençant le matin et s’achevant le soir, Manhatta ne comprend pas de personnage principal, si ce n’est la foule, dans un décor qui met en avant l’architecture et les moyens de transports.
En 1926, Rien que les heures du cinéaste brésilien Alberto Cavalcanti suit l’itinéraire de différents personnages durant 24 heures à Paris. Le film est plus dramatique dans sa forme et annonce le réalisme poétique français des années 1930. En 1924, Vertov avait eu l'idée d'un film intitulé Moscou qui dort dans lequel la ville était vue aux premières heures de la journée, avec le cinéma comme seul témoin de cette absence de mouvement. Mikhaïl Kaufman tourne Moscou qui offrait peut-être, le film ayant été détruit, le portrait de la capitale de l’Union soviétique, de l’aube à la nuit. L’écoulement d’une journée est également le principe de composition d’Aujourd’hui ou 24 heures en 30 minutes de Jean Lods et Boris Kaufman (1928) qui a pour décor Paris.
La suspension du temps rappelle Paris qui dort (René Clair, 1926) qui mettait en scène un groupe de personnes se réveillant dans une capitale sans vie après la propagation d'un rayon mystérieux. Ménilmontant (1926), mélodrame de Dimitri Kirsanoff, est également connu pour être réalisé en décor naturel.
En 1927, Berlin, symphonie d'une grande ville de Walter Ruttmann est la plus connue des symphonies urbaines. Divisé en cinq actes, le film commence avec l'arrivée d'un train en gare. On voit les rues désertes, la mise en marche des machines, les mannequins dans les vitrines, le départ des enfants pour l'école, le nettoyage des rues, la circulation des tramways, les animaux du zoo, le tirage et la distribution des journaux du soir, enfin les loisirs. Lors de la présentation de L'Homme à la caméra à Berlin, les deux films furent rapprochés par de nombreux critiques. Des plans réapparaissent d'un film à l'autre comme l'arrivée du train, l'agent de circulation, les secrétaires tapant à la machine, la réunion dans la brasserie. Vertov tiendra à rappeler l'antériorité de ses recherches et leur possible influence sur Ruttmann. Si sa défense est peu crédible, il faut toutefois reconnaître que le projet de Vertov est différent de celui de Ruttmann. En effet, le cinéaste soviétique cherche moins à enregistrer des événements quotidiens qu'à exprimer une utopie où le cinéma apparaît comme le témoin d'une transformation sociale.
Pluie de Joris Ivens décrivant
Amsterdam sous la pluie clôt les symphonies urbaines des années 20.
Des clés nécessaires
L'image qui montre une femme endormie sur un banc relève du voyeurisme en faisant écho à l'affiche L'Appétit vendu de Nicolaï Okhlopkov (1928) montrée précédemment.
Dans l'unique document que l'on possède sur L'homme à la caméra, Dziga Vertov compare le caméraman filmant les bourgeois dans la voiture au Cavalier d'Airain, d'après la nouvelle rédigée par Alexandre Pouchkine en 1830.
Un plan montre Mikhaïl Kaufman sous un écriteau avec l'inscription "Les cireurs de chaussures de Paris". Le cinéaste se réfère ainsi à une anecdote qu'il rapporte dans ses écrits : "Récemment, lors, je crois, de la présentation de la dix-septième Kinopravda, un quelconque cinéaste a déclaré : "Quelle horreur ! Ce sont des cordonniers et non des cinéastes." Le constructiviste Alexis Gan, qui ne se trouvait pas loin, a répliqué pertinemment : "Donnez-nous davantage de cordonniers de ce genre et tout ira bien."
L'un des derniers sites visités par Mikhaïl Kaufman est le barrage du Dniepr. Il s'agit de la première construction de ce genre en Union soviétique. Vertov avait déjà consacré un film à ce bâtiment avec La onzième année. Le site réapparaîtra dans Trois chants sur Lénine. On sait l'importance accordée par Lénine à l'électrification du pays à travers la formule : "Le communisme, c'est les soviets plus l'électricité".
Le magicien chinois accomplit ses tours devant les enfants. Il était déjà présent dans Kinoglaz où il proposait le même spectacle. Cette figure se réfère à un article de Vsevolod Meyerhold, Vive le jongleur ! (1917). Ses numéros correspondent en effet à ceux décrits par l'écrivain dramaturge : "Le Chinois montre la soudure sans reproche des douze cercles d'acier qu'il a devant lui, puis il les touche de ses mains habiles, et la douzaine d'anneaux sonne bien haut en l'air, rassemblée en une seule chaîne." Et plus haut dans le texte : "Appelant à la rescousse la sorcellerie d'une poupée de bois (Andriouchka), le Chinois murmure d'obscures lamentations, parade avec une balle de chiffons, et la fait sauter magiquement d'un bol dans un autre. "
La salle Le Prolétaire programme La jeune Manuela (Dupont, Allemagne, 1923). Ce plan se réfère à l'article d'Ossip Brik, "Le contrepoison du cinéma". Le texte regrettait la présence de films étrangers qui usurpaient la confiance de Lénine dans cette invention quand il déclarait à Anatoli Lounatcharski, le Commissaire du peuple à l'Instruction : "De tous les arts, le plus important pour nous, c'est le cinéma". Ainsi, Ossip Brik écrit : "Sur la façade d'un cinéma provincial, cette maxime de Lénine était inscrite en gros caractère qui faisait la publicité d'un film étranger de qualité douteuse : La jeune Manuela ". Le rédacteur en chef du Novy Lef répondait à l'article de Léon Trotski, "La vodka, l'église et le cinématographe " Ce texte, qui semble être la principale référence de Vertov, domine toute la dernière partie du film qui met en relation différentes formes de loisirs où l'alcool et la religion sont opposés à l'instruction.
A la fin du film, on peut enfin voir le théâtre du Bolchoï se briser en deux. Depuis la Révolution, le bâtiment était régulièrement décrié comme le symbole de l'art académique qu'il fallait abolir. Au cours d'une réunion du Lef sur le cinéma en 1927, Ossip Brik déclarait : "Nous disons depuis dix ans qu'il faut fermer le théâtre du Bolchoï et on l'a encore restauré cette année." L'image conçue par Vertov sera reproduite dans le dixième numéro du Novy Lef en 1928.
Sources :
- Bamchade Pourlavi : L'homme à la caméra, édition CNDP, dossier en ligne : Baccalauréat cinéma.
- Dziga Vertov : Articles, journaux, projets, coll. 10/18, Union générale d’éditions, 1972. (Bibliothèque ESAM Réserve / 780-799 791.430 92 VER).
- Marimbert Jean-Jacques (dir.), Analyse d’une œuvre : L’homme à la caméra, D. Vertov, 1929, « Philosophie et cinéma », Vrin, 2009.
- Eugénie Zvonkine : L'homme à la caméra , livret pédagogique Lycéens aux cinéma.