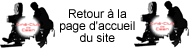|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

(John Ford, 1953)

(Dalmer Daves, 1959)
Au cinéma, la présence de la foule violente ou consentante est inséparable du lynchage qui se distingue des exécutions sommaires, cruelles, mais sans le consentement et l'appui de la foule. Il y a ainsi exécution sommaire dans Impitoyable et lynchage dans L'homme des hautes plaines.
|
Les lynchages au cinéma
|
|||
| Rapture | Dominic Sangma | Inde | 2023 |
| BlacKkKlansman j'ai infiltré le Ku Klux Klan | Spike Lee | U. S. A. | 2018 |
| Guitar Drag | Christan Marclay | U. S. A. | 2000 |
| Missouri breaks | Arthur Penn | U. S. A. | 1976 |
| L'homme des hautes plaines | Clint Eastwood | U. S. A. | 1973 |
| Pendez-les haut et court | Ted Post | U. S. A. | 1968 |
| La poursuite impitoyable | Arthur Penn | U. S. A. | 1965 |
| Les deux cavaliers | John Ford | U. S. A. | 1961 |
| La colline des potences | Delmer Daves | U. S. A. | 1959 |
| Du sang dans le désert | Anthony Mann | U. S. A. | 1957 |
| Johnny Guitar | Nicholas Ray | U. S. A. | 1955 |
| Le soleil brille pour tout le monde | John Ford | U. S. A. | 1953 |
| Stars in my crown | Jacques Tourneur | U. S. A. | 1949 |
| L'intrus | Clarence Brown | U. S. A. | 1949 |
| Le journal d'une femme de chambre | Jean Renoir | U. S. A. | 1946 |
| Panique | Julien Duvivier | France | 1946 |
| L'étrange incident | William Wellman | U. S. A. | 1943 |
| La ville gronde | Mervyn LeRoy | U. S. A. | 1937 |
| Furie | Fritz Lang | U. S. A. | 1936 |
Durant l'intense période de contestations contre le régime colonial qui précéda la guerre d'indépendance des États-Unis, un certain Charles Lynch (1736-1796), "patriote" de l'État de Virginie, décida de réformer la façon dont la justice était appliquée dans sa région.
Juge de paix, il instaura des procès expéditifs menant parfois à des exécutions sommaires à l'encontre des défenseurs de la couronne britannique. Il réunissait la cour, recrutait les jurés et présidait à l'exécution. Quand la cour devait ajourner, le prisonnier était exécuté. La "loi de Lynch" se répandit dans les territoires de l'Ouest américain et s'y développa jusqu'à l'établissement et la consolidation de l'État de droit. Ses méthodes expéditives et les erreurs judiciaires furent couvertes par la Cour suprême. Lynch devint par la suite sénateur.
Vers 1837, la "loi de Lynch" donna naissance au mot "lynchage" particulièrement en Nouvelle-Angleterre où, en dépit des lois qui les protégeaient, des noirs furent poursuivis par des Comités de vigilance, qui donneront naissance au Ku Klux Klan. Dans le Sud des États-Unis, le mépris de règles de procédure considérées comme favorables aux criminels est renforcé par l'hostilité au gouvernement fédéral.
De 1882 à 1951, 4 700 hommes, femmes et enfants furent ainsi victimes de ces pratiques aux États-Unis, perpétrées au nom d'une loi non écrite. Des années 1880 aux années 1930, on recense une majorité de victimes noires parmi les lynchés : 2 400 personnes contre 300 personnes blanches, durant la même période. La plupart de ces lynchages ayant eu lieu dans les États du Sud des États-Unis. La population blanche, mécontente de la décision du Président Lincoln d'abolir l'esclavage (1862), a décidé d'intervenir. Le Ku Klux Klan en particulier a conduit au meurtre de beaucoup de Noirs. Bien souvent, le fait, pour une personne de couleur, d'avoir « offensé la suprématie blanche » : une dispute, des insultes, un témoignage à charge contre un Blanc, pouvait la conduire à la potence. Parmi ceux-ci, deux couples d'afro-américains (Roger et Dorothy Malcolm, ainsi que George et Mae Murray Dorsey) furent assassinés le 25 juillet 1946 à Monroe, ville située à 70 kilomètres au sud-est d’Atlanta, dans le comté de Walton, en Géorgie. Une trentaine de personnes les ayant extirpés de leurs voitures, ils furent ensuite abattus après avoir été attachés à des arbres, après quoi les corps furent jetés dans les buissons. Suite à cela, le président Truman fut le premier homme politique américain à avoir, ouvertement, une position contre le lynchage, d'autant plus que l'un des hommes était un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale et que Dorothy Malcolm était enceinte de sept mois. Truman envoya le FBI sur les lieux, mais les enquêteurs fédéraux se heurtèrent à un mur de silence. Leurs meurtriers échappèrent alors à la justice.
Pour son premier film américain, Furie (1936), Fritz Lang prend clairement parti contre le lynchage et montre la mauvaise conscience qui s'empare des 22 accusés d'un lynchage contemporain lynchage. William Wellman lui emboîte le pas en 1943 avec L'étrange incident, toutefois situé en 1885.
 |
 |
| Furie (Fritz Lang, 1936) | L'étrange incident (William Wellman, 1943) |
Après guerre, le theme du lynchage dans le western est souvent abordé avec La colline des potences (Delmer Daves, 1959), Les deux cavaliers (John Ford, 1961), Pendez-les haut et court (Ted Post, 1968), L'homme des hautes plaines (Clint Eastwood, 1973), Missouri Breaks (Athur Penn, 1976). Le lynchage n'épargne pas le contexte plus paisible des villes moyennes : L'intrus (Clarence Brown, 1949), Stars in my crown (Jacques Tourneur, 1949), Le soleil brille pour tout le monde (John Ford, 1953), La poursuite impitoyable (Arthur Penn, 1965)