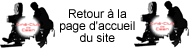|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |


On admet généralement que le cinéma fut introduit en Inde par les célèbres projections privées des frères Lumière qui eurent lieu à l’hôtel Watson, le 7 juillet 1896, à Bombay.
Comme partout ailleurs, cependant, plusieurs techniques «pré-cinématographiques» expérimentales et différentes formes artistiques de projection d’images en mouvement constituèrent des précédents importants : le «pat», désignant des peintures murales (le mot cinéma se dit en hindi chitra-pat), est présent sous différentes formes dans tout le pays, et met en scène un conteur, qui éclaire les images et les accompagne en chantant ou en parlant (on trouve par exemple, le Pabuji-no-pad rajasthani, le Chitrakathi maharashtrian ou les marionnettes en cuir d’Andhra Pradesh).
 |
 |
| Peinture de conteur : la légende de Pabuji, vers 1970 Peinture sur toile de coton, 478 x 143,5 cm |
L'offrande de la montagne de nourriture à Krishna Shri Nathji, fin 19e, Peinture sur toile de coton, 237 x 254 cm |
À la fin du XIXe siècle, les frères Patwardhan se rapprochèrent des techniques cinématographiques et leur Shambarik Kharolika (lanterne magique) constitua un des plus célèbres exemples de projections sur un écran à partir de plaques de verre partiellement animées.
 |
 |
| Autel portatif de conteur à panneaux historiés du Ramayana , milieu du 20e siècle |
Lanterne magique |
Les pionniers, le film mythologique
Deux dates marquent la naissance du cinéma indien. Le 7 juillet 1896, des films des frères Lumière sont montrés à l’hôtel Watson, à Bombay, et le 3 mai 1913 est projeté, à Bombay également, le premier film indien de fiction, Raja Harischandra. C’est en voyant, en 1910, au cinéma, La vie du Christ (Alice Guy) que Dadasaheb Dhundiraj Phalke décide de transposer à l’écran divers épisodes des deux grands récits épiques que sont le Ramayana et le Mahabharata. Si l'œuvre des frères Lumière est la première à être venue en Inde, c’est celle de Méliès qui, avec ses récits merveilleux et ses trucages, va être son inspiratrice pour longtemps. Lorsque Phalke tourne son film en 1912, aucun comédien de théâtre n’accepte de servir le cinéma, et il lui faut se contenter d’acteurs de troisième ordre ou d’amateurs. De plus, à cette époque, et jusqu’au début des années vingt, les rôles féminins sont tenus par des hommes, le métier d’actrice étant assimilé à de la prostitution. En 1918, Phalke réalise dans son propre studio La naissance de Krishna, célèbre pour ses effets spéciaux.
 |
 |
C’est en 1921, avec Sant Tukaram, qui retrace la vie d’un saint, que Phalke réalise le premier film religieux, inaugurant, parallèlement au film mythologique, un genre à part entière, le devotional film.
En 1919, le premier film de fiction de l’Inde du Sud (studios de Madras), Keechaka Vadham, est également inspiré d’un épisode du Mahabharata, centré sur les destructions commises par le démon Keechaka. En Inde, le divin pénètre tous les actes quotidiens, et on entre en contact avec lui non par la pensée, mais à travers ses manifestations, son circuit infini de représentations (peinture, sculpture), ses avatars, dont le cinéma très tôt a fait partie. Il fallait en effet que ce rapport au divin soit au préalable trivial pour qu’il puisse s’incarner à une aussi grande échelle par l’intermédiaire du cinéma. Si le cinéma hindi de Bombay a délaissé progressivement le film mythologique et religieux, Madras (180 films en 1992) demeure le pôle vivant d’un genre uniquement destiné au marché intérieur.
Parallèlement à Phalke, Jamshedji Framjee Madan dote l’Inde d’un circuit de salles. Il construit en 1907 la première salle de cinéma en Inde (l’Elphinstone Palace, à Calcutta). En 1923, année de sa mort, sur les cent cinquante salles que l’Inde possède, réparties sur tout le territoire, plus d’un tiers appartiennent au circuit Madan. En 1921, avec Sairandhri, film mythologique avec effets spéciaux, Baburao Painter (surnom lié à son précédent métier) s’inscrit dans le sillage de Phalke, le pionnier. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que la fréquentation du film indien reste très minoritaire puisque, en 1926, 86 % des films montrés sont étrangers. Pour la plupart américains, ils contribueront indirectement à l’essor du star-system (Zubeida, Devika Rani, Master Vithal). Le gouvernement de l’Empire britannique voit d’un mauvais oeil cette influence américaine et souhaite promouvoir un cinéma plus nettement ancré dans la tradition indienne. Ce désir sera réalisé dès l’arrivée du parlant.
Le film musical, le système de studios
Contrairement à d’autres pays (U.R.S.S., Japon), l’Inde a très vite accepté le cinéma parlant. L’année 1931 verra l’éclosion des premiers films parlant telugu, bengali, tamoul, le plus célèbre étant le film musical hindi Alam Ara d’Ardeshir Irani. Auparavant, les intertitres des films muets étaient traduits en quatre langues pour toucher un large public, parmi ceux qui savaient lire. Avec le parlant, le cinéma indien est de nouveau confronté à la barrière des langues. Problème qui fait que, outre les films hindi et tamouls (Bombay, Madras), on dénombre des films malalayam (Kerala), kannada (Karnataka) ou telugu (Andhra Pradesh).
Paradoxalement, cet éclatement linguistique va être résorbé par un autre élément, lié lui aussi au parlant (la musique et le chant), qui va rendre le cinéma encore plus populaire, grâce au développement croissant de l’industrie du disque et de la radio. Très vite, la danse deviendra l’espéranto du cinéma indien, et son succès, lié à son érotisme suggestif toléré par la censure, sera tel que le cinéma hindi (Bombay) s’imposera comme le all india film. En effet, il est possible de comprendre l’histoire que raconte un film (mimiques appuyées, rôles archétypés) sans connaître la langue. Avec le parlant, ce sont de vrais chanteurs professionnels qui passent devant la caméra. Refroidi par la performance limitée de ces nouveaux acteurs, le cinéma indien institutionnalise en 1935 la pratique du playback singer, toujours utilisée. La star a donc un double visage. Celui qu’on voit sur l’écran (l’acteur, l’actrice) et celui qui se cache derrière : la voix, tout aussi célèbre, de celui ou de celle qui la double lorsqu’elle chante. Si les stars de l’écran sont nombreuses en Inde, perpétuels objets de convoitise d’une presse à scandale, les stars de l’ombre que sont les chanteurs contribuent, grâce au relais du disque et de la radio, à la notoriété des films. En Inde, peu de voix doublent une foule de visages différents. C’est ainsi que Lata Mangeshkar, la plus grande dame du cinéma indien, la plus invisible aussi, compte à son actif plus de vingt-cinq mille chansons de film.
L’essor du film musical (27 films réalisés en Inde en 1931, 83 en 1932, 164 en 1934) va contribuer au rapide développement de l’économie du cinéma basée, comme à Hollywood, sur le système des studios, avec des acteurs et des techniciens sous contrat. Ardeshir Irani, réalisateur d’Alam Ara, fonde en 1927 à Bombay l’Imperial Film Company, spécialisée dans le film musical et le film d’aventures. En 1933, les frères Wadia fondent la Wadia Movietone, réputée pour ses films d’aventures, remakes des grands succès hollywoodiens (Tarzan, Zorro, Robin des bois) et dont le film le plus célèbre, réalisé par Homi Wadia, est Diamond Queen (1940). C’est avec la Wadia que le cinéma indien, très protectionniste, s’habitue à copier ouvertement le cinéma américain tout en y ajoutant des ingrédients - chansons et danses - au goût du public indien. Le Hollywood masala est l’expression imagée pour désigner cette tradition, toujours en vigueur.
Au début des années trente, trois studios dominent le cinéma
indien. Il s’agit de la New Theatres (Calcutta), fondée en 1930
et qui produira en 1935 Devdas, du prince Barua, ainsi que les films
de Debaki Bose, auteur de deux célèbres devotional : Chandidas
(1932) et Puran Bhakt (The Devotee, 1933). Le deuxième studio
est la Bombay Talkies, fondée en 1935 par le réalisateur-producteur
Himansu Rai, l’acteur-réalisateur de Karma (1933), célèbre
pour sa scène de baiser avec la star Devika Rani, et pour être
le scénariste de L’intouchable (1936) de Franz Osten, qui
aborde les préjugés de caste. Le troisième studio, la
Prabhat, fondée en 1929 et transférée en 1933 à
Pune à 120km de Mumbai, siège actuel du National Film Archive, créé en
1964, a la particularité d’être le fruit d’un groupement
de cinéastes (Vanakudre Shantaram, V. G. Damle, S. Fathelal). Parmi
les nombreux films mythologiques et religieux émergent Sant Tukaram
de V. Damle (1935), remake du film de Phalke, ainsi que le film historique
Ramshastri. Le cinéaste le plus prolixe est Shantaram, puisque
sa carrière s’étend de 1927 (Netaji Palkar, produit
par Baburao Painter) à 1977. Maillon essentiel de l’histoire du
cinéma indien, on lui doit L’Inattendu (1937), l’un
des plus beaux films des années trente. Quant au Sud (Madras), il suivra
avec la création de la Vauhini Pictures en 1939. On doit au cinéma
tamoul les deux films essentiels que sont Chandralekha (S. S. Vasan, 1948),
film historique aux décors gigantesques, célèbre pour
la scène de danse sur des tambours géants, et Avaiyyar (K. Subu,
1953), film mythologique extrêmement soigné.
L’âge d’or des années cinquante
Alors que le système des studios s’est effondré tardivement au Japon (au seuil des années soixante avec l’avènement de la télévision), l’Inde a la particularité d’avoir vu ce système péricliter très tôt sans que soit entamée la vitalité de la production et de la fréquentation. Himansu Rai, fondateur de la Bombay Talkies, meurt en 1940 et son studio ferme ses portes en 1952. L’année suivante, la Prabhat cesse toute activité de production, tandis que la New Theatres entame son déclin avec la disparition du prince Barua en 1951, époque à partir de laquelle les cinéastes bengali partent s’installer à Bombay. Cette disparition prématurée des studios s’explique par l’arrivée de nouveaux producteurs à la fin des années quarante. Alléchés par l’argent facile, ils proposent des cachets énormes aux stars qu’ils engagent au film par film, rompant avec la tradition des studios qui accueillaient des salariés sous contrat. Cette politique des cachets est à l’origine de l’aberrante situation actuelle : une star indienne peut être engagée sur trente films à la fois, tournant le matin dans l’un et l’après-midi dans un autre. Ces nouveaux producteurs, ignorants du cinéma, ont pour souci premier de blanchir de l’argent. Cette pratique courante s’appelle black money, et elle témoigne à sa manière du faible pouvoir de contrôle du gouvernement sur l’économie du cinéma.
Cette explosion du système, dont on mesurera les ravages esthétiques à partir des années soixante (bâclage technique, imitation paresseuse des films à succès), a permis l’éclosion dans le cinéma hindi d’individualités sachant concilier l’art (acteurs, réalisateurs) et l’industrie (producteurs, fondateurs de studios). On peut parler, à propos du Bombay des années cinquante, d’un véritable âge d’or du cinéma hindi. Khwaja Ahmad Abbas, avec Les enfants de la terre (1946), premier film indien montré à Moscou, ouvre la voie vers un cinéma davantage ancré dans la réalité sociale. Fondateur de l’I.P.T.A. (Association théâtrale du peuple indien), membre du Parti communiste, il reste connu en tant que scénariste des principaux films de Raj Kapoor à partir du Vagabond (1951). Fils d’un célèbre acteur, lui-même acteur, Raj Kapoor, formé à la Bombay Talkies, est avec Mehboob Khan le cinéaste le plus populaire. Ses principaux films comme producteur Le petit cireur (Prakash Arora, 1954) et réalisateur Monsieur 420 (1955) témoignent de l’influence croisée des premiers Chaplin et des films de Frank Capra.
De son côté, Mehboob Khan, contrairement à Raj Kapoor, d’abord tourné vers la peinture de la ville, se consacre à la description du monde paysan. Influencé par le cinéma soviétique, notamment Dovjenko, il compose de grandes fresques épiques dont les plus connues sont Mangala, fille des Indes (1952, premier film en Technicolor) et surtout Mother India (1957), où la star Nargis compose un personnage de Mère Courage en butte à l’injustice du monde féodal.
 |
 |
Bimal Roy s’inscrit en revanche dans le sillage de K. A. Abbas. Formé à la New Theatres (il travaille sur Devdas), il s’installe en 1952 à Bombay et, marqué par la vision du Voleur de bicyclette, offre avec Deux Hectares de terre (1953) le modèle d’un néo-réalisme à l’indienne. Plus tard, s’éloignant de cette veine, il réalisera un remake de Devdas (1955) ainsi que Madhumati (1958), une histoire de réincarnation sur un scénario de Ritwik Ghatak.
Tout comme Bimal Roy, Guru Dutt a quitté Calcutta pour Bombay. Après avoir étudié la danse dans la troupe d’Uday Shankar, réalisateur de Kalpana (1948) et frère du célèbre musicien, Guru Dutt, qui a appris son métier à la Prabhat, passe à la mise en scène tout en restant acteur. Chez Guru Dutt, les moments de musique et de danse, les enchaînements entre les scènes dialoguées et les scènes chantées sont extrêmement sophistiqués. De ce cinéaste-chorégraphe, on retiendra Fleurs de papier (1959), peinture amère du monde du cinéma, et surtout L’assoiffé (1948), sombre et bouleversante évocation d’un poète maudit.
 |
 |
Parallèlement à cette effervescence du cinéma hindi, le Bengale, par l’intermédiaire de Satyajit Ray , occupe le premier rang sur la scène internationale. La complainte du sentier est sélectionné à Cannes en 1956, L'invaincu est Lion d’or à Venise en 1957 et Le monde d'Apu (1959), de l'avis de beaucoup, couronne cette trilogie. Marqué par le néo-réalisme et par sa rencontre avec Jean Renoir lors du tournage du Fleuve, le cinéma de Ray sait admirablement concilier le témoignage sensible d’une réalité présente où l’émotion prend toujours le pas sur l’action, tout en restituant les splendeurs d’une culture passée, celle de la Renaissance bengalie. Ray puise son inspiration dans la très riche littérature bengali, et l’écrivain Rabindranath Tagore est la figure intellectuelle et politique qui nourrit son oeuvre. Les principaux films de Ray (la trilogie d’Apu, 1955, 1956 et 1959, Le Salon de musique, 1958, Charulata, 1964, La Déesse, 1960) font de lui une des grandes figures du cinéma mondial.
 |
 |
| La complainte du sentier (1955) | Le salon de musique (1958) |
 |
 |
| Charulata (1964) | La Déesse, (1960) |
Néanmoins, son succès critique a quelque peu occulté le travail d’un autre cinéaste bengali, Ritwik Ghatak, artiste maudit, mort rongé par l’alcool en 1976 et dont l’oeuvre fut seulement découverte après sa disparition. Autant Ray est un cinéaste de la quête de l’harmonie et de la sensation du monde, autant Ghatak est un cinéaste de la rupture et de la déchirure, thématiquement et formellement. Originaire de Dacca, l’actuel Bangladesh, il se réfugie au Bengale après la partition, survenue un an après l’indépendance (1947). Ce qui explique que le thème de l’exil et de l’errance, celui de la quête d’une terre perdue, toujours promise, domine son oeuvre. Son plus beau film, l’égal des plus grands films de Ray, est L’étoile cachée (1960).
 |
 |
Mrinal Sen est le troisième nom du cinéma bengali. Dans le sillage de K. A. Abbas, son cinéma, plus engagé que celui de Ray, plus ghatakien sur le fond que sur la forme, se veut un témoignage concret et féroce sur la réalité qui l’entoure. De Mrinal Sen, il convient de signaler Un jour comme un autre (1980) et Une affaire classée (1983).
Les cinémas populaires des années 70
C'est le temps des films commerciaux à formule et de l'avènement des "wood" dont Bollywood (hindi), Tollywood (télougou), Kollywood (tamoul).
Les blockbusters Bollywood de cette époque sont devenus iconiques : Pakeezah (Kamal Amrohi, 1972); Yaadon Ki Baaraat (Nasir Hussain, 1973); Sholay (Ramesh Sippy, 1975) qui confirme Amithabh Bachan dans son statut de superstar et devient "le jeune homme en colère"; Le mur (Yash Chopra, 1975); Don (Chandra Barot, 1978); Satyam Shivam Sundaram (Raj Kapoor,1978), Gol mal (Hrishikesh Mukherjee, 1979); Karz (Subhash Ghal, 1980) ; Umrao Jean (Muzaffar Ali, 1981); Mr India (Shekhar Kapur, 1987) ; Dilwale Dulhania Le Jayenge (Aditya Chopra, 1995) ; Dil Toh Pagal Hai (Yash Chopra, 1997) ; Mon coeur est déjà pris (Sanjay Leela Bhansali, 1999) ; La famille indienne (Karan Johar, 2001) ; Lagaan (Ashutosh Gowariker, 2001); Devdas (Sanjay Leela Bhansali, 2002) ; Raavanan (Mani Ratnam) ; Voltage (Anubhav Sinha, 2011) ; Chennai Express (Rohit Shetty, 2013) ; Bajirao Mastani (Sanjay Leela Bhansali, 2015).
Le pantheon des superstars indiennes est considérable. Elles sont adulées avec une ferveur unique au monde : Shashi Kapoor, Amitabh Bachchan (Sholay), Silk Smitha, Rashi Kapoor, Sridevi, Rajininkanth, Zeenat Aman, Kamal Haasan, Rakka, Sha Rukh Khan (Devdas, Jawan), Madhuri Dixit, Vikram, Kajol, Saiman Khan, Aishwarya Rai Bachchan (Devdas), Aamir Khan, Deepika Padukone, Ranveer Singh.
 |
 |
| Shashi Kapoor, Amitabh Bachchan dans Le mur (Yash Chopra, 1975) |
Amitabh Bachchan (à gauche) dans Sholay (Ramesh Sippy, 1975) |
 |
 |
| Aishwarya Rai Bachchan et Shah Rukh Khan dans Devdas (Sanjay Leela Bhansali, 2002) |
Madhuri Dixit et Aishwarya Rai Bachchan dans Devdas (Sanjay Leela Bhansali, 2002) |
Les cinémas indépendants
Di cinéma dit « indépendant » se développent aux côtés de ces cinémas du star-systeme. Ces cinémas alternatifs sont en plein essor, favorisés par deux évolutions : la prolifération des multiplex qui laissent (un peu) de place à des petits films et surtout la montée en puissance des plateformes de diffusion en ligne du type Netflix ou Amazon Prime Video, plusieurs dizaines à ce jour en Inde, qui accueillent volontiers films régionaux et indépendants. Extrêmement varié, le cinéma indépendant regroupe des cinéastes venus de tous les horizons, qui constituent tout sauf une école monolithique. Ce qui les rassemble peut se ramener à un rejet de l’esthétique Bollywood et de ses histoires à l’eau de rose se terminant invariablement par un happy end (même s’ils adorent utiliser les codes de Bollywood en les détournant) et un choix de sujets sans concessions. On trouve dans ces films des thèmes choc : affrontements de castes, sort des dalits (intouchables), corruption, criminalité politique, condition de la femme, ou relations entre communautés. Ce qui fait de ce cinéma un miroir sans équivalent sur la société indienne contemporaine et ses bouleversements. Il ne s’agit pas d’un cinéma d’art et d’essai : les cinéastes indépendants cherchent le plus souvent le succès commercial. Et il n’y a pas de frontière étanche avec Bollywood : des stars font des incursions dans ce cinéma plus aventureux, des financements traditionnels se risquent dans ces petites productions peu onéreuses qui peuvent rapporter gros quand elles trouvent leur public… Bien évidemment, ces films iconoclastes se heurtent souvent aux autorités. Dans un contexte politique marqué par la dérive autoritaire de plus en plus marquée du gouvernement nationaliste hindou, les cinéastes contestataires doivent affronter les organes de censure, les offensives émanant des milieux politiques et les campagnes de haine sur les réseaux sociaux.
Anurag Kashyap est le chef de file incontesté de ce mouvement. Né en 1978, il est le premier de cette nouvelle vague à avoir connu le succès dès 2009 à 31 ans avec Dev.D. Ce qui l’a mis en situation de pouvoir aider ses jeunes confrères à démarrer. Kashyap pratique un cinéma virtuose avec des films noirs, très noirs : extrême violence des criminels et des rapports sociaux, bas-fonds des mégapoles indiennes, misère montrée sans fard. Gangs of Wasseypur (2012) est une fresque monumentale consacrée aux guerres opposant les mafias de cette ville du Jharkhand, à l’Est du pays. Mukkabaaz (2017) suit un jeune homme de l’Uttar Pradesh tentant de s’en sortir grâce à la boxe, décrit la violence des rapports de caste, les attaques contre les musulmans accusés de manger du bœuf, la corruption des instances sportives officielles.
Economie
En 2023, la fréquentation des cinémas indiens est en recul de 5 % par rapport à 2022 avec 900 millions d’entrées et de 10 % par rapport au record de 2019 (1,0 milliard d’entrées). Sur l’année, le box-office en Inde augmente néanmoins de 14 % pour atteindre un niveau record de 120 milliards de roupies (1,3 Md€), porté par une hausse du prix du billet. En effet, le tarif du billet augmente de 10 % sur un an à 130 roupies (1,5 €). Le nombre d’écrans de cinéma dans le pays s’élève à 9 742, en hausse de 4 % sur un an.
Les trois premières places du classement des films en termes de recettes sont occupées par des films en langue hindi. Jawan (Atlee) occupe la première place avec 80,5 M€ de recettes, suivi des films Animal (Sandeep Reddy Vanga) avec 70,6 M€ et Pathaan (Siddharth Anand) avec 69,5 M€. La part des films en hindi (de Bollywood) retrouve son niveau prépandémique avec une part de marché de 44 % (33 % en 2022). Les films en hindi devancent les films issus des Etats d’Inde du Sud (42 %) et les films hollywoodiens (9 %). Ceux ci sont en baisse constante (15 % en 2019 et 12 % en 2022). En 2023, aucun film américain ne fait partie du top 10 des films au box-office indien contre un film en 2022, Avatar: la voie de l’eau (56,9 M$).
En 2022, La première place du classement des films en termes de recettes était occupée par le film en langue kannada, K.G.F: Chapter 2 (Prashanth Neel), avec 117,3 M€ de recettes, suivi du film RRR (S. S. Rajamouli), acronyme de Rise Roar Revolt en langue telugu (104,9 M€). Le premier film en langue hindi, Brahmastra : Part 1 – Shiva (Ayan Mukherjee), n’arrivait qu’en 6e position du top 10. En 2022, 32 % des recettes enregistrées par les films en langue hindi venait des versions doublées en hindi de films issus des Etats d’Inde du Sud, dont celles de K.G.F: Chapitre 2 et RRR. En deuxième position, les films en telugu représentent 20 % du box-office en 2022.
 |
 |
| Répartition (extrait) des films indiens par langues en 2017 12 langues sur 28 cumulent 96 % des 1927 films produits (source : Central Board of Film Certification, via wikipedia) |
carte linguistique des langues source: Indiomania, cinémathèque française, 1995 via Yves Thoraval : Les cinémas de l'Inde. |
Sources :
- Bollywood Superstars : histoire d'un cinéma indien musée du quai Branly - Jacques Chirac, du 26 septembre 2023 au 14 janvier 2024
- Bilan 2023 du CNC
- Bollywood and Co