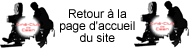|
|
|
|
|
Le temps qu'il reste




 Un
chauffeur de taxi israélien a pris à l'aéroport un passager
qu'il distingue à peine. Une tempête diluvienne s'abat sur eux,
faisant perdre ses repères au chauffeur et l'obligeant bientôt
à s'arrêter. "Où suis-je se demande-t-il ?"
alors qu'un retour en arrière s'amorce avec le sous-titre "un
absent si présent".
Un
chauffeur de taxi israélien a pris à l'aéroport un passager
qu'il distingue à peine. Une tempête diluvienne s'abat sur eux,
faisant perdre ses repères au chauffeur et l'obligeant bientôt
à s'arrêter. "Où suis-je se demande-t-il ?"
alors qu'un retour en arrière s'amorce avec le sous-titre "un
absent si présent".
1948, Nazareth. La guérilla palestinienne est sur le point d'être anéantie par l'armée israélienne qui bombarde les villages de sa propagande, promettant la liberté et la paix à ceux qui hisseront le drapeau blanc. La voiture officielle qui s'en pare est pourtant attaquée par le petit avion de propagande, heureusement dépourvu de mitrailleuse. Le maire de Nazareth est attendu par les officiels israéliens qui le contraignent à signer la reddition de sa ville et surtout à subir la mascarade de justice militaire qu'ils veulent imposer. Les Israéliens s'emparent des vêtements de combat des palestiniens qui ont fui et, sous ces déguisements, abattent une femme qui les acclame et piègent les résistants.
Fuad est l'un d'eux. Alors que sa fiancée et sa famille fuient vers la Jordanie, il a décidé de rester et de se battre. En allant sauver un blessé, il est arrêté par les militaires, s'enfuit mais est repris à nouveau. Dénoncé comme expert en réparation d'armes, il et sauvagement torturé et, jeté du haut d'un mur d'enceinte, laissé pour mort.
1970. Fuad est maintenant marié et père du jeune Elia. Il habite toujours Nazareth qui s'est agrandie mais dont l'économie est vacillante. Il est aussi très affaibli par les conséquences des tortures de 48 et son médecin lui a interdit de fumer et de sortir pêcher la nuit... Ce qu'il fait pourtant régulièrement. Son courage est resté le même aussi bien pour aller empêcher son voisin de s'immoler par le feu à chaque fois qu'il boit trop et que le désespoir de l'occupation le prend que pour sauver le conducteur d'un camion sur le point d'exploser.
Le jeune Elia fréquente une école tenue par sa tante, à la myopie croissante, qui est récompensée par les officiels israéliens pour sa chorale qui chante si bien les chants à la gloire d'un état d'Israël champion de la paix et des jours meilleurs. Le jeune Elia s'initie au monde en voyant Spartacus au cinéma, en se faisant réprimander par son maître le jour de la mort de Nasser pour avoir soutenu que l'Amérique est impérialiste et en voyant son père arrêté pour trafic d'armes.
1980, "Le jour de la terre" où l'on manifeste contre la spoliation des terres palestiniennes en 1948. Elia est maintenant un jeune homme qui voit son père de plus en plus affaibli et sa mère craignant pour la santé de celui-ci et son engagement inébranlable pour la cause. La tante d'Elia, presque aveugle, ne le reconnaît plus. Elia qui étudie chez lui, voit les jeunes manifester dans la rue et se faire tirer dessus par la police israélienne. A l'hôpital, militaires israéliens et médecins palestiniens se disputent les blessés. Fuad sort lui de l'hôpital après son opération à coeur ouvert. Il est très affaibli et s'endort dans la voiture en écoutant un chant de libération arabe alors qu'Elia va lui chercher les médicaments dont il a besoin. Elia sait qu'il ne reverra plus son père, il a été dénoncé comme opposant et doit s'exiler.
Aujourd'hui. Elia Suleiman rentre dans l'appartement de son enfance où trône un sapin de Noël. Son voisin policier sonne à sa porte pour lui offrir un plat de taboulé. Elia est rentré parce que sa mère est très mal. Assista-t-il à ses derniers jours à la maison où elle était veillée par son voisin et une infirmière surveillant son taux de sucre ? La vit-il réellement sur son balcon, plongée dans ses souvenirs et indifférente au feu d'artifice officiel ? La télévision montre toujours des images des soulèvements palestiniens et la situation à Ramallah demeure tendue pour les jeunes, les femmes promenant leur enfant en poussette ou les hommes sortant les poubelles ou dansant en boite. A l'hôpital, la mère d'Elia lui sourit pourtant, perdue dans le souvenir de son mari dont elle tient une photographie. Elle ne souhaite plus vivre assistée du goutte à goutte. Elia accepte sa décision.


 Des
officiels palestiniens qui n'auront pour tout souvenir que le postérieur
du photographe officiel israélien immortalisant, le croit-il, la reddition
de Nazareth en 1948 ; un enfant que son maître oblige à taire
que l'Amérique des années 1970 est impérialiste ; un
habitant de Ramallah aujourd'hui qui ne peut sortir ses poubelles sans être
menacé par le canon d'un char. Ces trois séquences muettes disent
la colère rentrée d'Elia Suleiman devant l'humiliation subie
par son peuple dont on nie la fierté et le droit de grandir. Elles
disent aussi la grandeur d'un artiste qui a choisi de se battre non avec des
armes, ni avec des mots mais avec la beauté du cinéma pour en
appeler à un humanisme réconciliateur avant qu'il ne soit trop
tard.
Des
officiels palestiniens qui n'auront pour tout souvenir que le postérieur
du photographe officiel israélien immortalisant, le croit-il, la reddition
de Nazareth en 1948 ; un enfant que son maître oblige à taire
que l'Amérique des années 1970 est impérialiste ; un
habitant de Ramallah aujourd'hui qui ne peut sortir ses poubelles sans être
menacé par le canon d'un char. Ces trois séquences muettes disent
la colère rentrée d'Elia Suleiman devant l'humiliation subie
par son peuple dont on nie la fierté et le droit de grandir. Elles
disent aussi la grandeur d'un artiste qui a choisi de se battre non avec des
armes, ni avec des mots mais avec la beauté du cinéma pour en
appeler à un humanisme réconciliateur avant qu'il ne soit trop
tard.
A l'image du dernier plan où Suleiman nous regarde doit dans les yeux pour nous exposer la désespérance d'un peuple qui a déjà perdu la génération des combattants de 48 et dont la jeunesse est fortement imprégnée de culture américaine, chacun des plans du film porte à la fois une vérité documentaire presque palpable et une intention abstraite à éclaircir tout en renvoyant, par un effet de rimes burlesques, à ce même message pourtant désespérant d'un cataclysme sur le point d'advenir. Cette capacité à osciller sans cesse entre deux pôles : documentaire/fiction, évènement/structure et burlesque/tragique donne une puissance mystérieuse et bouleversante à chacun des plans du film, si beaux et, en apparence, si simples.
Du premier au dernier plan, la même exigence de cinéma
Le film s'ouvre par un plan dont le point de vu est l'arrière du coffre d'un taxi où un chauffeur israélien jette le sac de son passager pour, dit-il, un long trajet. A peine celui-ci a-t-il débuté qu'une tempête s'abat sur le taxi obligeant celui-ci à s'arrêter et à se poser la question de savoir où il en est. La situation est bien évidemment métaphorique des rapports entre les deux nations. S'y ajoute pourtant quelques doubles sens qui ont font toute la richesse. C'est l'Israélien qui conduit mais le point de vu est celui de E. S. que l'on distingue, flou, à l'arrière. Le titre "L'absent si présent" qui amorce le retour en arrière sera aussi bien son père dont les souvenirs sont la base du récit que la nation palestinienne qui semble niée par ce chauffeur qui distingue à peine son passager.
Le dernier plan est celui de Suleiman nous regardant fixement après avoir laissé sa mère mourir tranquillement au milieu de ses souvenirs. Il nous regarde comme il regarde les trois jeunes emmitouflés dans leur capuche et écoutant de la musique américaine (Staying alive). La situation est tout à la fois désespérée (la mort de la mère, et l'impérialisme de la culture américaine) et quand même porteuse d'espoir. La réalité à regarder en face est celle de jeunes dont la musique, fut-elle américaine, les incite à lutter. C'est cette même force vitale que ne saurait éteindre aucune occupation que Suleiman avait déjà figurée dans la séquence où la jeep militaire somme les jeunes de respecter le couvre feu et que ceux-ci continuent obstinément de danser.
Chaque événement isolé par Suleiman s'inscrit en effet dans une structure faite de rimes qui lui donne finalement sens et provoque l'émotion tout en faisant rire. Les rimes, ce sont d'abord les lettres de la mère qui ouvrent les séquences de 1970 et de 1980. Ces lettres anticipent l'action à venir. Celle-ci advenant (l'immolation par le feu du voisin, la myopie de la tante, la maladie du père) la rende déjà burlesque sans qu'une expression du visage ou une parole des acteurs ne soit nécessaire. Suleiman père, mère et fils font rire comme une famille de Buster Keaton. Les tentatives d'immolation par le feu (avec des allumettes trempées par l'essence) du voisin, ou les parties de pêche à répétition suivies du même rangement mystérieux du matériel, encadrées du délire verbal du voisin sont les rimes les plus caractéristiques. On leur ajoutera les lentilles immangeables de la tante ou les séquences d'étrangers passant devant les Palestiniens attablés.
Cette structure répétitive est soigneusement mise en scène par Suleiman par des plans fixes dans des cadres identiques comme surgis d'un souvenir que l'on ne peut effacer (le père rangeant le matériel) ou d'une projection mentale que Suleiman s'est forgée (son père à "la pêche" interrogé par des militaires pas très futés -l'un deux s'étonnera quand même d'un lieu bien éloigné de Nazareth pour ces sorties nocturnes !). Tous ces plans fixes possèdent une grande splendeur formelle. Le sens qui les creuse surgit en effet à distance, par la rime, et ne vient pas alourdir le plan par une signification présente en son sein ou celui d'avant ou d'après. Des lors, c'est la minéralité du plan qui s'exprime : la beauté du champ d'oliviers et le bruit du vent dans les arbres, la mère écrivant ses lettres, la mère sur le balcon qui voit Nazareth se développer (mais qui ne veut pas voir le feu d'artifice factice).
A la matérialité des choses, Elia Suleiman ajoute une bonne part d'onirisme. Manifeste dans la séquence du mur de la honte franchi à la perche, il intervient aussi probablement dans toutes les séquences avec la mère avant la sortie du flash-back.
On s'étonnera qu'un film aussi beau et bouleversant n'ait pas obtenu la palme d'or au festival de Cannes en juin 2009. Le jury aurait par ailleurs contribué à aider l'un des plus grands cinéastes du Moyen-Orient à obtenir plus simplement les financements dont il a besoin.
Jean-Luc Lacuve le 14/08/2009