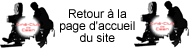|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
par Carole Desbarats,
Université populaire de Caen et L'exception le 01/02/04
Carole Desbarats trouve l'idée d'une université populaire formidable et se déclare très honorée d'y être conviée pour parler devant un public de cinéphiles et de non cinéphiles. Dans ce cycle de conférences, la règle du jeu est de chercher, travailler, ensemble pour savoir comment commence un film.
" Il faut toujours terminer qu'est-ce qu'on a commencé ". Cette phrase dont la faute de syntaxe n'échappe à personne est tirée de la fin du Mépris (Jean-Luc Godard, 1963). Elle énonce une règle, vraie seulement dans certains films classiques, où les cinéastes vont placer au début du récit des éléments très repérables pour les remettre à la fin et boucler ainsi leur film. En poursuivant ce dessin, quelle est donc l'idée que ces cinéastes ont derrière la tête ?
Scène finale du Mépris
Le Mépris raconte ce mépris de la femme envers l'homme qui va déliter leur couple. La secrétaire part avec le producteur vers Rome et, après une série d'évènements, Paul (Michel Piccoli) vient dire adieu à Fritz Lang qui joue son propre rôle.
La phrase prononcée n'est pas anodine à l'image des dialogues négociés avec Godard par Fritz Lang. L'exemple le plus fameux étant le passage sur la croyance devant la présence ou l'absence de Dieu tiré d'un texte de Holderlin. Dans Le Mépris, l'acteur Godard qui joue l'assistant du metteur en scène se met en retrait, sous l'influence du père Fritz Lang dont les gestes sont toujours augustes. Lang c'est la grande idée du cinéma ; le cinéma comme une totalité que l'on se doit de clore. Cinéaste américain, Fritz Lang est l'auteur de M le maudit (1931) mais aussi d'une grande période américaine où il est confronté aux studios dans lesquels domine non pas la figure du réalisateur mais celle du producteur.
Le cinéma classique se met en place très tôt. Vers 1910-1920, des codes ostensibles apparaissent. L'âge classique perdure jusqu'au milieu des années 50 (en 1953 le Cléopâtre de Mankiewicz ruine les studios de la Fox). Le cinéma classique, à son apogée durant les années 30 et 40, accepte les obligations des producteurs et les codes de la censure. Ces codes du cinéma classique sont comme une clé à la portée qui va colorer le film. Ils instaurent des pactes de lecture avec leurs spectateurs. Après deux ou trois minutes, grâce aux décors, aux costumes, on sait où l'on est, dans un film d'horreur, d'amour… Le pacte de lecture est très fort.
Les Straub entretiennent aussi un pacte de lecture avec leurs spectateurs mais ceux-ci sont en très petit nombre. C'est très différent d'un pacte qui doit être passé avec des millions de spectateurs en Amérique et d'autres millions de spectateurs dans le monde… en fait avec le plus grand nombre possible de spectateurs. Ce n'est pas seulement un pacte un peu paresseux mais une vraie vision du monde avec, par exemple, le happy-end nécessaire pour que les spectateurs sortent de la salle pacifiés et calmes.
Ford a cette volonté que tout le monde comprenne tout. Cela ne l'empêche pas de rendre compte plus finement de l'âme humaine.
Premières scènes de La
prisonnière du désert
Après les seize minutes que nous venons de voir la chasse commence.
Cette chasse ne se terminera que quatre minutes avant la fin. La lecture du
film est extrêmement balisée même si, aujourd'hui, il faut
comprendre que le carton sur fond noir "Texas 1868" signifie qu'il
s'est passé trois ans depuis la fin de la guerre de Sécession.
La poupée retrouvée sur la tombe dit clairement que la petite
fille a été enlevée. On la retrouvera avec les traits
de Nathalie Wood, âgée de 16-17 ans, soit 10 ans après
; 10 ans de vengeance pour retrouver Debbie.
Tout le monde comprend qu'il s'agit d'un western rien qu'en regardant le mur de briques du générique et le type de caractère typographique dans lequel il est écrit. L'art hollywoodien est ainsi bien une industrie comme l'a montré Chantons sous la pluie (Stanley Donen 1952) où l'on passe d'un genre à l'autre aussi facilement que d'un plateau de production à l'autre au sein du même studio. La célébrité de l'acteur implique également un type d'histoire. La star John Wayne ne peut incarner un salaud pur et dur. On peut certes avoir quelques doutes sur le personnage d'Ethan. Les dollars tout juste frappés ne sont pas encore marqués. John Ford a expliqué dans ses entretiens avec Bogdanovich que Ethan avait rejoint les troupes de Maximilien au Mexique où il a dû servir comme mercenaire. Ainsi, même s'il s'agit d'un frère respecté, dont la force d'attachement à cette famille est incontestable, il subsiste un doute fort sur le personnage d'Ethan. Le doute le plus fort étant en relation avec le sujet principal du film : le racisme.
Là, les éléments sont probablement moins lisibles. Ethan refuse la filiation symbolique avec Martin Pawley dont le huitième de sang Cherokee le révulse qu'il aurait pourtant dû assumer puisqu'il l'a sauvé lorsque sa famille a été massacrée. Cette filiation Ethan l'avait clairement établie avec Debbie lorsqu'il l'avait élevée au-dessus de lui. Ce geste est commun à beaucoup de cultures qui s'inclinent ainsi devant l'avenir en élevant au dessus d'eux ses représentants. C'est aussi un geste de respect envers la poursuite de la vie que l'on trouve par exemple chez Pialat dans Sous le soleil de Satan (1987). Le geste sert aussi à figurer l'écoulement du temps. Ethan se trompe en effet sur l'identité de l'enfant en soulevant Debbie dans laquelle il croit reconnaître Lucy qui est maintenant une jeune femme.
Les premiers plans avaient également mis en place un contraste très marqué. Nous sommes, spectateurs, à l'intérieur de la maison, dans le noir. Une porte s'ouvre et un étranger arrive. Le contraste lumineux est tellement fort qu'on ne peut pas ne pas l'avoir remarqué. Plusieurs fois, ce contraste reviendra entre un milieu noir protecteur et un milieu lumineux dangereux. En revanche, lors du massacre, on ne montre pas l'horreur (le seuil de tolérance a changé et probablement aujourd'hui le montrerait-on). On est dans le noir avec John Wayne, l'ombre n'est plus protectrice, elle est le lieu de l'horreur. La famille est parfois le lieu de l'ambivalence.
Dans les dialogues il est clairement dit que le projet de Ethan est de tuer Debbie car, pour lui, en ayant couché avec un indien, elle n'est plus humaine. Elle est ainsi promise à la mort par son propre oncle paternel qui préfère la tuer pour lui éviter des souffrances supplémentaires. Si Martin accompagne Ethan durant ces dix années, c'est pour l'empêcher de tuer Debbie lorsqu'il la retrouvera .
Fin de La
prisonnière du désert
Le racisme est résolu in extremis. Au moment où Ethan est près de Debbie quelque chose du vivant le touche et il réitère le geste de l'élévation. Pourtant il avait tout tenté pour empêcher Martin de la sauver, allant même jusqu'à lui révéler pour l'arrêter que sa mère avait été scalpée par Le Balafré. Puis lorsque Ethan était rentré dans la tente du Balafré, il l'avait le scalpé refaisant lui-même le geste qu'il reproche aux indiens. George Didi-Huberman dans L'image malgré tout (2004) signale que lorsque l'on interdit le rituel de l'autre alors qu'il est supposé ne rien signifier rien pour nous, c'est que l'on est, en même temps, fasciné par ce rituel ; ainsi des nazis interdisant la messe juive dans les camps d'extermination.
On a, bien-sûr, noté l'ombre protectrice de la grotte vers laquelle Debbie court se réfugier. La grotte est alors une sorte de ventre maternel, un lieu de protection pour Debbie, terrorisée. Même contraste enfin lorsque le héros repart. La symétrie avec la scène initiale est là parfaite. Certes il ne s'agit pas exactement de la même chambranle de porte. Le cinéaste donne au spectateur le plaisir de se sentir intelligent mais c'est le cinéaste qui cherche à produire ce sentiment chez le spectateur. Il le fait finement en modulant, en introduisant quelques changements. On n'est pas dans une série TV.
La prisonnière du désert n'est ainsi pas seulement l'histoire de la récupération d'une enfant enlevée par les Indiens. L'opposition entre ombre et lumière renvoie aussi à la relation entre Ethan et Martha. Sans que cela soit évident pour tout le monde, on comprend qu'autrefois quelque chose a eu lieu entre eux. Martha l'accueille en reculant, exécutant un mouvement presque sacré en lui faisant franchir le seuil de la maison. Le sacré suppose une séparation. Le sacré, l'intérieur du temple, s'oppose au (pro)fanum, l'entrée du temple. Quelque chose sépare aujourd'hui la grotte sacrée de la famille de la solitude et de l'aventure. A la fin, Ethan effectue un pas de côté pour que sa famille rentre à l'abris, la caméra recule dans la maison. Mais Ethan reste à l'extérieur et repart avec une démarche difficile exprimant peut-être sa souffrance de devoir repartir seul. Bogdanovich a révélé que la démarche mal assurée de Wayne était due à une soirée de beuverie la veille du tournage. Mais l'interprétation, un rien délirante peut-être, du retour douloureux à la solitude est plus intéressante.
Dans le système hollywoodien, les studios ont clôt aussi bien idéologiquement que financièrement le système visant à s'adresser au plus large public. Le Code Heys a d'abord été rédigé pour empêcher l'extérieur de censurer plus durement le cinéma. Rédigé le 31 mars 1930, il convient que le cinéma a des obligations morales du fait de la confiance que les gens lui accordent.
Cette censure est fascinante parce quelle est intelligente et vise juste. Elle n'est probablement pas bien pour autant mais il va s'avérer difficile de lutter contre des lois qui énoncent que " la sympathie du public n'ira jamais au péché, au vice ou au mal ". On pense notamment à Hitchcock qui a beaucoup de fascination pour les criminels et les perversions. Dès 1939, Dudley Nichols (1895-1960) scénariste de films de Ford, Hawks et Lang, dans des conférences, dénonce ces codes qui veulent s'occuper de la morale pour tous, chassent pour le grand public et s'adaptent au goût d'un enfant de six ans (le 4ème péché Hollywood.) Pour Dudley Nichols, une seule solution : il faut réduire les coûts des films pour s'adresser à des publics plus restreints.
Le Mépris se clôt par un travelling latéral qui suit
Ulysse découvrant sa patrie et se décale lentement par rapport
à lui pour ne fixer que la mer. Le travelling d'ouverture, qui sert
à énoncer le générique est un travelling différent,
sur la profondeur de champ. Il oppose une illusion de relief à une
clôture de l'espace. Car ce code de lecture, soit on le respecte jusqu'au
bout comme dans le cinéma hollywoodien, soit on le travaille pour arriver
à autre chose comme dans le cinéma moderne
Début du Mépris
Le cinéma moderne commence avec la chute de la Fox mais est également contemporain de la découverte de réalité des camps nazis après 1945, du Nouveau roman et de la Nouvelle vague qui introduisent une croyance différente dans la narration. Pour Godard, placer ainsi un élément à la fin, c'est rendre hommage au cinéma classique et même, avant cela, au théâtre classique à l'Italienne. La caméra de Raoul Coutard abaisse son museau sur nous puis on tombe dans une chambre à coucher pour une des plus célèbres scènes de Godard, largement parodiée. Or cette scène n'existait pas lors du tournage initial. Le film une fois terminé, le producteur Calo Ponti trouvait qu'il ne voyait pas assez Brigitte Bardo nue, seulement entr'aperçue ainsi dans une scène à la villa Malaparte de Capri. Il impose donc une autre scène de nu pour ce qui sera la plus godardienne de toutes les scènes du film. Godard ne joue pas, il accepte cette règle arbitraire et se la réapproprie. Dans le cinéma moderne, il y a franchissement du seuil du récit, c'est une métalepse pour reprendre le terme utilisé par Gérard Genette, l'auteur de Figure III. La métalepse consiste à franchir un seuil au sein d'un récit, à passer d'un espace à un autre. On dit qu'on raconte un récit. Le récit transgresse les règles d'un premier récit. Cette transgression est propre de l'Europe qui a vécu de près, dans sa chair, des bouleversements que les USA n'ont ressentis que de plus loin.
Question : Pouvez vous nous expliquer deux autres bouclages très visibles
: celui de la pancarte "No trespassing" dans Citizen
Kane (Orson Welles, 1940) et celui du jeune garçon qui pleure au
début et à la fin de La
nuit du chasseur (Charles Laughton, 1955)
Au début de Citizen Kane la caméra monte au dessus d'une grille sur laquelle figure " No trespassing " et transgresse l'espace personnel de Kane au moment de sa mort, moment intime par excellence. A partir du dernier mot prononcé, "Rosebud" va s'enclencher une enquête, une chasse comme celle de Ethan dans La prisonnière du désert. Seul le spectateur apprendra ce que signifie ce mot car l'enquête menée dans le film échoue. Dans les milliards de caisses laissées à la mort de Kane, des ouvriers viennent faire du vide et jettent des caisses au feu : sous une luge, sur laquelle jouait Kane enfant on distingue le mot "Rosebud". La luge est brûlée et l'on suit le parcours des flammes et la fumée qui s'échappe. Se clôt ainsi la vie d'un homme et l'on repasse à l'extérieur du domaine. On ne peut deviner la vie d'un homme en essayant de mieux connaître son intimité. Seul l'art permet de l'approcher.
Lorsque Laughton, en 1955, décide de réaliser La nuit du chasseur avec une équipe de production indépendante, il n'a joué au cinéma presque que des rôles de pervers. Il décide de faire ce film alors qu'il lit et commente la Bible à la radio.
On a bien la même scène au début et à la fin où le père (le vrai ou celui qui a incarné le mal en pourchassant les enfants, en pourchassant l'innocence) est arrêté par les flics et ce dans les mêmes conditions : sur une pelouse et jeté à terre par les flics. Mais, à la place du serment monstrueux, accepté par le fils au début du film de ne pas révéler où se trouve l'agent, l'enfant, à la fin éventre la poupée en criant : "No, no, it's too much".
Début de La
nuit du chasseur
Le noir et blanc très contrasté est dû à Stanley Cortez chef opérateur de La splendeur des Amberson (Orson Welles, 1942). La parabole de l'évangile : "C'est par leur fruit…" trouvera un écho à la fin du film lorsque John donnera comme cadeau à Lillian Gish une pomme entourée d'un napperon. Il inverse ainsi la malédiction liée à la pomme (fuite du Paradis, fruit du savoir défendu) lorsqu'elle était prononcé par Lillian Gish sur des images montrant le faux pasteur.
Le studio n'impose pas la visibilité totale, conséquence : il y a des restes. Le plus important étant tout ce qui reste sur la sexualité. Ruby, la jeune adolescente est fascinée sexuellement par Mitchum (on la comprend !). Pearl est fascinée aussi : la petite arrive avec des œufs et les laisse tomber par terre sur ses pieds : effet de sidération féminine devant la sexualité. Lillian Gish explique qu'il ne faut pas être fasciné, qu'il faut être prudente, mais elle offre une broche à Ruby ; elle lui donne aussi les moyens de la séduction. L'arrivée sur fond noir de Lillian Gish, grande actrice du muet, en 1955, l'apparente à un témoin du passé. A la fin, Lillian Gish, seule dans sa solitude de femme âgée, fait le ménage et regarde le spectateur "les enfants sont forts, ils sont capables de supporter ". Au début comme à la fin, on trouve bien la fameuse métalepse de Genette mais, là aussi, différente, non symétrique.
Jean-Luc Lacuve le 8/02/2004 (voir : synthèse).