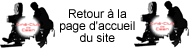|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Jean Collet

Remarquable ouvrage, aussi bien par son érudition, sa précision et la qualité d'analyse des œuvres de John Ford que pour son analyse de la représentation de la violence et de ses effets sur le spectateur.
Le cinéma à le pouvoir de répéter la violence à l'infini le temps d'un film alors que les arts anciens ne pouvaient que l'enfermer dans un instantané sur la pierre ou la toile. Elle était alors livrée au temps du spectateur et se trouvait ainsi médiatisée, considérée. Au cinéma seul un grand metteur en scène peut proposer une réflexion sur la violence :
Ainsi dans Le mouchard (1935) : ne pas montrer la délation mais sa conséquence l'homme prostré. Vers sa destiné 1939 (ne pas montrer très clairement le meurtre, qui l'a bien vu ? Pas le témoin meurtrier qui avait déclaré une lune inexistante pour décrire la scène), Je n'ai pas tué Lincoln (1936) Sam Mudd empêchant les prisonniers noirs de s'engager dans une révolte sans espoir. Désamorcer par la parole. L'homme tranquille (1952) Le soleil brille pour tout le monde (1953), L'homme qui tua Liberty Valance (1962) Seven women (1965).
Pour Jean Collet :
"
De tout temps, l'art intègre la violence, il ne la refuse pas, il "fait
avec ". De Lascaux à Picasso, en passant par les chapiteaux de
nos églises romanes, la violence fait hurler la lumière et la
pierre. Mais c'est pour la fixer, la retenir, la déployer dans des
formes et dans un temps qui permettent de la comprendre. Avant le cinéma
et la télévision, la violence habite l'histoire de la peinture,
de la sculpture. (..) Faut-il rappeler que la civilisation chrétienne
s'enracine dans la représentation d'un supplicié ? Et quel supplice
! Que penser aujourd'hui de cette image de torture offerte à tous les
regards depuis vingt siècles à travers l'Occident chrétien
? Bienheureux les peintres et les sculpteurs, car en figeant la violence,
en la pétrifiant sur le mur de la grotte, le bois de la croix ou la
pierre des cathédrales, en l'enfermant dans le cadre de la toile, ils
ont arraché cette violence au pouvoir des dieux, à l'illusion
sacrée, à la séduction de la toute puissance. Quelle
que soit l'horreur du geste violent, le voici suspendu, projeté dans
un autre temps. Il ne déchire plus, comme l'éclair, le temps
objectif de nos vies. Ainsi la violence peinte fond, si je puis dire, dans
la main de l'artiste, se confond avec le geste créateur. La voici désormais
livrée au temps de celui qui contemple l'image (...)Oui bienheureuse
l'image qui retient le geste et métamorphose la cruauté en objet
de contemplation. Par la magie de l'image, la violence sidérante est
devenue violence considérée. Elle a perdu son pouvoir de fascination
par le moyen de cette réflexion que constitue l'art.
Mais au cinéma ? Tout a changé par l'invention de la caméra,
le pouvoir non de suspendre le geste mais de le reproduire. Car le cinéma
au lieu de pétrifier la violence, la répète machinalement
; au lieu de la réfléchir, il en multiplie l'illusion. Non seulement
le cinéma répand à l'infini le pouvoir de fascination
du geste, mais il engendre un effet pervers : je peux arrêter le film,
le ralentir, l'accélérer, je peux même revenir en arrière,
faire que cela n'ai pas été. André Bazin avait bien vu
ce caractère propre à l'image filmée (Qu'est-ce que le
cinéma ? Mort tous les après-midi) : J'imagine la suprême
perversion cinématographique comme étant la projection d'une
exécution à l'envers ainsi que dans ces actualités cinématographiques
où l'on voit le plongeur jaillir de l'eau vers son tremplin ".
(…)
Bazin nommait ce nouveau pouvoir " l'obscénité métaphysique
du cinéma ; pouvoir de nier ce qui sépare la vie et la mort,
en répétant ce qui est irréversible.
(...)Comment un cinéaste regarde la violence, voilà la question.
Car regarder, c'est prendre le temps de voir, de bien voir, donc de fermer
les yeux aussi d'y regarder à deux fois comme on dit, changer de point
de vue, prendre du recul, réfléchir.