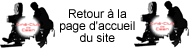|
|
|
|
|
L'histoire d'Adèle H.

 En voix off : "1863. Depuis deux ans, les États-Unis sont déchirés par la guerre civile. La Grande Bretagne va-t-elle reconnaître l'indépendance de la confédération sudiste et entrer en guerre contre les yankees ? Dès 1862, des troupes britanniques sont envoyées au Canada, à Halifax capitale de la Nouvelle Écosse, l'ancienne Acadie des Français. Il règne à Halifax une sorte de fièvre, on s’inquiète, on trafique, on fait la chasse aux espions yankees et sur le port les autorités britanniques contrôlent les voyageurs européens qui débarquent du Great Eastern, l'immense paquebot, surnommé la ville flottante".
En voix off : "1863. Depuis deux ans, les États-Unis sont déchirés par la guerre civile. La Grande Bretagne va-t-elle reconnaître l'indépendance de la confédération sudiste et entrer en guerre contre les yankees ? Dès 1862, des troupes britanniques sont envoyées au Canada, à Halifax capitale de la Nouvelle Écosse, l'ancienne Acadie des Français. Il règne à Halifax une sorte de fièvre, on s’inquiète, on trafique, on fait la chasse aux espions yankees et sur le port les autorités britanniques contrôlent les voyageurs européens qui débarquent du Great Eastern, l'immense paquebot, surnommé la ville flottante".
Adèle esquive le contrôle douanier d'Halifax. Un cocher, O'Brien, la conduit dans une pension tenue par son amie, Mme Saunders. Adèle se présente sous le nom de miss Lewly.
Le lendemain matin, elle va voir maître Lenoir qu'elle charge de retrouver le lieutenant Pinson, pour sa nièce dit-elle. Au retour, Adèle s’arrête dans une librairie où elle voit le lieutenant Pinson en compagnie d'une femme au travers des vitres sans oser rentrer. Ceux-ci partis, elle achète une rame de papier et prétend que le lieutenant Pinson est le beau-frère de sa sœur. Le libraire lui dit que le lieutenant est connu comme le loup blanc pour faire des dettes.
Le mari de Mrs Saunders se prépare à partir pour servir le banquet pour le 16e de hussard. Adèle lui donne une lettre pour le lieutenant Pinson qu'elle prétend être son "cousin", le fils du pasteur de son village avec lequel elle a été élevée et qui est amoureux d’elle. Après son départ, Mme Saunders regarde l’album de photos d'Adèle qu'a prises son frère. Adèle lui raconte la mort de Léopoldine et combien tout le monde l’aimait. Quand Mme Saunders s’apitoie, Adèle lui réplique sèchement : "Vous ne savez pas quelle chance vous avez eu d’être une enfant unique". Tard le soir, rentre M. Saunders qui raconte à Adèle comment fut brillant le lieutenant Pinson ; il prit la lettre, la lut et la remit dans sa poche. Adèle prétend qu’elle n’attendait pas de réponse mais ne peut cacher ses pleurs et monte dans sa chambre. M. Saunders dit alors à sa femme que le lieutenant, après avoir vu qui lui adressait la lettre, ne l’a pas même ouverte. Dans sa chambre, Adèle fait un cauchemar où sidentifiant à sœur, elle se noie.
Le lendemain, Adèle se rend à la banque où l’attend une lettre de ses parents mais pas le mandat espéré ; celui-ci, plus lent, mettra quinze jours de plus à arriver. Le soir, Adèle écrit à ses parents. Elle explique qu'elle est partie sans prévenir à cause des complications, pour une chose aussi simple qu'un amour partagé, allaient susciter dans la famille. Adèle, obsédée par l'idée du mariage, supplie son père de lui adresser son consentement écrit. Elle demande aussi à son père de lui verser, non seulement sa pension de mai et juin, mais toute celle de la fin d'année, tant la vie est chère à Halifax.
Le lendemain, sur les remparts de la ville, elle croit reconnaître le lieutenant Pinson, mais c’est un autre soldat qui la dévisage. Elle rentre chez Mrs Saunders pour écrire son journal dans lequel elle se promet de reconquérir Albert par la douceur. Quinze jours s'étant écoulés, Adèle reçoit le mandat promis.
Albert vient lui rendre visite chez Mme Saunders. Adèle, affolée, tarde à descendre et Albert va repartir quand elle descend enfin. Il veut qu’elle rentre à Guernesey, se sait méprisé par Victor Hugo et ne croit pas qu'Adèle reçoive jamais le consentement de son père. Il n'est d'ailleurs pas venu la demander en mariage et déclare seulement l'avoir aimé autrefois. Quand il se montre indifférent à l'argent que son mariage lui procurera, Adèle s'emporte et le menace de la dénoncer comme séducteur à ses supérieurs. Avant qu'il ne parte, elle lui donne tout son argent, faible par rapport à ses dettes mais qu' il accepte comme un prêt. Désespérée, Adèle se réfugie dans l'écriture d'une lettre passionnée. Dans la nuit, elle pratique le spiritisme appelant Léopoldine à l'aide. Elle suit le fiacre de Pinson se rendant chez sa maîtresse et les regarde faire l'amour. Dans son journal, elle se dit au delà de la jalousie et de l'orgueil et prône l'amour total que devrait aussi connaître prostituées et femmes mariées.
C'est l'hiver, Adèle va sous la neige et sans manteau, chercher deux rames de papier chez le libraire, qui lui en fait cadeau mais s'évanouit en sortant. Mr. Whistler vient lui porter deux rames de papier chez Mme Saunders. Adèle ne le reçoit pas. Elle écrit à ses parents leur demandant de lui envoyer leur consentement à son mariage et de l'argent. Le docteur Murdoch lui diagnostique un début de pleurésie. Par une lettre qu'Adèle avait demandé à Mme Saunders de poster et que celle-ci confie au docteur, il découvre qu'elle est la fille de Victor Hugo. Mme Saunders et le docteur Murdoch conviennent de respecter son anonymat. Adèle erre sur les remparts. Albert excédé de trouver des mots d'Adèle jusque dans sa veste déposée chez le teinturier. A la banque, Adèle reçoit l'argent demandé ainsi que le double consentement de ses parents à son mariage. Ainsi, au lieu d'avoir menti à un enfant en affirmant être Léopoldine, elle se ravise et donne son vrai prénom.
Un soir, elle vient trouver Albert dans une réception mondaine. Il l'entraîne à l'écart dans un cimetière adjacent où elle lui montre les lettres de consentement à son mariage de ses parents. Albert reste inflexible et lui demande de rentrer à Guernesey.
En réaction, dans la chambre où elle a dressé un autel à son amour, elle écrit une lettre à ses parents. Elle déclare s'être mariée et avoir besoin d'argent pour son trousseau. A Guernesey, la gouvernante de Hugo fait imprimer dans le journal le mariage d'Adèle avec Pinson.
À Halifax, le colonel de Pinson, lui lit l'annonce comme quoi il s'est marié à Paris le 17 septembre et lui demande de régler le malentendu au plus vite sous peine de cour martiale. Adèle reçoit une lettre affectueuse de son père l'informant que Pinson leur a écrit qu'il ne l'épousera pas . La santé de son mari déclinant, elle est priée de rentrer avec les 600 francs du mandat joint. Au lieu de cela Adèle répond en demandant à ses parents de supplier le lieutenant de l'épouser, seule condition à son retour. Quand Whistler lui offre les misérables d'Hugo, elle se fâche. Elle offre une jeune prostituée à Albert en signe d'admiration de sa beauté.
Dans un spectacle où elle a repéré Pinson en compagnie d'une jeune femme, Adèle est subjuguée par le numéro d'un hypnotiseur. Elle serait prête à débourser 5000 francs pour se faire épouser de force quand le complice de scène de l'hypnotiseur vient faire échouer l'escroquerie projetée. Le soir dans son lit, elle écrit dans son journal qu'elle est née de père inconnu et dans la nuit réveille Mme Saunders tant elle est effrayée par le souvenir de la robe de sa sœur exposée comme une relique.
Adèle lit dans le journal que Pinson est fiancée à Agnès Johnstone. Elle vient immédiatement demander à voir le juge, son père. Elle décrit Pinson comme un séducteur qui l'a épousée et dont elle attend un enfant. Elle vient rejoindre Pinson lors de son entraînement à cheval et enlève le coussin dont elle s'était affublé pour simuler une grossesse. Albert se voit refuser l'entrée des Johnstone. Il est excédé mais son aide de camp lui affirme qu'ils vont bientôt quitter Halifax.
Adèle quitte Mme Saunders qui croit qu'elle rentre chez elle, mais elle n'a plus d'argent et O'Brien la conduit dans un hospice où elle dort sur sa malle pour ne pas être volée. En haillons, elle va à la banque où Victor Hugo lui a envoyé 700 francs l'appelant de nouveau à lui. Elle erre en haillon dans les rues, la robe déchirée par les chiens. Elle fuit Mme Saunders qui fait ses courses au marché. Elle passe à côté d'un placard de journaux qui annoncent la mort de sa mère et le déplacement du 16e régiment de Hussards aux îles de la Barbade.
Malade, en butte aux moqueries, elle erre dans les ruesde la Barbade où elle ne reconnaît même pas Pinson qui la suit inquiet d'être de nouveau harcelé. Une femme noire, Mme Baa, la recueille, la soigne et écrit à Victor Hugo en se proposant de la ramèner chez lui.
Sur des photographies noir et blanc, une voix off énonce que Victor Hugo, rentré d'exil à la chute de Napoléon III, fit admettre Adèle dans un maison de santé à Saint Mandé où elle vécut encore 40 ans en continuant à tenir son journal en langage codé. Son père meurt en 1885 et connaît des funérailles nationales. La mort d'Adèle le 29 avril 1915 passa presque inaperçue au cœur de la grande guerre qui déchirait l'Europe. 50 années plus tôt avant de quitter Guernesey, Adèle avait écrit dans son journal : "Cette chose incroyable qui fait qu'une jeune fille marche sur la mer, passe de l'ancien monde au nouveau monde pour rejoindre son amant ; cette chose là, je la ferai".
 Une idée fixe qui règle la vie d'un être est le sujet d'un quart des films de Truffaut. C'est la face sombre de son œuvre, amorcée dès son quatrième film, La peau douce (1964) qui précède La mariée était en noir (1967) mais qui prend de l'ampleur dans ses derniers films avec ce film de 1975 puis L'homme qui aimait les femmes (1977), La chambre verte (1978) et La femme d'à côté (1981). Adèle est ainsi prise d'une idée fixe, celle d'un amour pour un homme qui la rejette. Cette idée fixe la protège de la folie dans laquelle elle finit par sombrer quand ce ressort est cassé. Elle erre alors dans le labyrinthe des rues de la Barbade. Le film occulte sa dépression à Guernesey et sa rencontre avec Pinson. Ce qu'il montre en revanche c'est qu'elle surinvestit dans l'idée fixe de cet amour parce que reconquérir sa place dans la famille paternelle la condamne à revivre la noyade de sœur dans cette grande robe blanche que Victor Hugo exposa trop longuement.
Une idée fixe qui règle la vie d'un être est le sujet d'un quart des films de Truffaut. C'est la face sombre de son œuvre, amorcée dès son quatrième film, La peau douce (1964) qui précède La mariée était en noir (1967) mais qui prend de l'ampleur dans ses derniers films avec ce film de 1975 puis L'homme qui aimait les femmes (1977), La chambre verte (1978) et La femme d'à côté (1981). Adèle est ainsi prise d'une idée fixe, celle d'un amour pour un homme qui la rejette. Cette idée fixe la protège de la folie dans laquelle elle finit par sombrer quand ce ressort est cassé. Elle erre alors dans le labyrinthe des rues de la Barbade. Le film occulte sa dépression à Guernesey et sa rencontre avec Pinson. Ce qu'il montre en revanche c'est qu'elle surinvestit dans l'idée fixe de cet amour parce que reconquérir sa place dans la famille paternelle la condamne à revivre la noyade de sœur dans cette grande robe blanche que Victor Hugo exposa trop longuement.
Une lettre et une femme qui marchent sur l'eau
L'écriture est le prolongement de cette idée fixe, le moyen de la faire vivre dans la réalité, du moins jusqu'à un certain point : ce sont d'abord les lettres adressées à Pinson, toutes inefficaces. Mais c'est surtout celle envoyée à ses parents une fois que, dans le cimetière attenant à la fête mondaine, Pinson lui a clairement exposé son refus de l'épouser, même avec le consentement obtenu de ses parents. La séquence s'ouvre sur la lettre en gros plan puis un panoramique va saisir Adèle, les mains jointes devant l'autel qu'elle a dressé à Pinson. Un troisième plan vient saisir son visage entre deux bougies puis zoome doucement sur lui captant une larme alors qu'elle regarde (quatrième plan) la photographie de Pinson vue en zoom avant. Un fondu enchaîné déploie ensuite son visage en surimpression sur l'océan alors qu'elle énonce le contenu de la lettre, son mariage avec Pinson. Par un nouveau fondu enchaîné c'est la carte qui apparaît en transparence avec l'océan avant de lui laisser toute la place. Dans ce huitième plan, l'océan agité par l'étrave arrière du bateau invisible mais qui implicitement transporte la lettre, jusqu'à ce que la carte de Guernesey apparaisse à nouveau en surimpression avant de laisser la place à l’île qui dans un panoramique va saisir la maison de Victor Hugo. Le trajet de la lettre se poursuit, tenue bien visiblement par la gouvernante qui la tient à la main, faisant l'objet d'un insert et atteignant ensuite l'imprimerie du journal ou sera annoncé le mariage d'Adèle.
De la lettre posée du premier plan, au vingtième plan où elle a déclenché la l'écriture d'une autre lettre par Victor Hugo et sa lecture par le directeur du journal, Truffaut aura ainsi magnifié le pouvoir d'Adèle, par son esprit puis par l'écriture, de rendre vrai un temps son idée fixe. Cette lettre a visuellement marché sur l'eau. Elle ne connaît pas le sort de Léopoldine noyée. Cette performance est accomplie par l'esprit d’Adèle, Truffaut en fait la conclusion magnifique de son film. Alors qu'on pourrait le croire clôt par la série de photographies en noir et blanc narrant la fin de ses jours, apparaît soudain Isabelle Adjani en Adèle avec en voix off : "50 années plus tôt avant de quitter Guernesey, Adèle avait écrit dans son journal : Cette chose incroyable qui fait qu'une jeune fille marche sur la mer, passe de l'ancien monde au nouveau monde pour rejoindre son amant. Cette chose là je la ferai".
On est là bien loin des habituels fins de biopics où une photographie du personnage réel vient attesté de sa ressemblance avec l'acteur. C'est en effet, le visage d'Adjani qui est au cœur du film.
Un visage déterritorialisé
Née en 1830, Adèle Hugo est censée avoir 33 ans au début du récit alors qu'Isabelle Adjani, révélée un an auparavant dans l'école des femmes à la comédie française puis La gifle (Claude Pinoteau, 1974) n'a que 19 ans. Truffaut la convainc d'abandonner la Maison de Molière pour tourner avec lui. Il lui écrit :
Vous êtes une actrice fabuleuse et, à l'exception de Jeanne Moreau, je n'ai jamais senti un désir aussi impérieux de fixer un visage sur la pellicule, tout de suite, toutes affaires cessantes. J'accepte l'idée que le théâtre est une noble cause, mais ma chose à moi est le cinéma et, en sortant de La Gifle, j'ai eu la conviction que l'on devrait vous filmer tous les jours, même le dimanche.
C'est en efffet, le visage d'Isabelle Adjani que ne cesse de filmer Truffaut. Très peu d'événements dramatiques interviennent dans le film, les lieux sont réduits (La banque, la chambre chez Mme Saunders, quelques extérieurs filmés majoritairement de nuit; pas de ciel même à la Barbade). Beaucoup d'éléments reprennent le thème de l'écriture : les lettres écrites ou disposées dans la veste de Pinson, les rames de papier achetées chez Whistler, le libraire, l'encrier que tient David, l'enfant à la banque. Peu de scènes sont reliées entre elles par un lien de cause à effet ou par une quelconque continuité temporelle. De nombreux fondus au noir viennent au contraire isoler les séquences les unes aux autres. Le temps ne passe pas; il se répète.
Sur les soixante-treize segments du film, vingt huit se passent la nuit; dix neuf sont muets et onze n'ont pour seul accompagnement sonore que le texte du journal ou des lettres d'Adèle. Cette triple absence d'enchaînement temporel, de lumière et de dialogues vient suspendre le cours de la logique diurne pour soumettre le déroulement du récit aux courts circuits de l'imaginaire.
Lyrisme truffaldien
La fin avec Adèle affirmant qu'elle va marcher sur l'eau, l'autel dressé et l'appel à l'enfance relèvent d'un lyrisme typiquement truffadidien. L'autel dressé à Pinson rappelle celui du jeune Antoine dressé en remerciement à Balzac dans Les 400 coups. L'empathie avec l'enfance se déploie ici quand Adèle rejoint David dans la petite niche sous l'écritoire, espace protégé où s'est réfugié l'enfant; elle s'affirme alors être Léopoldine ou du moins son équivalent dans le cœur de son père. Ce n'est que quand elle a obtenu ce qu'elle espère de sa vie d'adulte qu'elle revient vers l'enfant et assume son identité. Elle est Adèle. En lui préférant sa sœur, Victor Hugo a aliéné l'identité de sa fille cadette. Si le titre du film occulte son patronyme, ce n'est pas tant pour laisser planer un mystère sur l'identité d'Adèle, que pour refléter ce manque fondamental d'identité. Le seul ressort dramatique du film est de montrer comment l'imagination fertile d'Adèle lui permet de survivre dans cette situation intenable. Son visage, à jamais celui d'Adjani, reste intacte, seule sa robe et le châle de Mme Saunders deviennent haillons.
Jean-Luc Lacuve, le 17 octobre 2025