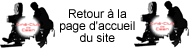|
|
|
|
|
Alice Guy |
 |
|
(1873-1968) |
||
| 1 000 films | ||
 |
6 | |
Suite à la faillite de l’entreprise familiale au Chili et aux décès successifs de son frère et de son père, Alice Guy, alors âgée de 17 ans, s'installe à Paris avec sa mère. Pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère, elle étudie la sténodactylo. En 1895, elle postule pour entrer dans une société de photographie parisienne et est reçue par hasard par Léon Gaumont. Quand il lui fait remarquer qu'elle est bien jeune; elle lui répond "cela me passera vite". Il l'engage alors. A la toute fin du XIXe siècle, la société Léon Gaumont et Compagnie a pour objet la fabrication et la vente de matériel photographique. C'est donc pour commercialiser son chronophotographe que Léon Gaumont souhaite présenter à ses clients des vues animées. En mars 1895, Alice Guy, représente sa société lors de la projection des vues Lumière au congrès de la photographie à Lyon. Elle est alors persuadée qu'il est possible de filmer autre chose que les sujets choisis par les frères Lumière : des sorties d'atelier, des vues de train... "Il me semblait qu'on pouvait faire mieux", dit-elle.
Dès février 1896, Alice Guy met en scène ses premiers courts métrages, en démarrant par La Fée aux choux, une scène d'une minute, considérée comme le premier film mettant en scène un personnage imaginaire, tournée dans un jardin clos à Belleville, avec quelques amis. Elle en tournera ensuite une version identique en 1900, qui est la seule conservée aujourd'hui. Léon Gaumont met bientôt à disposition de sa secrétaire une petite partie de son usine pour qu'elle y construise un studio de réalisation et lui confie les rênes du département de production de sa société.
Alice Guy dirige ainsi son studio et tourne près de 400 films devenant la première femme tout à la fois scénariste, productrice et réalisatrice. En 1898 et 1899, elle réalise une série de 10 tableaux sur la vie du Christ qui connaissent un grand succès. Elle manie avec maestria les changements d'échelle de plans dans Madame a des envies (1906).
En 1906, Alice Guy concrétise l'ambition historique de son cinéma à travers la réalisation de son premier moyen métrage : La vie du Christ en 25 scènes (0h35) qui nécessite une centaine de figurants et vingt-cinq décors.
Elle réalise le premier making off (Alice Guy tourne une photoscène, 1907) et, 15 ans avant Buster Keaton, une course poursuite avec une accumulation de péripéties au sein de plans successifs où les acteurs sont dirigés avec précision (La course à la saucisse). Elle réalise aussi des captations documentaires depuis Baignade dans un torrent (1897) jusqu'à des chorégraphies proches de celles de Loïe Fuller.
C'est à regret qu'elle part à New York pour suivre son mari, chargé de la production américaine des films Gaumont. Elle devient néanmoins une figure dominante du cinéma outre-Atlantique, produisant notamment les premiers films de Charles Chaplin, elle fait construire un gigantesque studio, Solax, implanté dans le New Jersey à Fort Lee. Contrairement à tous les usages, elle pose des petites pancartes à l'intention des comédiens : "Soyez naturels !", les exhorte-t-elle. Rien ne semble l'effrayer : ni les tournages avec des animaux sauvages ni les cascades imposées aux comédiens... En 1912, Alice Guy-Blaché est la seule femme qui gagne aux Etats-Unis plus de 25 000 dollars par an. Ce qui n'empêche pas son mari de faire l'erreur de vendre les droits de The Lure (1914), qui fut pourtant un immense succès au box-office américain, pour une bouchée de pain.
En 1919, son mari la quitte pour une actrice et part à Hollywood, la nouvelle grande cité du cinéma. Elle le rejoint un temps sur la côté ouest et, l'espace de deux films, l’assiste sur ses tournages. Mais c’est la fin. Le couple divorce. Elle est dévastée. Un malheur ne venant jamais seul, en 1921, Alice Guy est contrainte de vendre son studio de Fort Lee pour apurer des dettes en grande partie dues à la mauvaise gestion d'Herbert Blaché. Divorcée et ruinée, elle rentre en France en 1922 avec ses deux enfants à charge. Elle tente de se refaire une place dans le monde du cinéma mais il est trop tard. On l’a oubliée. Elle ne tournera plus jamais.
A presque 50 ans, elle se met à écrire de petits contes pour enfants qu'elle vend à des revues pour assurer l'éducation de ses deux adolescents. Devenue adulte, sa fille, Simone, décroche un emploi à l’ambassade américaine. Dès lors, Alice Guy la suivra dans tous ses déplacements. A 80 ans, la pionnière du cinéma rédige ses mémoires mais sa contribution au 7e art a été oubliée et le crédit de certains de ses films ont été attribués à d’autres. Faute d’éditeur, l'ouvrage ne paraîtra qu’après sa mort.
Elle entreprend enfin un dernier combat : récupérer ses films. Elle passera les dernières années de sa vie à la recherche de ses bobines. Elle qui fut l’une des réalisatrices et productrices les plus prolifiques de son temps, n'en retrouvera que trois de son vivant. En 1968, elle meurt à l’âge de 95 ans, dans l’indifférence aux Etats-Unis, où elle s'est installée à nouveau sur la fin de sa vie, avec sa fille. A deux pas de son ancien studio.
A peu près 130 films sur les quelque 1000 qu'Alice Guy aurait écrit, réalisé et produit sont aujourd'hui conservés.
Filmographie très sélective :
| 1896 | La fée aux choux |
| Film perdu, rejoué en 1900 | |
| 1898 | Jésus devant Pilate |
| 1898 | Le jardin des oliviers |
| 1898 | La fuite en Egypte |
| 1898 | Flagellation |
| 1898 | Entrée à Jerusalem |
| 1898 | Crèche à Bethléem |
| 1898 | le chemin de croix |
| 1898 | La cène |
| 1899 | La descente de croix |
| 1899 | Crucifiement |
| 1898 | Entrée à Jerusalem |
| 1900 | La fée aux choux |
 |
Nouvelle version de ce qui a probablement été le premier film avec un personnage de fiction en 1896. |
| 1906 | La vie du
Christ en 25 scènes  |
 |
Premier moyen métrage (0h35) : La vie du Christ en 25 scènes. Ce film est également intitulé La passion ou encore Naissance, la vie et la mort de notre seigneur Jésus -Christ. |
| 1906 | Madame a des envies  |
 |
|
| 1907 | Alice Guy tourne une photoscène |
| 1907 | La course à la saucisse  |
 |
Une course poursuite de 4' en 15 plans |
| 1911 | Roads Leads Home |
| Le fils de Mme Hurley, une vieille dame fortunée, fait la connaissance d'une actrice et l'épouse, malgré les ordres de sa mère. Mais il délaisse bientôt sa nouvelle épouse au profit de la haute société… | |
| 1911 | Mixed Pets |
| Avec : Blanche Cornwall (La femme de chambre), Frances Gibson (Mrs. Newlywed). 0h14.
Mr. Newlywed refuse que sa femme ait un chien. Son oncle, pris de pitié pour elle, part en acheter un. Pendant ce temps, Wilkens et sa femme, majordome et femme de chambre des Newlywed, apprennent qu'ils doivent récupérer leur enfant « secret » auprès d'amis qui la gardaient. L'oncle rentre avec le chien, un adorable chiot, et le montre à sa nièce. Il le cache dans le buffet. M.Newlywed montre à l'oncle un article de journal sur un chien enragé en liberté à Passaic. Rapidement, l'oncle fait sortir le chiot de sa cachette et le garde dans son manteau. Les Wilkens apportent leur bébé et le cachent dans le même buffet ! Mme Newlywed se sent coupable et écrit un mot à son mari lui disant de regarder dans le buffet et de ne pas trop se mettre en colère, car elle ne le trompera plus jamais. Il regarde et, voyant le bébé, crie et fait entrer tout le monde dans la pièce, y compris l'oncle avec le chiot. Bientôt, tout s'arrange et tout se termine bien. |
|
| 1911 | Greater Love Hath No Man |
| Avec : Romaine Fielding (Jake), Vinnie Burns (Florence), Ed Brady. 0h18.
Dans la petite ville minière de Gatlach, à l'est du Nouveau-Mexique Florence et Jake s'aiement. Un nouveau surintendant, Harry, arrive pour prendre en charge la mine. Le nouveau venu rencontre Florence et ils s'éprennet l'un de l'autre. Le mécontentement grandit parmi les mineurs mexicains. Ils font grève et se présentent au bureau avec des exigences que le surintendant refuse aussitôt et leur ordonne de quitter les lieux. Ils se retirent pour s'armer, puis planifient une attaque contre le bureau et la mort de leur patron. Jake surprend le complot et, bien qu'il éprouve du ressentiment envers Harry, décide de les sauver pour Florence. Il se précipite au bureau et les prévient juste au moment où la foule apparaît. Poursuivis, ils se réfugient finalement dans un passage étroit. Avec un seul cheval, la fuite est impossible pour le groupe. Jake force Harry et Florence à prendre le cheval et F à s'enfuir. Ils partent alors en quête d'aide, qui se présente sous la forme d'une troupe de cavalerie en reconnaissance. Ainsi renforcés, ils se précipitent au secours de Jake, mais trop tard, il a livré son dernier combat et sacrifié sa vie pour ceux qui lui sont chers. |
|
| 1912 | The Girl In The Arm-Chair |
 |
Avec : Blanche Cornwall (Peggy), Mace Greenleaf (Frank Watson), Lee Beggs (L'usurier). 0h10.
Frank Watson passe un mois à New York lorsqu'un jou rlorsqu'il reçoit une lettre de son père qui lui demande de rentrer et lui annonce qu'une surprise l'attend à son retour. Arrivé chez lui, Frank aperçoit une très jolie jeune fille assise près de la cheminée, semblant parfaitement à l'aise mais qui quitte aussitôt la pièce. Juste à ce moment-là, ses parents arrivent et Frank les interroge sur la jeune fille. Son père lui apprend qu'elle se pénome Peggy et est la fille de son meilleur ami qui vient de mourir et en est désormais son tuteur. Bien que Peggy ait hérité d'une importante fortune, Frank désapprouve cette décision et commence à formuler ses objections. Au même moment, Peggy descend l'escalier et surprend par hasard les propos de Frank. Elle entre dans la pièce et ils sont présentés. Six mois plus tard, Frank est en mauvaise posture. Il s'est mis à jouer et a du mal à régler toutes ses dettes. Il doit actuellement 500 dollars à un Juif très avare qui a le billet à ordre de Frank à payer dans une semaine. Le pauvre Frank est presque à bout de nerfs, car il n'a aucun moyen de s'acquitter de cette dette. Le jour J Frank attend nerveusement l'arrivée du Juif. Il apprend que Frank est incapable de payer et jure d'aller voir son père pour le payer. Frank supplie de ne rien dire à son père. Le Juif scrute la pièce afin de trouver un moyen de forcer Frank à payer. Soudain, il remarque un petit coffre-fort sur le bureau, marqué "Coffre fort d'urgence". Après de longues discussions, le Juif persuade Frank de retirer son paiement de ce coffre-fort, espérant le récupérer et le remettre avant que son père ne s'en aperçoive. Frank prend l'argent, obtient un reçu du Juif et lui ordonne de sortir. Frank quitte aussitôt la pièce. Soudain, on voit Peggy se lever du grand fauteuil près de la cheminée. Elle a entendu par hasard tout ce qui s'est passé entre eux à leur insu et comprend immédiatement la situation de Frank. Elle décide de l'aider à se sortir de ce pétrin. Plus tard, on la voit entrer dans le salon, prête à partir, une valise à la main. Elle dépose une lettre sur la table pour le père de Frank, puis quitte la maison. La jeune fille a fait ce magnifique pour sauver Frank. Plus tard, Frank reconnaît sa culpabilité et demande pardon à la jeune fille qu'il a appris à aimer. |
| 1912 | The Sewer |
| Avec : Darwin Karr (John Stanhope), Magda Foy (Oliver), William Leverton (Herbert Moore), John Leverton (Stuart). 0h20.
Herbert Moore dirige une bande de malfaiteurs avec son ami Burley Butts, une brute. Ensemble, ils projettent de dévaliser le célèbre philanthrope M. Stanhope. Pour leurs funestes desseins, ils utilisent le petit Oliver, l'un des élèves réticents de Butts. Par une nuit noire, ils se lancent dans leur entreprise. Oliver entre dans la maison muni d'une lanterne mais se retrouve face au canon d'un revolver. M. Stanhope est surpris de voir le jeune criminel. Il l'interroge. Le petit Oliver pleure et raconte son histoire. Stanhope est ému par le récit du garçon. En sortant son mouchoir pour s'essuyer les yeux, Oliver laisse tomber une pièce de monnaie en argent. M. Stanhope tente de la rendre à Oliver, qui le repousse et lui dit de le garder, l'informant que ce demi-dollar en argent est l'insigne du gang et qu'il peut s'ouvrir en deux et servir en cas d'urgence de scie pour couper de la corde, du fil de fer ou du verre. Intrigué, Stanhope glisse le petit souvenir dans sa poche. Oliver supplie alors d'être libéré, et Stanhope le laisse partir, après avoir juré de ne plus tenter de voler. Cette tentative échouant, le gang tend un piège à Stanhope, mais le petit Oliver remet un mot et une clé à son bienfaiteur lorsque les voyous le descendent dans son étroite cellule. Stanhope lutte avec acharnement pour se libérer de ses liens qui le blessent jusqu'aux os. Il parvient à se libérer suffisamment pour récupérer le demi-dollar en argent avec lequel il brise ses liens. Il tente de se redresser et trouve la lourde clé et le mot dans la poche de son manteau. Il cherche la serrure secrète puis ouvre la porte de granit et se retrouve dans les égouts. Il rampe vers la sortie dans la puanteur des flaques d'eau stagnantes, des déchets des fosses septiques, de la boue. Même une horde de rats d'égout ne le détourne pas de son chemin. Couvert de boue et de crasse, échevelé et débraillé, il se précipite à travers les rues et se rend au commissariat. La bande est bientôt arrêtée et le petit Oliver et son frère trouvent refuge dans la joyeuse maison de M. Stanhope. |
|
| 1913 | Officer Henderson |
| Avec : Fraunie Fraunholz (M. Henderson), Marian Swayne (Mrs. Henderson). 0h14.
Deux policiers de Newark se font passer pour des femmes. L'agent Henderson attire l'attention indésirable d'un homme amoureux et la suspicion de sa femme. |
|
| 1914 | The lure  |
| 1913 | Making an American Citizen  |
| 1916 | The ocean waif  |
 |
Avec : Doris Kenyon (Millie), Carlyle Blackwell (Ronald Roberts), William Morris (Hyp Jessop), Fraunie Fraunholz (Sem), Edgar Norton ( Hawkins, Le majordome). 0h35. Une orpheline fuit dans un manoir abandonné bientôt occupé par un riche écrivain... |