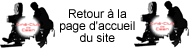|
|
|
|
|
S’il n’existe donc pas de « leçon inaugurale » de Jean-Luc Godard, l’homme, le cinéaste, le penseur, n’a cessé d’en faire, souvent sous forme de jeux sur les mots, de boutades, de paradoxes, composant un livret qui, depuis « Le cinéma, c’est la vérité vingt-quatre fois par seconde » à « Pas juste une image, une image juste », s’est imposé comme le bréviaire haïku des temps contemporains à l’usage des « professionnels de la profession », mais pas que…
C’est pour cela que Godard est un moraliste. Comme il l’a dit dans une célèbre formule, lors d’un débat sur Hiroshima mon amour, publié dans les Cahiers du cinéma, en juillet 1959 : « Les travellings sont affaire de morale. » Ce qui n’appartient qu’au cinéma, à savoir une manière de filmer, une mise en scène, des mouvements de caméra, des gros plans, des travellings, qui expriment à eux seuls une idée du monde, une vision politique, une morale.
Jean-Luc Godard trouvera in fine la juste formule pour dire ce processus de captation du monde et sa métamorphose en un style : « Une pensée qui prend forme, une forme qui pense », magnifique aphorisme, décisif, apparu sur le visage de Roberto Rossellini, son maître jusqu’au bout, dans un épisode des Histoire(s) du cinéma.
Godard a dit son amour de la formule, qui remonte, chez lui, à la pratique enfantine du jeu sur les mots : « J’ai un penchant pour l’aphorisme, la synthèse, le proverbe. L’aphorisme résume quelque chose tout en permettant d’autres développements. Comme un nœud : il pourrait être fait dans d’autres sens, n’empêche que, quand il est fait, le soulier tient. Ce n’est pas seulement la pensée, c’est la trace de la pensée » (Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard). Un mode de pensée et une manière de penser que Godard utilisa souvent de façon originale : l’intervention médiatique, télévisuelle, radiophonique, tribunicienne. Il a imposé ce personnage du mauvais génie de la communication, du trublion des images.
Ce rôle de bouffon, de renvoyer au système ses quatre vérités, portant sur lui l’étoffe du mythe, penseur du cinéma, est bien repéré par Serge Daney, à Cannes, en 1985. « Une conférence de Godard, c’est un rite en soi, l’un des rares qui dérident encore les festivaliers usés par la langue de bois du showbiz. Pourquoi le rite fonctionne-t-il si bien ? Parce que Godard joue le jeu, parce qu’il prend au sérieux toutes les questions. Simplement, il les déplace subrepticement, il les ironise méchamment et même, il leur répond sincèrement. Comme on dit au tennis, il “renvoie toutes les balles”. Si le cinéma était un royaume, Godard serait son fou, celui dont on attend qu’il fasse preuve de maîtrise en disant que le roi est nu, en disant la vérité d’une façon imprévisible et drôle. Il réussit à enrôler le calembour au service de la vérité. Et vice versa. Semi-candide, il fait comme s’il ne comprenait rien à ce rôle de maître où tout le monde tient à le mettre. Il y a de la politique là-dedans, les restes humoristiques (de Brecht à Mao) d’une utopie un peu terrible et une remise en question quotidienne des pratiques du cinéma et de l’audiovisuel » (Libération, 13 mai 1985).
Aragon dans la revue Les Lettres françaises : « Qu’est-ce que l’art ? Je suis aux prises de cette interrogation depuis que j’ai vu le Pierrot le fou, de Jean-Luc Godard, où le sphinx Belmondo pose à un producer américain la question : “Qu’est-ce que le cinéma ?” Il y a une chose dont je suis sûr, aussi, puis-je commencer tout ceci devant moi qui m’effraye par une assertion, au moins, comme un pilotis solide au milieu des marais : c’est que l’art d’aujourd’hui, c’est Jean-Luc Godard. » Ainsi commence l’article « Qu’est-ce que l’art, Jean-Luc Godard ? », éloquent éloge du poète à un jeune cinéaste en qui il distingue un avatar des inventeurs de la peinture moderne.
Voilà qui motive Jean-Luc Godard, qu’on retrouve à la fois contributeur du film collectif Loin du Vietnam (1967), soutien des ouvriers en lutte de la Rhodiacéta à Besançon, qui s’approprient les moyens du cinéma sous le nom de « groupes Medvedkine » (1967), défilant pour Henri Langlois menacé d’être démis de la Cinémathèque française (février 1968), pendu à un rideau du Palais pour interrompre le Festival de Cannes par solidarité avec la révolte étudiante (mai 1968).
On le trouve aussi réalisateur anonyme de « cinétracts » d’inspiration situationniste durant mai 1968, puis d’un bilan provisoire du mouvement dans Un film comme les autres (juin 1968), tourné à Flins – ultime et sanglant bastion de la révolte, le lycéen Gilles Tautin y trouvant la mort – où il recueille la parole des ouvriers des usines Renault.