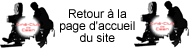|
|
|
|
|
À pied d'œuvre 
 Paul Marquet a abandonné depuis quelques années le métier de photographe pour lequel il gagnait en moyenne 3 000 euros par mois parfois 8 000. Depuis, il vit sur les 300 € par mois de droits d'auteur de ses photographies car ses trois précédents romans, succès d'estime de la critique, ne lui ont rapporté que de maigre à-valoir. Sa femme le quitte et part pour le Canada où elle assurera, comme elle l'a toujours fait sans doute, la fin de l'éducation de leurs deux grands enfants. Le père et la sœur ne comprennent pas, et le lui font durement savoir, son entêtement à vivre, à la la frontière de la clochardisation : Paul ne devant qu'à une cousine le prêt d'un local en sous-sol, alors qu'il a dû rendre son luxueux appartement. Son éditrice, Alice Bosquet, refuse en l'état son manuscrit, "Histoire d'une fin", sur une rupture amoureuse, qu'elle juge inapproprié au contexte social anxiogène.
Paul Marquet a abandonné depuis quelques années le métier de photographe pour lequel il gagnait en moyenne 3 000 euros par mois parfois 8 000. Depuis, il vit sur les 300 € par mois de droits d'auteur de ses photographies car ses trois précédents romans, succès d'estime de la critique, ne lui ont rapporté que de maigre à-valoir. Sa femme le quitte et part pour le Canada où elle assurera, comme elle l'a toujours fait sans doute, la fin de l'éducation de leurs deux grands enfants. Le père et la sœur ne comprennent pas, et le lui font durement savoir, son entêtement à vivre, à la la frontière de la clochardisation : Paul ne devant qu'à une cousine le prêt d'un local en sous-sol, alors qu'il a dû rendre son luxueux appartement. Son éditrice, Alice Bosquet, refuse en l'état son manuscrit, "Histoire d'une fin", sur une rupture amoureuse, qu'elle juge inapproprié au contexte social anxiogène.
Paul s’entête, s’installe dans son sous-sol, éclairé par un soupirail et dresse méthodiquement la liste de ses dépenses et ses recettes. Il inscrit aussi sur son petit carnet les missions qu'il accomplit sur la plateforme Jobbing où des clients proposent des travaux à domicile – jardinage, bricolage, déménagement… – au moins-disant. Pour préserver sa liberté d'écrire, Paul accepte des petits boulots mal payés, jamais plus de 20 ou 30 euros pour une demi-journée de travail souvent harassante : taille de pelouse au sécateur, déblayage de gravas, montage d'une armoire, démontage d'une mezzanine, désempotage de 16 jardinières et taxis. Dans ce dernier job, Paul rencontre par hasard son ex-collègue photographe, Pierre Lautrec, gêné, qui aiderait bien Paul s'il acceptait au moins des tâches plus nobles (ateliers littéraires, cours, conseils...) au niveau de sa classe sociale. Paul se sent exclu de la vie familiale, de l'anniversaire de sa fille auquel il envoie pour pour cadeau de ses 18 ans une photographie de ses sept ans rêvant de nuage qui la laisse indifférente.
Paul rencontre aussi une femme triste qu'il conduit chez elle en banlieue avec laquelle il passe une nuit. Au retour, il heurte un chevreuil et, désespéré de devoir achever l'animal en l'étranglant, tente au moins d'en tirer de la viande. Son père survient, se met en colère et casse son ordinateur.
Désespéré, Paul s'affale sur la table du bar-tabac où il a ses habitudes. La propriétaire le réconforte et lui offre son arrière-salle pour se reposer. Elle découvre son carnet et lui suggère que ce pourrait être la matière première de son récit. Pierre rédige son autobiographie sur des cahiers à spirales et les remet à son éditrice. Alice les fait taper et tombe sous le charme de son écriture. Le roman de Paul est édité. Son fils se dit ému par son livre et fier de lui. Paul continue ses petits boulots mais pas le matin : "le matin, j'écris" lance-t-il, fier de lui, à une cliente" qui n'en demandait pas tant.
![]() L'écriture de Franck Courtès sublimait par l'ironie le dur travail qu'on imaginait qu'il avait fait. Ici la voix off de Paul est présente dès l'abord, superposée au travail, dévitalisant durant son filmage la dureté de celui-ci. Le film se reduit alors à une série d'anecdotes illustrant sur un cas très particulier l'exploitation capitaliste de la misère.
L'écriture de Franck Courtès sublimait par l'ironie le dur travail qu'on imaginait qu'il avait fait. Ici la voix off de Paul est présente dès l'abord, superposée au travail, dévitalisant durant son filmage la dureté de celui-ci. Le film se reduit alors à une série d'anecdotes illustrant sur un cas très particulier l'exploitation capitaliste de la misère.
Un second degré permanant
Donzelli semble avoir conscience du manque d'écart entre la réalité, que le cinéma ne peut manquer d'incarner, et sa sublimation par la mise en scène, ici toute dévolue à la voix-off. La constance de celle-ci, ironique, cruelle et littéraire nie le premier degré de réalité. La réalisatrice introduit alors les passages en super 8 qui pourraient être garant d'une réalité plus grande (ce sont d'ailleurs des plans de repérage). Mais ils jouent à l'inverse le rôle de remémoration, d'espace mental se surajoutant donc à la voix off. Sans poids de réel, ces moments de super 8 deviennent des afféteries de mise en scène.
Cette absence d'un travail au premier degré (emblématique ce premier plan symbolique d'un mur décoratif qu'on abat) est redoublée d'une incapacité à montrer le travail d'écriture. Paul tape sans conviction son "Histoire d'une fin" dont on ne saura rien. Seul un coup de théâtre, le carnet qui tombe et qui offre, via la gentille propriétaire du bar-tabac, un sujet pour un roman tout cuit (écrit à la main, c'est plus classe) à l'auteur.
Une fin pénible
La fin à triple détente est encore plus pénible : l'échange téléphonique tire-larmes avec le fils qui retrouve son père mais seulement au moment de la publication avec des propos dignes d'un bon élève d'école de commerce : la misère vaut le coup quand elle est sanctifiée par le succès.
La tirade finale contre les plateformes d'exploitation de la misère (car rien n'échappe à l'exploitation capitaliste) est un peu indécente au moment où elle sert finalement au succès de Paul qui avoue tout de même n'être pas le plus malheureux des travailleurs pauvres. Mais l'élargissement au cas personnel de Paul est absent. Il ne fait l'objet que d'un bref échange de regard avec le jeune manœuvre qui ne le reconnaît pas.
Le pire est pour la fin : le mépris de classe de Paul ne pouvant s'empêcher de renvoyer sa cliente à son statut social inférieur : "Le matin, j'écris" lui lance-t-il, fier de lui, alors qu'elle n'en demandait pas tant.
La belle voix de Bastien Bouillon avait énoncé la maxime de Franck Courtès : "Achever un texte ne veut pas dire être publié, être publié ne veut pas dire être lu, être lu ne veut pas dire être aimé, être aimé ne veut pas dire avoir du succès, avoir du succès n'augure aucune fortune ». Le film lui en apportera-t-il une plus grande ?
Jean-Luc Lacuve, le 11 février 2026.