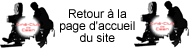|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Le Visite à Picasso de Paul Haesserts est sans doute problématique car en 1949, Picasso a quitté le cubisme depuis longtemps et c'est bien ce qu'on voit dans le court extrait sur Youtube. Néanmoins c'est solide, porteur (le film est rare) et... pas mieux aujourd'hui.
Il serait intéressant, à mon avis, de se procurer: Berenice B. Rose (dir.), Picasso Braque and Early Film in Cubism, New-York, Pacewildenstein, 2007. Est-il possible de la faire acquérir par le musée ? Autre possibilité : en faire la demande auprès de l'Esam
J'ai trouvé la référence dans cet excellent article : François Albera, « Cinéma et peinture, peinture et cinéma », 1895. Mille huit cent quatre-vingt-quinze [En ligne], 54 | 2008, mis en ligne le 01 février 2011, consulté le 30 juillet 2016. URL : http://1895.revues.org/2932
réflexion n°1
Mener à proprement parler une réflexion sur le cubisme, voila qui n'est pas simple avec ma référence ultime : l'image-temps de Deleuze. On y trouve des concepts commun entre peinture et cinéma pour le Maniérisme, le Baroque, le Romantisme, Le réalisme, le naturalisme, l'impressionnisme, l'expressionnisme , le constructivisme, l'abstraction géométrique, l'expressionnisme abstrait, l'Abstraction lyrique, le color field peinting, Art in situ, art minimal et l'art conceptuel... mais avec le cubisme point. Donc pas facile !!
Dès Le Ballet mécanique (1924), réalisé par Leger en fin de période cubiste (1908-1916, pour moi) peut servir de point de repère. Des différents commentaires de Leger lui- même on peut retenir surtout : "Aucun scénario. Des successions d'images rythmées, c'est tout [...]. Nous "insistons" jusqu'à ce que l'œil et l'esprit du spectateur "ne l'acceptent plus". Nous épuisons sa valeur spectacle jusqu'au moment où il devient insupportable."
Je retiens ce commentaire surtout parce qu'il semble sous-estimer le meilleur du film : le corps vivant (merveilleux, mystérieux théâtre de bouches et de paupières) de Kiki qui revient sans cesse dans ce film. Léger isole des détails de son visage : un oeil, deux yeux, la bouche et fait, là aussi preuve d'invention technique avec l'objectif à prisme pour faire naître "la transformation multipliée" du visage de Kiki.
Ainsi me semble-t-il si l'on rajoute des commentaires de Leger
"Créer le rythme des objets communs dans l'espace et le temps ", (...) "les présenter dans leur beauté plastique ", pour "révéler la personnalité du fragment " ; rythme, beauté et personnalité plutôt insoupçonnés s'agissant de casseroles, couvercles, brocs, bouteilles, paniers et pieds humains.
Ce film est surtout la preuve que les machines et les fragments, que les objets usuels fabriqués sont possibles et plastiques. Contraster les objets, des passages lents et rapides, des repos, des intensités, tout le film est construit là-dessus. Le gros plan, qui est la seule invention cinématographique, je l’ai utilisé. Le fragment d’objet lui aussi m’a servi; en l’isolant on le personnalise. Tout ce travail m’a conduit à considérer l’événement d’objectivité comme une valeur très actuelle et nouvelle. »
« J’ai pensé que c’était l’objet négligé, mal mis en valeur qui était susceptible de remplacer le sujet. Partant de là, ces mêmes objets qui me servaient en peinture, je les ai transposés à l’écran, leur donnant une mobilité et un rythme très calculés pour que tout cela fasse un tout harmonieux. » (Fernand Léger, conférence « Autour du Ballet mécanique », 1924-25 in Fonctions de la Peinture).
De tout cela on tire, absence de scénario, utilisation du fragment d'objet, mise en rythme jusqu'a disparition de la figure humaine mais pour la faire mieux réapparaitre dans de longs (le début du film) ou de courts instants. Utilisation forcenée du montage, gros plan, image décadrée, debullée, objectif à prisme, surimpression, split screen. Le montage image est redoublé par le montage musical.
Je réfléchis à trouver d'autres films expérimentaux plus pertinents car il est vrai qu'Entr'acte est bien davantage dada. Tout à fait d'accord aussi qu'il faut éviter l'abstraction pure de rythmus et symphonie diagonale.
réfexion n°2
L'influence plus tardive du cubisme dans le cinéma pas facile non plus. L'article David Lynch et le cubisme - Cadrage.net (www.cadrage.net/dossier/cubisme.htm offre quelques pistes mais les exemples pris dans Mulholland drive ne sont pas très convaincants (les autres films ne sont cités que du point de vue biographique; aspect bien trop présent à mon avis)
Je veux bien : " on remarquera la décoration cubiste, étrange dans la contexte de la maison de la tante de Betty, de la penderie qui se trouve dans la chambre, ou encore la vitre à lamelle qui protège la douche, derrière laquelle le corps nu de « Rita » apparaît pour la première fois à Betty. Mais il y a aussi la démultiplication par surimpression de Betty et Rita après qu'elles aient découvert le cadavre de Diane, gisant dans son lit, autre façon d'inscrire figurativement la simultanéité. Cette démultiplication correspond au tournant du film, puisque c'est à partir de là qu'il bascule dans une autre dimension. Enfin, il y a la boîte bleue, qui a donné lieu à tant de commentaires. La boîte, le cube, est un élément fondamental de l'œuvre de Lynch. Son cinéma est rempli de boîtes en tout genres, essentiellement des pièces reliées par des couloirs parcourus par la caméra. De boîte en boîte...
Mais la référence choisie est, pour moi, problématique : "Il y a beaucoup d'études sur le cubisme, mais la plus pénétrante parce qu'aussi la plus intime, est certainement celle que l'on doit à Carl Einstein sur son ami et peintre de prédilection, Georges Braque. Dans ce livre, paru en 1934, Einstein part d'une idée fondamentale, consistant à revendiquer pour l'œuvre d'art une dimension morale, biologique, au-delà de l'aspect esthétique ..."
Michel Onfray apprécierait sans doute et puis le film est porteur, alors pourquoi pas en creusant un peu..
Jeux des reflets et de la vitesse de Henri Chomette (1925, 7'30), Anémic cinéma de Marcel Duchamp (1926, 8'25), Thèmes et variations de Germaine Dulac (1928, 9'00) La marche des machines de Eugène Deslaw (1928, 9'00) et, après l'entracte : Vormittagsspuk de Hans Richter (1928, 7'00)
première avant-garde française, dite impressionniste, avec Thèmes et variations de Germaine Dulac, la seconde, dite picturale, avec Anémic cinéma de Marcel Duchamp et de la troisième, dite documentaire, avec Jeux des reflets et de la vitesse de Henri Chomette et La marche des machines de Eugène Deslaw. Ces deux derniers films sont très marqués par Dziga Vertov, le premier étant une sorte de court Ciné-oeil ou d'Homme à la caméra, film majeur qui a pour personnage principal, le frère de Dziga Vertov, Boris Kaufmann...qui est l'opérateur de La marche des machines.
Images d’Ostende de Henri Storck (1929, 0h15), Komposition in Blau de Oskar Fischinger (1935, 0h04), Trade Tattoo de Len Lye (1937, 0h05), Meshes of the Afternoon de Maya Deren (1943, 0h14), Fiddle-de-dee de Norman McLaren (1947, 0h03), Rabbit’s Moon de Kenneth Anger (1950, 0h07), A to Z de Michael Snow (1956, 0h06), Yantra de James Whitney (1957, 0h08), Jamestown Baloos de Robert Breer (1957, 0h05) et Unsere Afrikareise de Peter Kubelka (1966, 0h13).... Le projecteur a rendu l'âme juste avant Notebook de Marie Menken (1963, 0h10).
Images d’Ostende de Henri Storck relève de la première avant garde impressionniste. La comparaison avec les films de Epstein ou Grémillon n'est pas à l'avantage de ce petit film sans génie.
Trade Tattoo de Len Lye qui combine images ouvrières, splendeurs colorées, rythme obsédant et travail sur la pellicule est plus inventif, drôle et stimulant. Même émerveillement, mais d'une autre nature pour le surréaliste Meshes of the Afternoon de Maya Deren qui fait souvent penser, et ce n'est pas rien, à David Lynch.
A côté, le A to Z de Michael Snow, pape du cinéma expérimental, parait bien anodin avec ses chaises faisant l'amour. Bien plus sulfureux le Rabbit’s Moon de Kenneth Anger esthétiquement plus simple et plus réussi que Jamestown Baloos de Robert Breer. Unsere Afrikareise de Peter Kubelka démonte un safari africain. La musique et le montage cut entre blancs avachis et les visages et corps superbes des habitants noirs suffit à porter un discours politique sans appel.
Dog Star Man : Part III de Stan Brakhage (1964, 7'30), All My Life de Bruce Baillie (1966, 3'), My Name is Oona de Gunvor Nelson (1969, 10'), Berlin Horse de Malcolm Le Grice (1970, 9'), Berlin Horse de Malcolm Le Grice (1970, 9'), Piece Mandala/End War de Paul Sharits (1966, 5'), L’Amour réinventé de Maurice Lemaître (1979, 15'), Hapax Legomena I : Nostalgia de Hollis Frampton (1971, 0h36)
Dans Mama und Papa Kurt Kren filme un happening d'Otto Mühl. Le premier film actionniste de Kren. Avec son sixième film, Kren représente un sujet qui à l'époque était considéré comme révolutionnaire autant qu'explosif. Il commença à filmer des actions et des happenings conçus par Otto Mühl (qui serait devenu tout pâle lors de la première du film) et Günter Brus, et par l'Institut de l'art direct de Vienne.
Dog Star Man : Part III de Stan Brakhage comprend les bobines Il, Elle et Coeur. Les images féminines tentent de devenir masculines et n'y arrivent pas et inversement. Dans la bobine Elle, on voit des morceaux de chair en mouvement qui se séparent distinctement pour former une image de femme, tiraillée par le désir d'être homme. Dans un sens c'est très proche de Bruegel, les pénis remplacent les seins dans des flashes d'images, puis un pénis surgit d'un oeil, ou bien encore des poils d'homme se déplacent sur tout le corps d'une femme. A un moment tout cela cesse, et cette chair devient finalement une femme. Dans la bobine Il, c'est le contraire qui se passe ; un morceau de chair est torturé par une inclinaison à la production d'imagerie féminine, en sorte que par exemple ses lèvres se transforment soudainement en vagin. Finalement la forme mâle émerge. Puis bien entendu, ces deux formes dansent ensemble, superposées et l'on obtient un magma de chair homme-femme qui se divise et se réunit selon des mélanges, des distorsions proches de celles imaginées par Bruegel.
All My Life de Bruce Baillie, film d'une seule prise, un vieux chemin avec des roses rouges, au début de l'été à Mendocino. La chanson All my life est interprétée par Ella Fitzgerald avec Teddy Wilson et son orchestre.
My Name is Oona de Gunvor Nelson qui, par son intimité avec la nature, évoque des légendes qui puisent, par-delà d'une existence individuelle, au large réservoir du mythe féminin. Chevauchant à travers une forêt sombre, emportée dans le tourbillon de ses cheveux blonds, elle fait penser à ces autres cavalières blondes de la mythologie nordique, les Walkyries. Cette image, peut-être suggérée à Gunvor Nelson par son propre héritage scandinave, nous rappelle que, pour la femme primitive, il n'existait pas de contradiction entre la beauté et la force, ni entre la féminité et le pouvoir.
Berlin Horse de Malcolm Le Grice est une synthèse de travaux qui explorent la transformation de l'image en refilmant à partir de l'écran, et en utilisant des techniques complexes de tirage. Il y a deux séquences originales: une vieille page d'actualités et une partie d'un film 8mm tourné à Berlin, un village de l'Allemagne du Nord. À partir de l'écran, et de plusieurs différentes façons, le 8mm est refilmé en 16mm de façon à utiliser, lors du tirage, une superposition permutative et un traitement de couleur. La musique du film est composée par Brian Eno et, comme tous les éléments de l'image, elle explore l'irrégularité des boucles entre elles afin de changer leur phase.
Piece Mandala/End War de Paul Sharits joue sur la fréquence de couleurs pâles espaçant et enrichissant visuellement des photos en noir et blanc, les mouvements d'un acte sexuel ou simultanément des deux côtés de son «champ» et des deux extrémités de sa durée.
L’Amour réinventé de Maurice Lemaître. Si, comme le demandait Rimbaud, l'amour doit être réinventé, il ne peut l'être que par les poètes, à qui déjà il doit sa naissance. Et les formes qu'il prendra alors ne peuvent être décrites - filmées - que par des poètes, et notamment des poètes de l'écran. Des images et des sons jamais vus, jamais ouïs, était-ce encore possible aujourd'hui, telle était la gageure que ce film devait affronter. Le son, composé de poèmes lettristes, ajoute son étrange variété à la splendeur de l'oeuvre.
Hapax Legomena I : Nostalgia de Hollis Frampton (1971, 0h36). Avec Walden, Jonas Mekas avait ouvert le genre du film autobiographique qui quittera le domaine exprimental sauf quand, comme ici, l'auteur joue sur sur la durée et la sérialité.