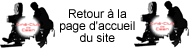|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Patricia-Laure Thivat (direction)

Cet ouvrage questionne les enjeux et les manières de filmer l’acte de création. Sciemment marqué par une grande diversité esthétique et historique, l’ouvrage traite de films classiques aussi bien que contemporains. Les grandes œuvres de John Huston et Vincente Minnelli côtoient les expériences novatrices de Peter Watkins, Jack Hazan, Maurice Pialat, Charles Matton ou Raoul Ruiz… Au cœur de la problématique, les questions esthétiques qui animent le cinéaste filmant l’acte de création, avec celle des migrations et des translations possibles entre peinture et cinéma. Illustré par une riche iconographie, l’ouvrage permet ainsi d’appréhender les constantes et les enjeux que partagent ces films biographiques.

Le peintre au cinéma est un personnage emblématique de la figure de l’artiste. Le génie créateur renouvelle la figure héroïque de l’aventurier solitaire qui joue de la contradiction entre la liberté individuelle et les formes de l’organisation sociale. Les biographies sont concentrées sur les figures majeures de l’histoire de l’art, peintres célèbres des siècles passés – Rembrandt, Le Caravage, Michel-Ange, Goya –, d’artistes novateurs, voire artistiquement révolutionnaires, du tournant des 19e et 20e siècles – Toulouse-Lautrec, Modigliani, Van Gogh, Munch –, mais aussi de peintres contemporains – Hockney, Pollock, Kahlo, Bacon ou Basquiat –, tous à même de représenter l’image du « génial démiurge » à l’apogée de son art, et/ou la figure du « peintre maudit », en proie à une souffrance physique ou existentielle.
Des peintres à l’existence tranquille comme Degas, Manet ou Cézanne ne semblent pas avoir suscité le même intérêt. Leurs biographies respectives ne paraissent pas correspondre aux nécessités cinématographiques de l’archétype. Celui-ci est un individualiste, parfois décrit comme un génie (Rembrandt), toujours obsédé par sa création, à la fois asocial et frondeur (Ohwon, Modigliani), amateur des choses de l’amour (Le Caravage, Van Gogh), mais toujours plus à l’aise dans le calme de l’atelier que face aux tumultes de la société (Michel-Ange, Klimt). Tout à la fois entier dans sa vocation et pétri de contradictions dans ses relations avec les autres, sa liberté créatrice est constamment mise en danger par le monde extérieur. Le peintre au cinéma est aussi et avant tout un personnage qui porte un regard singulier et aiguisé sur le monde mais que le monde ne peut contrôler.
La biographie de peintre peut être qualifiée d’épique (L’Extase et l’agonie de Carol Reed) , de contemplative (Ivre de femmes et de peinture d’Im Kwon-Taek) ou de pseudo-documentaire (Edvard Munch de Peter Watkins, A Bigger Splash de Jack Hazan). Au nombre des questions soulevées, trois nous semblent centrales et reviendront comme des leitmotive dans les projets des cinéastes et bien entendu dans les études composant cet ouvrage. Comment représenter l’artiste au travail ? Doit-on et comment représenter son oeuvre ? Peut-on, au travers de l’image filmée, traduire le regard que l’artiste porte sur le monde environnant.
Filmer l’acte de création ne consiste pas à filmer un produit inerte, pur reflet du créateur, mais une puissance de création. Cette puissance s'oppose-t-elle aux valeurs de la société ? Ou est-ce la peinture qui s'oppose aux régles alors en vigueur ? La biographie de peintre à l’écran se situe dans cet espace de création où se confrontent et s’entremêlent le savoir historique – dans sa richesse et sa complexité – et la subjectivité du réalisateur.
Sommaire :
- Patricia-Laure Thivat. Introduction : Vies d’artistes au cinéma. L’Histoire, le mythe et le miroir.
- Priska Morrissey. La nuit des ateliers. Réflexions sur un imaginaire de l’artiste au travail dans les biopics de peintres
- François Genton. La biographie de peintre, un genre politique ? Les films Rembrandt d’Alexander Korda (1936) et de Hans Steinhoff (1942)
- Christian Viviani. Biographies de peintres dans le cinéma américain.
- N. T. Binh. Le ballet final d’Un Américain à Paris. Biographie fantasmée d’un peintre chorégraphe
- Fabien Delmas. Le dernier Ophuls. Et s’il fallait peindre l’Univers ?
- Gloria Camarero Gómez. Goya au cinéma.
- Antony Fiant. Pirosmani vu par Chenguelaia et Paradjanov : portraits en creux.
- Michel Cieutat. Van Gogh au cinéma : Minnelli, Pialat, Altman.
- Nicolas Bezard. Le talent est un malheur. Andreï Roublev d’Andreï Tarkovski et Van Gogh de Maurice Pialat.
- Jean-Michel Durafour. Rossellini et Alberti. La perspectiva televisualis, ou le cinéma dépi(c)té.
- Baptiste Villenave. Le maelström des affects.. Edvard Munch de Peter Watkins (1974) : une biographie totale.
- Jacques Pasquet. Béance(s) : A Bigger Splash de Jack Hazan.
- Véronique Campan. Les puissances du faux ou la « mise en boîte » de Rembrandt par Charles Matton.
- Jakuta Alikavazovic. Pollock d’Ed Harris : « un sujet idéal » ?
- Roland Carrée. Bio-graphie : Ivre de femmes et de peinture d’Im Kwon-taek (2001).
- Marie Martin. La projection du peintre. Klimt de Raoul Ruiz.
- Patrick Louguet. La vie et l’oeuvre de Séraphine Louis en régime de fiction cinématographique.
- Floreal Peleato. La musique silencieuse du geste.
Index des auteurs, des peintres, des réalisateurs et des films.
Notes de lectures :
François Genton. La biographie de peintre, un genre politique ?
Les films Rembrandt d’Alexander Korda (1936) de Hans Steinhoff (1942).
Un mythe commun, à savoir la vision de Rembrandt en tant qu'artiste
maudit, permet de tenir des propos partiellement antagonistes. Cependant ce
mythe, dont le fondement est la représentation de l'autonomie de l'art
par rapport au champs politique, religieux et économique, et de l'indépendance
de l'artiste par rapport à la masse et aux puissants, entrave de facto
le développement du discours totalitaire.
Le Rembrandt de Tornius et de Zuckemayer/Korda est un artiste indépendant et tolérant, reconnu et respecté par ses pairs jusqu'à sa mort malgré son statut financier précaire, un caractère relativement stable. Davantage encore que dans le roman, le film anglais montre que, par sa marginalité, l'artiste est mieux compris par la communauté juive d'Amsterdam, en particulier son ami Menasseh que par une société de bourgeois intolérants et incultes.
Le Rembrandt de Steinhoff-Heuser est bien plus sombre et violent, un caractère en formation dans une certaine tradition goethéenne, peu compatible avec la constance de l'affirmation de soi propre au mythe. Le film installe une forte portion d'antisémitisme et d'antiféminisme.
La manière dont Rembrandt justifie sa composition de La Ronde de nuit diverge dans les films anglais et allemand : Charles Laughton dit qu'il voulait juste peindre une compagnie en branle; plus ambitieux, Ewald Balser proclame la prééminence du tout sur la partie, conformément à une tradition holiste bien allemande : "Ce n'étaient pas les individus qui comptaient pour moi, c'était la totalité !". Il est évident que le film de Steinhoff repose sur une analogie entre le destin de Rembrandt et celui du peuple allemand: tenir malgré tout et faire confiance à la volonté qui nous gouverne. Rembrandt est aussi ce que les Allemands ont appelé un Durchhaltefilm, un film pour tenir.
Le mythe résiste au discours totalitaire. Bien loin de la sauvagerie agressive de la race des seigneurs, l'artiste maudit manifeste une attitude sacrificielle qui est ancrée dans la tradition judéo-chrétienne, par laquelle il s'oppose aux bourgeois satisfaits d'eux-mêmes et dénués du moindre talent. Structurellement l'artiste maudit ne parle que pour lui-même : on peut l'ériger, comme le fit Julius Langbehn, en potentiel éducateur des masses, en "empereur caché" mais il est bien peu susceptible de mobiliser la masse à l'instar du führer. Le 8 juin 1942, Goebbels confiait sa déception à son journal. Loin de montrer un peintre "démoniaque et génial", le film ne parvient pas à "percer les mystères de la puissance créatrice" et parlera aussi peu à la masse qu'aux gens cultivés.
François Genton note que, dans les biographies postérieurs de Rembrandt à l'écran, Rembrandt fecit 1669 (Jos Stelling, 1977), se concentre sur la vie privée et familiale du peintre jusqu'à sa mort -de Sakia à Tatia, la fille de Titus, qui naquit peu après la mort du fils de Rembrandt et avant celle du peintre. On découvre ici un être égoïste et taciturne, peu capable d'empathie, entièrement occupé de son travail et de son œuvre, dans une société dure aux pauvres et aux faibles. Par son réalisme historique ce film néerlandais a voulu rompre avec le mythe Rembrandt qui continue toutefois de marquer la vision de l'artiste dans l'imaginaire collectif : plusieurs décennies plus tard, malgré d'éclatantes différances, les films de Charles Matton (Rembrandt, 1999) et de Peter Greenaway (La ronde de nuit) se réfèrent encore à la thèse de l'artiste maudit.
Christian Viviani. Biographies de peintres dans le cinéma américain.
Seuls Moulin rouge (Huston, 1952) et La
vie passionnée de Vincent van Gogh (1955) sont de véritables
biographies de peintres dans le cinéma hollywoodien. La maya nue
et la maya habillée (Henry Koster, 1958) évoque les amours
de Goya et de la duchesse d'Albe. Il faudra ensuite attendre Surviving
Picasso (James Ivory, 1996) et Frida (Julie Taymor, 2002).
Viviani relève que dans Moulin Rouge, Huston recrée un univers vaporeux proche de l'impressionnisme et ne cite dans aucun de ses plans un tableau de Toulouse-Lautrec. C'est l'artiste que l'on voit devant son chevalet qui créer par sa peinture un monde différent. A l'inverse, Minnelli aime à recréer le monde des tableaux de Van Gogh à l'identique en citant les œuvres quasi directement comme si la vision du monde que propose le film était déjà celle du peintre Vincent van Gogh.
Peter Watkins (Edward Munch, 1974) et Raoul Ruiz (Klimt, 2006) jouent volontiers sur une déconstruction du temps réel au profit de la mise en évidence d'un temps subjectif, propre à la personnalité de l'artiste.
Hollywood traite aussi volontiers des peintres fictifs. On a alors, soit le cliché de l'artiste exalté dont la peinture est incompréhensible à tous, soit l'artiste romantique comme dans Le portrait de Jenny à la recherche d'une inspiration idéale. Viviani consacre aussi une partie de son étude au cas d'Albert Lewin. La première occurrence de la figure du peintre chez Albert Lewin, grand collectionneur et amateur d'art, apparait dès son premier film, The moon and Six pence (1942) adaptation d'un roman de Somerset Maugham. Son protagoniste, Strickland (George Sanders) est une création fictionnelle. Cependant au prix de changements de patronymes et de détails il se présente comme inspiré de Paul Gauguin. En effet, Strickland tourne le dos à une vie rangée et stable pour vivre d'abord la bohème du peintre puis l'exil créatif à Tahiti. Les tableaux nous sont cachés jusqu'à la fin, quand il met le feu à ses propres œuvres : nous voyons alors se consumer sous nos yeux en couleurs (le reste du film est en noir et blanc) une série de tableaux qui évoquent les couleurs et les traits de Gauguin.
Le portrait dans Le portrait de Dorian Gray (1945) est réalisé par Basil Hallward, personnage secondaire correspondant au stéréotype du peintre mondain que le protagoniste assassine. Lewin a recours à deux portraits qu'il insère dans son film en en surlignant l'importance de la façon suivante. Presque tous ces inserts sont en couleurs, à l'intérieur d'un film en noir et blanc. Le portrait d'origine est réalisé selon la pratique alors de mise dans le cinéma hollywoodien : un portrait photo du sujet est agrandi et un artiste peintre, employé par le studio, y appose au pinceau des couleurs qui vont, in fine, lui donner l'apparence d'une œuvre figurative sans réelle personnalité. Procédé que l'on trouve aussi dans Laura (Otto Preminger) et Femme aimée et toujours jolie (Vincent Sherman). Pour figurer la détérioration du portait, Lewin a l'idée de confier à Albert Albright, peintre américain réputé, proche du mouvement surréaliste qui, à partir de ce canevas imposé, élabore une œuvre toute personnelle qui va devenir une de ses plus célèbres et que l'on peut voir maintenant à l'Art Institute de Chicago. Lewin filme les différents stades d'avancement de l'œuvre d'Albright et les insère dans son film pour montrer l'évolution du portrait et la perversion du protagoniste.
Ce procédé d'insert d'un tableau en couleurs, Lewin le reprendra dans son adaptation de Bel Ami de Maupassant en 1947 : le réalisateur avait organisé un concours sur le thème de La tentation de saint Antoine, auquel participèrent entre autres Dali et Max Ernst. C'est ce dernier que Lewin choisit.
Dans Pandora, c'est le personnage masculin central joué par James Mason, incarnation moderne du mythe romantique du Hollandais volant qui s'adonne à la peinture par plaisir, mais aussi pour recréer le souvenir d'une femme aimée (Ava Gardner). Encore une fois deux portraits interviennent : celui que l'on voit James Mason peindre dans un style surréaliste et dû à Max Ernst, cher à Lewin, et une miniature dans le style du XVIe siècle que le héros porte sur lui et qui est en fait une photo d'Ava Gardner par Man Ray, légèrement remaniée pour avoir l'air d'une œuvre peinte.
Dans Benvenuto Cellini (Gregory La Cava, 1934) le personnage principal
est le peintre et orfèvre florentin. La comédie basée
sur des procédés plutôt efficaces de vaudevilles à
la française avec maris barbons trompés et portes qui claquent
ne tire pratiquement aucun parti de l'identité du personnage principal.
À peine le voyons nous devant un chevalet et mentionne-t-on son occupation
dans le dialogue. C'est comme avatar donjuanesque que Cellini est utilisé.
Dans La
duchesse des bas-fonds, Thomas Gainsborough repère l'héroïne
dans la rue comme voleuse à la tire et lui demande de poser pour lui.
Il la représente sous les traits d'une lady et de ce fait donne le
coup d'envoi à sa spectaculaire ascension sociale
Dans la maison du docteur Edwards et le père de la mariée, les
réalisateurs font appel à Salvador Dali pour imaginer des séquences
oniriques.
N. T. Binh. Le ballet final d’Un
Américain à Paris. Biographie fantasmée d’un
peintre chorégraphe. Entremêle références picturales
détaillées et éléments de biographie du réalisateurs,
du chorégraphe et des acteurs.
En 1950, le scénariste Alan Jay Lerner est engagé par le producteur Arthur Freed, à la MGM pour écrire un scénario à partir d'un catalogue de chansons composées par George Gershwin. L'idée d'une biographie se déroulant pendant les années 1920, à peu près à l'époque où Gershwin était allé à Paris pour étudier la peinture est vite abandonnée, car trop complexe à rendre dans une comédie musicale. Une trame utilisant Paris, un peintre américain (Gershwin souhaita d'abord être peintre) et la musique de Gershwin s'imposa.
La première idée de Minnelli et de Kelly, qui chorégraphie le film, est de tourner le grand ballet final en décors naturels à Paris, de même que Kelly et Donen avaient tourné les scènes d'Un jour à New York (1949) sur les lieux de l'action. Les couts de production concernant les transports et la logistique d'un tournage à l'étranger mais aussi la difficulté pour Leslie Caron, dont c'est le premier film, de danser plus de deux ou trois heures par jours font abandonner ce projet. Il est donc décidé que le ballet sera tourné sur les plateaux de la MGM. Vincente Minnelli, lui-même peintre décorateur de formation, a l'idée, puisque le protagoniste du film est un artiste, de styliser au maximum les décors, en s'inspirant des grands peintres du XIXe siècle.
La première partie du ballet est conçue en bleu blanc rouge sur une place de la Concorde à la manière de Raoul Duffy. Un imposant bey fait face à Gene Kelly qui aperçoit bientôt sa belle dans la cohue. Après avoir échappé à une cohorte de sirènes tentatrices, il la retrouve dans un marché aux fleurs inspiré d'Auguste Renoir, comme en témoigne la présence de deux jeunes filles en bleu portant des chapeaux à larges bords. Dans les bras du héros, sa partenaire s'est transformée en bouquet de fleurs, qu'il lâche en se retrouvant dans un Montmartre inspiré d'Utrillo. Quatre militaires américains en goguette viennent lui remonter le moral, allusion à sa situation de personnage resté à Paris après la guerre. Un passage chez un fripier, et les cinq individus, métamorphosés en parisiens à canotiers, quittent joyeusement le décor en quête de nouvelles aventures. La transition avec le décor suivant est assuré par quelques gardes républicains associés au thème de la Matchiche (danse d'origine afro-brésilienne qui fit fureur en Europe au tournant du siècle, autre élément exotique après le bey), lui-même incorporé au poème symphonique de Gershwin.
Dans le tableau suivant, un groupe de ballerines sur pointes menées par Leslie Caron y dialogue avec des danseurs en claquettes accompagnant Kelly. Le décor est inspiré du Douanier Rousseau avec un parc zoologique dont la girafe semble dicter à l'ensemble des danseurs cette posture à la courbe insolite. Après un intermède de retour à la Concorde et un duo amoureux sur une fontaine crachant d'épais fumigènes aux couleurs changeantes, les amoureux se retrouvent devant un Opéra éclairé par des soleils de Van Gogh. Un homme sandwich les invite ensuite à une exposition Toulouse Lautrec. Dans un cabaret on retrouve Gershwin et son autoportrait en "Américain à Paris", figuré par le danseur noir américain Chocolat, peint par Toulouse Lautrec dans une pose que reprend Kelly et enfin Toulouse Lautrec lui-même, incarné par un figurant barbu de petite taille, parmi d'autres personnages de ses tableaux, soit réels soit en silhouettes découpées.
Le grand tableau final ayant vu le héros perdre sa belle dans la foule de la place de la Concorde, après un bref retour au décor Van Gogh, revoilà Gene Kelly comme au début du ballet devant un arc de triomphe ironique dessiné à la Duffy. Il ramasse une fleur et le ballet se termine par un gros plan de Kelly puis sur la rose qu'il tient à la main, motif amoureux classique du musical. Une petite coda sans paroles permettra l'obligatoire happy end, sur des escaliers du sacré cœur made in MGM.