 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Les ménines

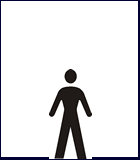
L'historien d'art souhaite pourtant analyser le tableau tel qu'il a été compris en 1659 et par les générations suivantes. Cette interprétation doit se détacher de celle, allégorique et dynastique, que l'on pouvait faire à partir d'une première version du tableau peint en 1656 et devenu périmé dès 1657. Mais Daniel Arasse tient aussi à se démarquer de l'analyse de Michel Foucault qui repose sur les conditions muséales de présentation, de perception et de réception.
Un des tableaux les plus célèbres du monde
On a tout dit sur Les Ménines, surtout depuis que Michel Foucault a trouvé bon d'en faire la préface de ses Mots et les choses, en 1966.
Pour y voir plus clair, on a même publié une sélection de textes consacrés au tableau. Dès 1692, Luca Giordano, surnommé Luca da presto pour sa rapidité d'exécution et grand admirateur de la touche de Velázquez, aurait déclaré : "C'est la théologie de la peinture". C'est Palomino, le biographe de Velázquez qui rapporte le mot.
Pour Daniel Arasse, si cette formule lui est venue à l'esprit, c'était déjà à cause du fameux miroir qui a déclenché l'interprétation de Foucault et de ce qui s'y reflète : les silhouettes du roi et de la reine -le roi c'est à dire pas n'importe quel "sujet", mais le monarque, le "sujet absolu".
 |
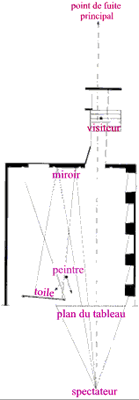 |
On connaît le nom et les fonctions des personnages représentés (l’infante Marguerite entourée de ses demoiselles d’honneur -les Ménines- María Agustina de Sarmiento et Isabel de Velasco, de la naine María Bárbola, et du bouffon Nicolasito Pertusato et d’un chien mâtin. A l’arrière, un écuyer des dames de la cour échange quelques mots avec Marcella de Ulloa. Dans l’encadrement de la porte, se tient le chambellan José Nieto). On sait la salle du palais de l’Alcázar de Madrid où la toile a été peinte. On a même identifié les tableaux invisibles qu'on y voit : pas seulement ceux qui nous font face, mais aussi ceux qu'on voit de profil. Velázquez est revenu sur le tableau pour y peindre sa légion d'honneur, la croix de Santiago que lui accorde le roi deux ans après le chef-d'œuvre. Bref, on sait tout.
Foucault fait pourtant délibérément reposer son interprétation sur une fiction quand il écrit, par exemple:
"il nous faut donc feindre de ne pas savoir qui se reflétera au fond de la glace, et interroger ce reflet au ras de son existence."
Cette fiction est particulièrement arbitraire car personne n'aurait eu l'idée, en 1656, de feindre de ne pas savoir qui se reflétait là. On en aurait d'autant moins eu l'idée que, malgré ses grandes dimensions, ce tableau était un tableau privé, pire encore, un tableau destiné à un seul spectateur, le roi soi-même, puisqu'il était accroché, dès 1666, dans son "bureau d'été" et qu'il y est resté jusqu'en 1736.
En fait Foucault démocratise le tableau, il le républicanise. Son analyse repose sur les conditions muséales de présentation, de perception et de réception. Il s'approprie Les Ménines.
On peut se faire une idée de ce que le roi avait en tête lorsqu'il a passé commande à son peintre en 1656, grâce au nom du tableau dans les collections royales : jusqu'en 1843 où elles reçoivent le nom qui est maintenant le leur, Les Ménines s'appelaient Le tableau de la famille.
Dès le début, le tableau avait pour thème la famille royale-entendue à la fois comme la famille par le sang, avec l'infante Marguerite qui, l'œil gauche sur l'axe central du tableau, regarde vers ses parents dont nous voyons le reflet dans le miroir, et la famille élargie aux familiers de l'infante (ces meninas ou suivantes qui l'entourent) et aux familiers du couple royal, représentés en particulier par les deux Velázquez : Diego en train de peindre, qui est alors aposentador du roi (c'est à dire plus ou moins son maréchal du palais ou grand chambellan) et José Nieto aposentador de la reine, qui, au fond, apparaît au-delà de la pièce, à travers la porte ouverte.
La version de 1656
Tout récemment la conservatrice du Prado a remarqué une petite tache blanche sur la dentelle de la naine et a vu l'anneau d'or qu'elle tenait jadis entre le pouce et l'index de la main gauche. A force d'analyses techniques et de radiographies des retouches abondantes surtout dans la zone qu'occupe Velázquez et le grand châssis, elle en a tiré une interprétation politique, dynastique radicalement neuve. Une vraie révolution.L'interprétation dynastique désigne l'infante comme héritière du trône -avant la naissance en 1657, de l'infant Philippe Prosper.
Selon Manuela Mena Marquez, il y a eu, sur la même toile, deux versions successives du Tableau de la famille. Dans la première, le peintre et son châssis étaient absents ; à leur place, comme le font entrevoir les radiographies, Velázquez avait peint un jeune homme, tourné vers l'infante et lui présentant ce qui pourrait être un bâton de commandement, ainsi qu'un grand rideau rouge, et une table avec un bouquet de fleurs. Loin d'être un capricho privé, il s'agissait d'un tableau tout ce qu'il y a de plus public et officiel. En l'absence d'héritier mâle et dans le contexte de la guerre avec la France, Philippe IV aurait, après de longues tergiversations, décidé d'accepter le mariage de sa fille aînée, l'infante Marie-Thérèse, avec Louis XIV et de désigner Marguerite comme l'héritière du trône. Commandé à Velázquez alors que ce dernier, en tant qu'aposentador du roi, ne peint plus que pour des raisons exceptionnelles, Le tableau de la famille constitue alors le document et la mémoire de cette décision considérable : c'est une "Allégorie de la monarchie" et toute son iconographie (du geste des suivantes aux thèmes des tableaux accrochés à la paroi du fond en passant par l'anneau d'or de la naine Mari Barbola) est à réinterpréter dans ce sens. Dans ce contexte dynastique et allégorique, le reflet des deux figures royales dans le miroir manifeste la présence du roi au centre de la composition (car le tableau aurait ensuite été raccourci sur la gauche). Selon Daniel Arasse, il donne à cette présence un statut spécifique, un mystérieux prestige, en un mot cette aura vivante quasi divine ("l'apparition unique d'un lointain", selon Benjamin).
Puis, le 20 novembre 1657, c'est la naissance de Felipe Prospero, qui devient immédiatement l'héritier mâle du trône. Le tableau de la famille perd dès lors son sens et, plus encore sa fonction. D'après Manuela Mena Marquez, on l'abandonne, on l'oublie, on ne s'occupe plus de lui ; son message dynastique est périmé.
La version de 1659
Dès 1659, l'infante Marguerite est d'ailleurs promise à l'empereur et c'est sans doute à la fin de cette même année que Velázquez, qui a le droit à partir de novembre 1659 d'arborer sur sa poitrine la croix rouge de l'ordre de Santiago, reprend le tableau pour l'actualiser et l'adapter aux nouvelles conditions de la monarchie. C'est alors que l'œuvre publique devient un tableau privé et le portrait dynastique un capricho courtisan.
Comme le montre sa mise en scène et comme le disait plus clairement son titre ancien, c'est un portrait privé de l'infante, de ses familiers et des familiers royaux. Ce caractère privé se marque dans la présentation informelle des neuf figures -jusqu'au chien qui essaie de dormir, alors que dans les portraits officiels, les chiens de Velázquez ont toujours les yeux ouverts, même quand ils sont couchés. Le roi a ainsi commandé à son peintre un tableau à part, Le tableau de la famille est bien, comme Palomino l'a écrit, un capricho, un caprice, une œuvre de fantaisie.
En esquissant dans le miroir le double portrait royal, Velázquez ébauche un bref récit, dont le caractère fictif ne pouvait alors faire aucun doute : "Alors que le peintre du roi peignait dans son atelier le double portrait du roi et de la reine, l'infante Marguerite est descendue voir ses parents, accompagnée de ses suivantes. C'est ce moment familial et privé, que le peintre a peint et met devant vos yeux."
Ce n'était pas le tableau officiel de l'infante Marguerite puisque Velázquez l'a peint la même année en 1656 : la petite fille de cinq ans y est toute seule, bien droite dans sa robe bien raide. Elle a le même habit et la même pose (inversée) dans Le tableau de la famille mais là, cette raideur de commande est corrigée par les mouvements qui l'entourent jusqu'au coup de pied que Nicolasito, le petit nain, donne au chien.
Le capricho se manifeste avec un éclat particulier dans la présentation
du couple royal sous l'aspect de ce reflet diffus dans le miroir. Une telle
présentation était impensable sans l'accord royal et en dehors
de cette conception capricieuse. Ce reflet constituait en 1656 un hommage
raffiné au roi, l'hommage d'un grand courtisan qu'était effectivement
Velázquez. Mieux qu'un double portrait accroché à cet
endroit, le miroir faisait du couple royal l'origine et la fin du tableau,
sa source, puisque le peintre est supposé les peindre, et sa destination
puisque les figures peintes ont leur regard tourné vers leur présence,
supposée par le reflet dans le miroir. L'idée est simple, brillante
et, surtout, elle ne demande pas une profonde réflexion intellectuelle.
Velázquez, contrairement à Poussin, n'était pas un intellectuel
de la peinture.
En s'introduisant dans le tableau, Velázquez célèbre
sa propre gloire, celle d'un peintre décoré de l'ordre de Santiago
et autorisé à se représenter à côté
d'une altesse royale (Goya le fera plus modestement au siècle suivant).
Il célèbre aussi la gloire de la peinture : à travers
son plus grand représentant, Velázquez lui-même, c'est
à l'art de peindre qu'est reconnu finalement, le prestige d'un art
"libéral" et non "mécanique". La peinture,
cosa mentale : Léonard l'avait affirmé depuis longtemps, mais
c'est à Velázquez que revient, en Espagne, l'honneur d'en faire
admettre le principe, en acte et pas seulement en théorie.
Dans Les Ménines, son attitude est explicite : prenant distance par rapport à sa toile, il fait une pause dans son activité manuelle mais travaille "en esprit" et prépare mentalement ce que la main va peindre.
Foucault ne s'est pas trompé en ouvrant par là sa description du tableau (Le peintre est légèrement en retrait du tableau. Le bras qui tient le pinceau est replié sur la gauche, dans la direction de la palette ; il est, pour un instant, immobile entre la toile et les couleurs. Cette main habile est suspendue au regard ; et le regard, en retour, repose sur le geste arrêté."
Dans un texte publié en 1983 dans la revue Art History, John Moffitt rapproche de façon convaincante, la pose de la main de Velázquez dans Les Ménines et l'illustration finale des Dialogos de la pintura de Carducho. Véritable emblème de la peinture puisqu'il associe un titre, une image et un commentaire en quatre vers, cette illustration présente, sous un titre énigmatique "Potentia ad actum tamquam tabula rasa", un pinceau obliquement posé sur un panneau encore vierge et le commentaire suivant "La toile blanche voit toutes les choses en puissance ; seul le pinceau, avec une science souveraine, peut réduire la puissance à l'acte." Vincente Carducho affirme glorieusement la toute-puissance de l'acte du peintre, du peindre et se rapproche ainsi de Léonard, pour lequel, si la peinture était cosa mentale, l'exécution était plus noble encore que la seule conception mentale parce qu'elle met en acte l'image à venir.
C'est bien cela qu'à peint Velázquez dans ses Ménines seconde mouture. La toile blanche, c'est le revers de la toile que nous voyons et dont l'avers contient, en puissance, un tableau que nous ignorons et que conçoit, seul, le peintre qui nous regarde et le moment choisi est celui du suspens "entre la fine pointe du pinceau et l'acier du regard" (encore Foucault), avant que le pinceau ne mette en acte cette puissance de peinture, cette peinture en puissance qu'implique la toile.
En s'introduisant le pinceau à la main, Velázquez produit certes une petite fiction narrative mais transforme aussi radicalement la fonction du miroir présent dans la première mouture du tableau. Ce n'est plus l'instrument de l'aura marquant le mystère d'une présence quasi divine. Il provoque seulement l'énigme d'une peu probable réponse. Pourtant sa brillance auratique ne s'est pas effacée et, selon Daniel Arasse, continue de hanter Le tableau de la famille. C'est cette rémanence qui enclenche l'effet anachronique de sens qu'a dégagé et formulé Foucault. Car la puissance de la "mise en acte d'un possible" glisse du roi, figure ici-bas du divin, au peintre qui représente le roi.
Sources :
- Daniel Arasse, On n'y voit rien, Editions Denoël, 2001, coll. folio essais, 2005, p.175 à 215.
- cARTatble, la perspective.
