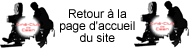Parle avec elle Un rideau
avec des roses couleur saumon et de grandes franges dorées s'ouvre
sur un spectacle de Pina Bausch, " Café Müller ". Parmi
les spectateurs, deux hommes sont assis, l'un à côté de
l'autre. Ils ne se connaissent pas. C'est Benigno, un jeune infirmier et Marco,
un écrivain d'une quarantaine d'années. Sur la scène
jonchée de chaises et de tables en bois, deux femmes, les yeux fermés
et les bras tendus se déplacent au rythme de la musique de " The
Fairy Queen " de Henry Purcell. Le spectacle est si émouvant que
Marco éclate en sanglots. Benigno voit les larmes de son voisin dans
l'obscurité des fauteuils d'orchestre. Il aimerait pouvoir lui dire
que lui aussi est très ému par le spectacle, mais il n'ose pas.
Plusieurs mois plus tard, les deux hommes se rencontrent à la clinique
El Bosque, une clinique privée où travaille Benigno. Lydia,
la petite amie de Marco, torero professionnel, se retrouve dans le coma suite
à un accident survenu pendant une corrida. Benigno, lui, est au chevet
d'une autre femme dans le coma, Alicia, une jeune danseuse. Lors que Marco
passe à côté de la chambre d'Alicia, Benigno sans hésiter,
s'approche de lui. C'est le début d'une grande amitié aussi
linéaire que des montagnes russes ! Le temps s'écoule entre
les murs de la clinique. La vie des quatre personnages suit son cours, elle
part dans tous les sens, passé, présent, futur, et les entraîne
vers un destin inattendu.
"Parle avec elle" est une histoire sur l'amitié entre deux
hommes, sur la solitude et la longue convalescence due aux blessures de la
passion. C'est aussi un film sur l'impossible dialogue dans le couple, mais
aussi sur la communication, sur le cinéma comme sujet de conversation.
Le film cherche à démontrer 1- qu'un monologue face au mutisme
peut s'avérer être une forme de dialogue. 2 -comment le silence
peut exprimer l'éloquence du corps, 3- comment le cinéma peut
apparaître comme un lien idéal dans les relations entre les gens,
et enfin, 4 -comment le cinéma raconté avec des mots peut retenir
le temps et s'installer aussi bien dans la vie du narrateur que dans celle
de celui qui écoute. Parle avec elle est un film sur le plaisir de
raconter et sur la parole comme arme pour fuir la solitude, la maladie, la
mort et la folie. C'est également un film sur la folie. Une folie parfois
si douce et pleine de bon sens qu'il est difficile de la dissocier de la normalité.
Tout sur ma mère se terminait par un rideau qui s'ouvrait
sur une scène plongée dans la pénombre. Parle avec elle
commence par le même un rideau s'ouvrant aussi sur une scène.
Les personnages de Tout sur ma mère étaient des actrices, des
hâbleuses, des femmes capables de jouer dans le film et hors du film.
Parle avec elle, c'est l'histoire de narrateurs qui parlent d'eux, d'hommes
qui parlent à qui peut les entendre et surtout à qui ne peut
pas les entendre.
INTIMITÉ ET SPECTACLE
Parle avec elle raconte une histoire intime, romantique et secrète dans laquelle sont disséminées des bribes d'autres histoires. Je fais référence aux scènes de corrida, au film muet, L'Amant qui rétrécissait et à la participation de Caetano Veloso qui chante en direct " Cucurrucucú " à Pina Bausch, la chorégraphe de " Café Müller " et de " Masurca Fogo ". Deux spectacles qui sont le prologue et l'épilogue de mon film. J'aimerais également remercier le retour sur scène de Malou, membre du premier Wuppertal Tanztheater et professeur, qui par pure générosité et pour la plus grande émotion de tous, a bien voulu remonter sur scène.
L'AMANT QUI RETRECISSAIT
C'est un extrait de film muet, que j'ai placé là, au milieu de la narration de Parle avec elle. C'est un film en noir et blanc. Ce sont les dernières couleurs qu'Alicia voie et que Benigno aime. Comme le film n'existait pas, il a fallu que je le fasse. J'avais déjà écrit l'histoire d'un homme qui rétrécissait. Elle était beaucoup plus longue que celle-ci. A l'origine, il s'agissait d'une histoire d'amour avec du suspense. Après avoir abandonné Amparo, la belle scientifique, l'homme qui rétrécissait, retourne chez sa mère, une femme autoritaire qu'il n'a pas revue depuis plusieurs années. Cela lui donne l'occasion de se réconcilier avec elle. Lorsqu'Alfredo ne mesure plus que quelques centimètres, il s'installe au milieu de ses jouets et vit entouré de ses objets préférés : livres, bandes dessinées, etc... Entre les pages d'un livre, il retrouve une lettre de son défunt père. Bien qu'elle lui soit adressée, Alfredo ne l'a jamais reçue. Dans la lettre, son père le met en garde contre la folie grandissante de sa mère et la désigne comme coupable si jamais il venait à disparaître. La mère pressent qu'Alfredo sait que c'est elle qui a tué son père. Alfredo vit reclus dans son train électrique, il refuse d'en sortir par peur de sa mère. Dans un accès de folie, la mère fouille le train, wagon par wagon. Amparo arrive ( elle finit par découvrir où habite la mère) et sauve le petit Alfredo. Elle l'emmène à son hôtel, l'hôtel Youkali. Pour des raisons évidentes, je n'ai gardé que le début et la fin de ce mélodrame. J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler sur ces deux passages. Cela faisait très longtemps que je rêvais de l'image de l'amant se promenant sur le corps de sa bien-aimée, un peu comme on se promène dans un paysage. Ça y est, c'est fait. Pour me mettre dans l'ambiance du muet, j'ai revu mes films préférés : Griffith, Fritz Lang, Murnau, Tod Browning... Ça a été essentiel. Je voulais rester fidèle au genre et à la forme de narration de l'époque. Je trouvais qu'il était plus attrayant de rester fidèle que d'ignorer les règles. A l'exception d'un ou deux plans, tous les plans du film ont été pris sur un pied, je n'ai pas utilisé un seul travelling. Le cadrage est très large et les acteurs donnent l'impression de faire irruption dans l'image. Les accessoires sont d'époque, ils datent de la moitié des années 20. Le jeu des acteurs est rigoureusement expressionniste sans trop exagérer. C'est une chance que Paz Vega et Fele Martinez se soient sentis à l'aise dans ce type de situation proche de la parodie, et sans jamais tomber dedans. Leur interprétation naïve, tragi-comique et sans aucun doute expressionniste se doit exclusivement à leur intuition et à leur talent. La musique aussi est un élément clef. Je ne voulais pas de l'éternel piano présent dans les films muets projetés à la cinémathèque. Alberto Iglesias m'a suggéré l'idée d'un quatuor. J'ai trouvé ça parfait. S'il y a un genre de composition qu'Alberto maîtrise, c'est bien celui-là. Je dois avouer que le résultat est poignant. Dans la plus pure tradition du cinéma musical, la mélodie se fond dans les mouvements des acteurs et aussi, dans les inserts. Le texte qui apparaît à l'écran acquiert de la voix, du rythme et du mouvement grâce à la musique. C'est vivant. La musique permet surtout de transposer l'histoire dans un champ émotionnel et d'éviter avec subtilité de tomber dans l'obscénité et le grotesque de l'histoire de L'Amant qui rétrécissait . Grâce à Paz Vega, Fele Martinez et Alberto Iglesias, L'Amant qui rétrécissait se transforme en un rêve lyrique, émouvant et profond malgré son apparente légèreté.
Critique de Jacques Mandelbaum Le Monde du mercredi 10 avril 2002 :
Parle avec elle est l'histoire de l'amitié entre deux hommes, scellée au chevet d'un femme ravie par la mort. Parle avec elle est aussi une chronique de la passion amoureuse menée jusqu'aux confins du surnaturel et de la folie. Parle avec elle est encore une évocation, sombre et lyrique à la fois, de la puissance rédemptrice de l'art devant la finitude et les insuffisances de la vie. Parle avec elle est enfin un mélodrame d'une beauté renversante, qui déconstruit avec virtuosité la linéarité de la vieille fable cinématographique pour mieux la ressourcer aux sortilèges immémoriaux du spectacle vivant, vibrant avec le chant (Caetano Veloso), palpitant avec la danse (Pina Bausch), consacrant l'effusion du sang dans la corrida, ou renaissant de ses cendres avec l'expressionnisme du cinéma muet.
C'est d'ailleurs au spectacle que Parle avec elle commence et qu'il finit, l'espace-temps séparant ces deux points sous le signe de l'absence et de la croyance (soit sous celui du cinéma) rendant finalement possibles la renaissance de deux personnages à la vie et la réincarnation de l'amour. Benigno, un jeune infirmier, et Marco, un écrivain qui approche de la quarantaine, sont les deux principaux protagonistes de cette Passion, au terme de laquelle l'un aura, en se sacrifiant, transmis à l'autre la folie de sa foi.
Le premier, mâle aventurier à l'âme meurtrie, s'amourache d'une femme torero qui l'abandonnera, avant de mourir, dans un geste de défi, sous les cornes d'un taureau lancé sur elle comme une noire fatalité. Le second, longtemps confiné dans les jupes d'une mère autoritaire, est un jeune homme efféminé, qui s'est entiché d'Alicia, pâle adolescente à l'inaccessible beauté, en l'observant depuis sa fenêtre danser dans l'immeuble d'en face. Plongée dans un coma irréversible à la suite d'un accident, la jeune fille est hospitalisée dans une clinique où Benigno parvient à se faire nommer infirmier pour enfin la posséder tout à lui.
C'est là que les deux hommes font connaissance, près du corps inerte de leurs bien-aimées, et dans des attitudes foncièrement différentes. Tandis que Marco ne sait que dire devant le corps supplicié de son aimée, Benigno ne cesse de parler à Alicia, d'entretenir et de caresser sa chair, persuadé qu'elle reviendra un jour à la vie. Comme un plan beaucoup plus tardif le révélera (face-à-face de part et d'autre d'une paroi de verre, chaque visage se superpose au reflet de l'autre visage), ces deux hommes pourraient bien ne faire qu'un.
Associés au corps immaculé de la jeune vierge qui les fascine, Marco, l'homme qui pleure devant toute manifestation charnelle de la beauté, et Benigno, le puceau qui parle à la mort, semblent ainsi incarner les deux faces d'un scandale qui n'a pas attendu Pedro Almodovar pour estomaquer les incrédules : celui du verbe qui se fait chair.
Il revient cependant au cinéaste d'avoir rendu cette histoire ancienne à sa folie et de l'avoir portée à son plus haut degré de sensualité baroque. L'opération proprement dite prend dans Parle avec elle la forme d'un extrait de film fantastique muet (réalisé pour l'occasion par Almodovar), introduit par Benigno qui est censé le raconter à Alicia. Intitulé L'Amant qui rétrécissait, celui-ci met en scène un homme au corps qui rétrécit, séquestré par une mère cruelle, puis délivré par une amante qu'il entreprend de faire jouir, en escaladant les massifs voluptueux de son corps puis en s'introduisant dans son sexe. Absolument saisissante, cette séquence involutive - il s'agit à la fois d'un flash-back, d'images qui se substituent aux paroles, d'un retour au berceau du cinéma et d'un homoncule qui revient dans le ventre de la femme - constitue également une scène-écran, qui masque, en même temps qu'elle révèle, l'inconcevable réalité qui se déroule au même moment, bientôt accouchée par le film.
Cet écran qui renvoie en même temps au fantasme originel et au mystère de la résurrection ne peut pas ne pas être rapporté à un événement que Pedro Almodovar relatait dans ces colonnes peu avant de réaliser ce film, le 17 septembre 1999 :
"Ce samedi, en sortant dans la rue, je découvre que la journée est magnifiquement ensoleillée. C'est le premier jour de soleil sans ma mère. Je pleure derrière mes lunettes de soleil."
C'est par ces mots que le cinéaste ouvrait un texte très émouvant écrit sous le coup de la mort de sa mère. Il y décrivait notamment ses visites dans le service de soins intensifs où celle-ci devait passer ses derniers jours, et, quelques heures avant sa mort, le rêve étrange qu'elle lui avait raconté. Il y rappelait également que sa mère, pour gagner sa vie, avait jadis exercé le métier d'écrivain public, et comment elle avait tendance à enjoliver les lettres qu'elle écrivait ou lisait, justifiant ce pieux mensonge par le contentement qu'elle procurait ainsi à leurs destinataires. Ce souvenir, le cinéaste en faisait au passage une manière de parabole pour définir la différence entre réalité et fiction, celle-ci comblant selon lui les imperfections de celle-là.
Si l'on prend la liberté d'évoquer ce texte, c'est qu'il y a lieu de penser - parce qu'on y retrouve tout à la fois les figures de la maternité, du dialogue avec la mort, de l'étrangeté du rêve et du pouvoir rédempteur de la fable - que Parle avec elle est à bien des égards une élaboration artistique de ce douloureux événement, une mise en scène où le travail du deuil et celui de la fiction révèlent leur profonde intimité.
Ce couple, au même titre que celui du désir et de la mort, n'est certes pas nouveau chez Pedro Almodovar, depuis les provocations inaugurales de la Movida jusqu'à l'inflexion discrètement bunuélienne qui marque son œuvre depuis quelques années. Mais il atteint ici un niveau de maîtrise et de beauté, de subtilité et de cohésion tel qu'il fait incontestablement de Parle avec elle l'œuvre de maturité d'un ex-enfant terrible du cinéma, au même titre que Hana-bi pour Takeshi Kitano, Yi-Yi pour Edward Yang ou La Chambre du fils pour Nanni Moretti.
Autant de films grâce auxquels leurs auteurs trouvent, dans l'inquiétude même de la mort, le ferment d'un apaisement et d'une éblouissante résurrection. Y aurait-il, dans l'art comme dans la vie, meilleure définition de la maturité ?
Un gâteau sec. Almodovar l'a posé devant lui, sur le plateau de son bureau, au début de l'entretien, comme la cible d'une course invisible. Avertissement silencieux, qui pèse plus lourd qu'un chronomètre sur le compte à rebours des questions-réponses. On a affaire à un réalisateur sous régime, surmené par la promotion de son nouveau film.
En ce mardi de mars, à quelques jours de la sortie de Parle avec elle en Espagne, l'affiche bleu et rouge du film s'étale à l'entrée des locaux flambant neufs d'El Deseo, sa société de production. Un petit immeuble de trois étages, dans le quartier madrilène des arènes de las Ventas, où filtrent, entre les murs pastel et les meubles vifs, les échos d'une frénésie occulte. Des cartons de déménagement traînent encore dans un coin du bureau, à côté de deux grands tableaux posés contre la cloison bleu layette : l'affiche de la Loi du désir et un "Meuble" surréaliste aux tiroirs débordant d'ustensiles de tournage. "Mes seuls objets de fétichisme", sourit Almodovar. La tension du début a disparu, balayée par son habituel professionnalisme, cette apparence de disponibilité totale qui relègue loin derrière la porte l'agitation des autres interviews en attente, des appels téléphoniques de Rome et de la bande-son française à auditionner...
Après l'oscar de Tout sur ma mère, on le croyait parti pour le grand saut d'un tournage sous pavillon hollywoodien. Au terme de trois ans de silence, le voilà qui revient, plus espagnol et plus indépendant que jamais, avec un film sans stars, sans ses comédiens habituels, et où les hommes ont la part plus belle que les femmes. C'est du Almodovar, évidemment, plein de rebondissements mélodramatiques et d'humour noir, mais un Almodovar aux antipodes de Femmes au bord de la crise de nerfs. Moins clinquant. De plus en plus sombre. Et qui grille la politesse aux grands festivals internationaux en leur préférant l'ouverture du Festival de Paris, lundi dernier, en avant-première. "J'aime mieux les "petits" festivals, assure-t-il. Et puis Paris, c'est vraiment la France. De toute façon, le film n'était pas prêt pour Berlin." Mais pourquoi pas Cannes ? "Et pourquoi aurais-je dû le présenter ?" Sourire glacial. "Depuis que j'ai entamé la réalisation, je n'ai pas eu le moindre appel du Festival de Cannes, pas le moindre signe d'intérêt, à aucun moment." Lapidaire, la mise au point. Cannes à snobé Almodovar pendant des années. Passons sur le dédain de Pepi, Luci, Bom et autres provocations amateuristes et délirantes des débuts, réalisées hors des horaires de bureau par ce jeune employé peu modèle des PTT espagnols, même pas diplômé d'une école de cinéma. A partir des années 80, l'ignorance a tourné au bizutage puis à l'aveuglement : Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, Matador, la Loi du désir passés à la trappe, et même le triomphal Femmes au bord de la crise de nerfs relégué à l'anonymat du marché... Autant d'"oublis" peu glorieux pour le festival, mais dont toute l'humiliation, alors, semblait retomber sur le trublion homosexuel de la movida. Aujourd'hui, la situation s'est quasiment inversée : Almodovar, rare pointure à avoir su imposer sa singularité sur la scène internationale, est devenu une exception culturelle à lui tout seul. Almodovar n'a plus besoin de la Croisette. Ce quatorzième film, il l'a fait "rien que pour lui" : un chant de la cinquantaine, dont il se dit "très orgueilleux" car il l'a mené comme un défi risqué, vécu dans la douleur : "J'étais malade, je luttais contre l'aphonie. Le 11 septembre m'a laissé un souvenir de cauchemar. Sur le plateau, on a été avertis de ce qui se passait à New York par téléphone, au bout d'un moment j'ai dû interdire toutes les communications, pour qu'on arrive à tourner. Mais l'atmosphère était irréelle. A l'heure exacte, je crois, où les tours se sont effondrées, j'ai complètement perdu la voix. Je devais écrire mes instructions. Ne pas parler, pour un réalisateur, c'est comme une castration." Inutile d'épiloguer sur la coïncidence de sa pathologie avec le sujet du film. On ne le coince pas sur les questions intimes. Jamais à court de mots, il ne confie le reflet de sa vie privée qu'à l'écran, où elle scintille, insaisissable. Il aime jouer des ambiguïtés de la transposition, glissant la silhouette des siens (sa mère, son producteur de frère) dans ses films. Dans Parle avec elle, c'est toute sa bande madrilène de comédiens et d'amis qu'il a réunie autour de Caetano Veloso, le temps d'une séquence magique de soirée musicale, sur une terrasse de villa au style californien. Cette belle résidence de campagne, dont on entr'aperçoit l'arrière-fronton à colonnade dans un reportage de Vanity Fair, c'est la sienne. Tout un symbole : l'iconoclaste a viré orchestrateur de soirée bobo, il a "révisé [ses] positions sur la drogue", reçu le titre de docteur honoris causa de l'université de Cuenca, ne s'exhibe plus en duo rock punk avec Fabio McNamara dans les boîtes underground mais filme Pina Bausch dans des théâtres à l'italienne...
La notoriété l'a coupé de cette petite bourgeoisie madrilène dont il était le chantre déjanté. Il en souffre. Se mêler aux gens, s'abreuver de leurs conversations a toujours été son plaisir : "Je me rappelle mon enfance, au village, dans la Mancha : les femmes discutant entre elles, dans la cour, alors que les hommes, ces pères manchegos, édictaient leurs sentences depuis leur fauteuil de Skaï. Ce sont elles qui arrangeaient les choses, avec leurs mensonges, qui préservaient la vie", confiait-il un peu avant la mort de sa mère ("la seule vraie tragédie de ma vie"), en 1999.
Naguère, il disait qu'il détestait "tellement le franquisme [qu'il ne voulait] même pas permettre à son souvenir d'exister à travers [ses] films". Ces derniers temps, il s'est ré-attelé à l'écriture d'un vieux projet "à contenu biographique" : "la mauvaise éducation". "Un sujet articulé en deux parties : une période enfantine, dans les années 60, et une autre vingt ans plus tard, quand les deux protagonistes croisent à nouveau leurs anciens éducateurs religieux, qui ne sont plus curés." Il se durcit, un instant ramené à ses propres souvenirs de jeunesse, du temps de l'ordre moral : l'école et les collèges religieux, jusqu'à l'envol libératoire vers Madrid, "à 16 ans"... "Le film sera un mélange de comédie musicale et de film de terreur gothique, vraiment noir. Délibérément manichéen : cette fois, je désigne des méchants pour des méchants." Pour l'instant, il butte sur un problème d'interprétation : "L'un des personnages est un acteur qui doit être capable d'interpréter, dans le film, trois rôles : un homme, sec et musculeux, une femme, séduisante, et un jeune homme, plus anodin." A ce jour, il n'a pas trouvé l'oiseau rare. En attendant, il a plein d'autres scripts, originaux ou adaptés, sous le coude. Il y a notamment ce roman français, dont il a acquis les droits et qu'il voudrait transposer en Espagne : "Mygale, de Thierry Jonquet. Vous connaissez ?" Fin du gâteau sec.