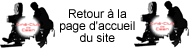|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Le pont des arts




 Paris,
1979-1980. Une histoire d'amour impossible entre deux jeunes gens qui ne se
rencontrent jamais : l'une est cantatrice tandis que l'autre a découvert
sa voix au moment où il allait mettre fin à ses jours.
Paris,
1979-1980. Une histoire d'amour impossible entre deux jeunes gens qui ne se
rencontrent jamais : l'une est cantatrice tandis que l'autre a découvert
sa voix au moment où il allait mettre fin à ses jours.


 Pour Jacques Mandelbaum
et Isabelle Régnier (Le Monde du 9/11/2004) :
Pour Jacques Mandelbaum
et Isabelle Régnier (Le Monde du 9/11/2004) :
"
Dans son troisième long métrage, habité tout du long par un air de Monteverdi,
l'Américain Eugène Green conte l'histoire singulière, entre comédie et tragédie,
d'un jeune homme tombé amoureux d'une chanteuse qui vient de se suicider.
Théoricien (à l'université) et praticien (au théâtre) de la question avant d'entrer en cinéma, Eugène Green a toujours revendiqué ses affinités avec l'art baroque. Dans Le Pont des Arts, l'auteur s'attaque frontalement à son sujet, en envisageant notamment de faire tenir ensemble des vérités réputées incompatibles. La seule voie imaginable en la matière sera celle de l'art, défini ici, par le titre même, comme un pont jeté entre les rives de la réalité et de l'imaginaire, de la satire et du sublime, de la tragédie et de la farce, mais aussi bien de la vie et de la mort. Voici donc un film installé en permanence sur le fil du rasoir, d'un antiutilitarisme féroce, d'une subtile délicatesse et d'une drôlerie vacharde, d'une évidente modernité et d'un goût altier pour la tradition, une œuvre tout à la fois forte de ses convictions et ténue comme l'utopie.
CHARGE CONTRE LA MÉDIOCRITÉ
Situé dans le milieu parisien de la culture au début des années 1980, Le Pont des Arts met en scène deux couples de jeunes gens désaccordés dont la rupture respective suscite l'impossible rencontre que ce film a sans doute pour seule vocation d'incarner : celle de l'histoire d'amour entre un vivant et une morte. Cette histoire impossible sera portée à son plus haut degré de musicalité par le retour entêtant du sublime Lamento della ninfa de Monteverdi. Parions que ce morceau conquerra le cœur de tous les spectateurs à qui la musique baroque était a priori une terre étrangère.
Les couples, donc. Ici, Christine, ambitieuse agrégative en philosophie à laquelle Pascal, étudiant dilettante en littérature et sosie approximatif de Jean-Pierre Léaud, peine à s'agréger. Là, Sarah, chanteuse dans un ensemble baroque, dont la fragilité mélancolique trouve en Manuel, ingénieur en informatique, un soutien trop attaché à la matérialité des choses pour la dissuader de sa mortelle inquiétude.
Autour de ces deux couples, attachants comme le sont ceux de Jean Eustache, existent des forces qui semblent conspirer à leur inéluctable déchirement. C'est contre la renommée usurpée de ces forces, contre l'institutionnalisation du savoir, du pouvoir et de la médiocrité qu'elles incarnent qu'Eugène Green fait claironner les trompettes truculentes de la colère et de la satire.
Ce peut être un de ces établissements parisiens dont l'idée de la convivialité lui fait mériter le nom de "café glauque". Ce peut être une enseignante d'université grotesque dont la seule glose de Jacques Vaché consiste à mimer, façon dinde savante, un "silence colossal" devant ses étudiants. Ce sera aussi, plus essentiellement, cette formation de musique baroque à laquelle appartient Sarah, dirigée par un chef ambitieux, sadique et insensible baptisé "l'Innommable". Cet impavide dandy, un artiste renommé doublé d'une ordure humaine, est entouré d'une clique de notabilités qui négocient la vie culturelle parisienne en s'échangeant d'un air gourmand de jeunes "régisseurs".
La charge est sévère, mais Denis Podalydès, dans le rôle de l'Innommable, la tire vers une fantaisie proprement délirante, à partir d'une palette de grimaces et d'accents totalement indéfinis. Deuxième pari lancé au passage : que le "Aho !" de Podalydès, décliné de toutes les façons possibles et imaginables, deviendra aussi fameux que le "O.K." de Christian Clavier dans Les Visiteurs - on peut toujours rêver. Cet être teigneux et mesquin, à force de cruauté et de brimades, pousse la jeune Sarah (lumineuse Natacha Régnier), son envers porté par la grâce, au suicide. Engloutie dans les eaux froides et noirâtres de la Seine, sa voix, par l'entremise d'un disque, n'en sauve pas moins Pascal, séparé d'avec Christine, du suicide où son spleen l'a conduit.
Ainsi naît tardivement dans le film, à partir d'un plan bressonien de cuisinière à gaz, une singulière histoire qui voit un jeune rescapé tomber éperdument amoureux d'une voix, avant de rencontrer, dans son éclatante vitalité, le corps qui l'abritait. Cela par la seule puissance de l'art, sur le pont qui en porte le nom. Devenu le socle d'un espace-temps indéfinissable, celui de l'art, de l'amour, du baroque, de la fusion de la vie et de la mort, celui-ci accueille la rencontre des deux amants, séparés par un champ-contrechamp vertigineux, mais unis dans une lumière invisible pour entonner un sublime duo amoureux.
Cette scène à tous égards fantastique
aura été rendue possible par un film qui emprunte à Janus,
le dieu du passage, sa double face, tout en affirmant crânement l'éternelle
primauté du principe spirituel sur la réalité corruptible
d'une matière vouée au néant. Nulle vanité d'artiste
là-dedans, juste ce rappel, autorisé par la croyance du cinéaste
en la puissance de son art, qu'il ne faut s'attendre à rien trouver
d'autre, derrière nos masques, que le néant qui nous envisage.
Et quand tant de grâce et d'émotion peuplent cette chimère
qu'est le cinéma, c'est bien la moindre des choses qu'une autre chimère
- celle d'un texte formé par deux voix et écrit à quatre
mains - lui rende hommage.
"
Jacques Mandelbaum et Isabelle
Régnier
"
Le pont des Arts est un pont du début du XIXe siècle qui relie
deux monuments majeurs du Grand Siècle : l'Institut et le Louvre. Celui
que Green filme le plus, c'est l'Institut, le siège des Académies,
qui était à l'origine un collège de gentilshommes fondé
par le testament de Mazarinalors que sur l'autre rive, Le palais du Louvre
avec sa façade monumentale est un un peu sévère.
On n'opposera pourtant pas un classicisme austère et un bâtiment chatoyant car les deux sont œuvres du même architecte, Louis Le Vau. Clin d'œil ou heureux hasard, le cinéaste filme ainsi l'endroit où est mise en évidence la fragilité de l'opposition baroque, classique.
La mise en scène de l'actuel Institut, filmé au niveau de la Seine, contribue à l'évocation d'une époque : Green nous rapproche ainsi de ce que l'on voit sur les tableaux du XVIIe, avec une différence de hauteur entre le monument et ce qui l'entoure. L'Ancien Régime est une époque hiérarchisée, y compris sur le plan de l'espace, alors que, aujourd'hui, les monuments sont un peu noyés au milieu des grands immeubles haussmanniens. Enfin, moment de pur plaisir, le cinéaste filme l'ancienne abbaye royale du Val-de-Grâce, sans doute le monument le plus "romain" de Paris, avec sa puissante façade, son grand dôme et ses marbres.
Dernier bonheur pour l'amateur de beaux lieux parisiens, cette scène dans l'église Saint-Nicolas-des-Champs, avec le grand retable de Simon Vouet, inspiré de L'Assomption de Titien, aux Frari de Venise.
Alexandre Gady , historien de l'art et de l'architecture