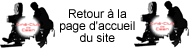|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
- chapitre 2 : Cadre et plan, cadrage et découpage.
- chapitre 3 : Montage
- chapitre 4 : L'image-mouvement et ses trois variétés
- chapitre 5 : L'image perception
- chapitre 6 : L'image-affection.
- chapitre 7 : L'image affection : qualités, puissances, espaces
- Chapitre 8 : De l'affect à l'action : l'image-pulsion.
- chapitre 9 : L'image-action : la grande forme.
- chapitre 10 : l'image action : la petite forme
- chapitre 11 : transformation des formes : Eisenstein, Mizoguchi, Kurosawa
- chapitre 12 : La crise de l'image-action.
chapitre 2 : cadre et plan, cadrage et découpage
![]()
On appelle cadre, le système clos, relativement clos, qui comprend tout ce qui est présent dans l'image, décors personnages, accessoires. Les éléments contenus dans le cadre sont tantôt en très grand nombre, tantôt en nombre très restreint. Le cadre est donc inséparable de deux tendances, à la saturation, ou à la raréfaction. Le grand écran et la profondeur de champ ont permis de multiplier les données indépendantes, alors qu'au contraire, les images raréfiées se produisent soit lorsque tout l'accent est mis sur un seul objet (le verre de lait dans Soupçons de Hitchcock, soit lorsque l'ensemble est vidé de certains sous-ensembles (les paysages désertés d'Antonioni).
Le cadre est géométrique ou physique, tantôt comme préalable à l'existence des corps composés d'un espace en parallèles et diagonales (Dreyer, Antonioni tantôt dynamique s'adaptant jusqu'où va la puissance d'un corps (iris chez Griffith, écran variable chez Gance).
Griffith utilise un cadre géométrique dans Intolérance lorsque dans un plan, il coupe l'écran suivant une verticale qui correspond au mur d'enceinte de Babylone. A gauche, les chars entrent et sortent sur l'horizontale inférieure aux portes de la cité. A droite, on voit le roi s'avancer sur une horizontale supérieure, chemin de ronde en haut du mur. Eisenstein étudie les effets de la section d'or sur l'image cinématographique. Dreyer explore les horizontales et les verticales, les symétries, le haut et le bas, les alternances de noir et blanc. Les expressionnistes développent des diagonales et des contre-diagonales. La nature joue évidemment un rôle fondamental comme dans les ciels de Ford : la séparation du ciel et de la terre, la terre ramenée au bas de l'écran. Les portes, les fenêtres, les guichets, les lucarnes, les vitres de voiture, les miroirs sont autant de cadres dans le cadre avec lesquels les grands auteurs ont des affinités particulières
La conception physique du cadre induit des ensembles flous qui ne se divisent plus qu'en zones ou plages. Le cadre n'est plus l'objet de divisions géométriques, mais de graduations physiques. C'est l'heure où l'on ne peut plus distinguer l'aurore et le crépuscule, ni l'air ni l'eau, l'eau et la terre, dans le grand mélange d'un marais ou d'une tempête (Murnau : L'aurore, Nosferatu). Ici c'est par les degrés du mélange que les parties se distinguent et se confondent dans une transformation continue des valeurs
Le cadre donne une commune mesure à ce qui n'en a pas, plan lointain d'un paysage et gros plan de visage, système astronomique et goutte d'eau, parties qui ne sont pas au même dénominateur de distance, de relief, de lumière. Le cadre assure une déterritorialisation de l'image.
Le cadre se rapporte à un angle de cadrage. L'ensemble clos sur lui-même renvoie en effet à un point de vue. A moins de tomber dans un esthétisme vide, il doit s'expliquer soit du point de vue d'un ensemble plus vaste qui comprend le premier soit du point de vue d'un élément d'abord inaperçu, non donné, d'un premier ensemble. Le point de vue peut paraître insolite, paradoxal comme dans une séquence de L'homme que j'ai tué de Lubitsch : la caméra dans un travelling latéral à mi-hauteur, montre une haie de spectateurs vus de dos, et tente de se glisser au premier rang, puis s'arrête sur un unijambiste dont la jambe manquante ménage une échappée sur le spectacle, un défilé militaire qui passe. Elle cadre donc la jambe valide, la béquille et, sous le moignon, le défilé. Cet angle de cadrage insolite est justifié par un autre plan qui montre un autre infirme derrière le premier, un cul-de-jatte qui voit précisément le défilé ainsi et qui actualise le point de vue précédent. Pascal Bonitzer a construit le concept de décadrage pour désigner ces points de vue anormaux qui ne se confondent pas avec un angle paradoxal et renvoient à une autre dimension de l'image (cadres coupants de Dreyer avec ses visages coupés au bord de l'écran dans La passion de Jeanne d'Arc, les cadrages de nature morte chez Ozu ou les espaces déconnectés chez Bresson dont les parties ne se raccordent pas, excèdent toutes justifications narrative ou pragmatique et renvoient à une dimension spirituelle de l'image ;
Le hors-champ renvoie à ce que l'on n'entend ni ne voit, pourtant parfaitement présent. Cette présence renvoie selon Bazin à deux conceptions : cache ou cadre. Tantôt le cadre opère comme un cache mobile suivant lequel tout ensemble se prolonge dans un ensemble homogène plus vaste avec lequel il communique. Tantôt le cadre opère comme un cadre pictural qui isole un système et en neutralise l'environnement. Cette dualité s'exprime de manière exemplaire entre Renoir et Hitchcock, l'un pour qui l'espace et l'action excèdent toujours les limites du cadre qui n'opère qu'un prélèvement sur une aire, l'autre chez qui le cadre opère un "enfermement de toutes les composantes " et agit comme un cadre de tapisserie plus encore que pictural ou théâtral ;
Mais un système clos, même très refermé, ne supprime le hors-champ qu'en apparence et lui donne à sa manière une importance plus décisive encore. Tout cadrage détermine un hors-champ. Il n'y a pas deux types de cadre dont l'un seulement renverrait au hors-champ, il y a plutôt deux aspects très différents du hors-champ dont chacun renvoie à un mode de cadrage.
Tout système clos est aussi communicant. Il y a toujours un fil pour relier n'importe quel ensemble à un ensemble plus vaste. Il est, d'une part, relié dans l'espace à d'autres systèmes par un fil plus ou moins ténu. D'autre part, il est intégré à un tout qui lui transmet une durée le long de ce fil. Le hors-champ a ainsi deux aspects qui diffèrent en nature : un aspect relatif par lequel un système clos renvoie dans l'espace à un ensemble que l'on ne voit pas, et qui peut à son tour être vu, quitte à susciter un nouvel ensemble non-vu à l'infini ; un aspect absolu par lequel le système clos s'ouvre à une durée immanente au tout de l'univers, qui n'est plus un ensemble et n'est pas de l'ordre du visible mais du lisible. Les cadrages qui ne se justifient pas pragmatiquement renvoient précisément à ce deuxième aspect comme à leur raison d'être.
Quand nous considérons une image cadrée comme système clos, nous pouvons dire qu'un aspect l'emporte sur l'autre suivant la nature du fil. Plus le fil est épais qui relie l'ensemble vu à d'autres ensembles non-vus, mieux le hors champ réalise sa première fonction, qui est d'ajouter de l'espace à l'espace. Mais, quand le fil est très ténu, il ne se contente pas de renforcer la clôture du cadre, ou d'éliminer les rapports avec le dehors, mieux le hors-champ réalise son autre fonction d'introduire du trans-spatial et du spirituel dans le système. Dreyer en avait fait une méthode ascétique : plus l'image est spécialement fermée, réduite même à deux dimensions, plus elle est apte à s'ouvrir sur la dimension de l'esprit et du temps, la décision spirituelle de Jeanne ou de Gertrud. Dans le cadre géométrique d'Antonioni, lorsque le personnage attendu n'est pas encore visible (première fonction du hors-champ) il est momentanément dans une zone de vide, proprement invisible (seconde fonction). Les cadres d'Hitchcock ne se contentent pas de neutraliser l'environnement, de pousser le système clos aussi loin que possible et d'enfermer dans l'image le maximum de composantes ; Ils feront en même temps de l'image une image-mentale ouverte sur un jeu de relations purement pensées qui tissent un tout.
Il y a ainsi toujours à la fois les deux aspects du hors-champ, le rapport actualisable avec d'autres ensembles, le rapport virtuel avec le tout. Mais dans un cas, le second rapport, le plus mystérieux, sera atteint indirectement, à l'infini, par l'intermédiaire et l'extension du premier, dans la succession des images ; dans l'autre cas, il sera atteint plus directement, dans l'image même, et par neutralisation et limitation du premier.
Gilles Deleuze distingue quatre écoles de montage : la tendance organique de l'école américaine, la dialectique de l'école russe, la quantitative de l'école française d'avant-guerre, l'intensive de l'école expressionniste allemande.
Le montage organique :
Un film de Griffith est conçu comme une grande unité organique. L'organique c'est d'abord une unité dans le divers, c'est-à-dire un ensemble de parties différenciées : les hommes et les femmes, les riches et les pauvres, la ville et la campagne, le Nord et le Sud, les intérieurs et les extérieurs. Ces parties sont prises dans des rapports binaires qui constituent un montage alterné parallèle, l'image d'une partie succédant à celle d'une autre suivant un rythme.
Mais il faut aussi que la partie et l'ensemble entrent eux-mêmes en rapport, qu'ils échangent leur dimension relative. L'insertion du gros plan, en ce sens, n'opère pas seulement le grossissement d'un détail mais entraîne une miniaturisation de l'ensemble, une réduction de la scène à l'échelle d'un personnage. En montrant la manière dont un personnage vit la scène dont il fait partie, le gros plan dote l'ensemble objectif d'une subjectivité qui l'égale ou même le dépasse.
Enfin, il faut encore que les parties agissent et réagissent les unes sur les autres, à la fois pour montrer comment elles entrent en conflit ou restaurent l'unité. De certaines parties émanent des actions qui opposent le bon et le méchant, mais d'autres parties émanent des actions convergentes qui viennent secourir le bon : c'est la forme du duel qui se développe à travers toutes ces actions et passe par différents stades.
En effet il appartient à l'ensemble organique d'être toujours menacé ; ce dont les noirs sont accusés dans Naissance d'une nation c'est de vouloir briser l'unité récente des Etats-unis en profitant de la défaite du Sud. Les actions convergentes tendent vers une même fin, rejoignant le lieu du duel pour en renverser l'issue, sauver l'innocence ou restaurer l'unité compromise, telle la galopade des cavaliers qui viennent au secours des assiégés. C'est la troisième figure du montage, montage convergent, qui fait alterner les moments des deux actions qui vont se rejoindre. Et plus les actions convergent, plus la jonction approche, plus l'alternance est rapide (montage accéléré)
Le montage dialectique :
La loi du processus quantitatif et du saut qualitatif : le passage d'une qualité à une autre et le surgissement soudain de la nouvelle qualité. L'un qui devient deux et redonne une nouvelle unité, réunissant le tout organique et l'intervalle pathétique.
Eisenstein fait un reproche majeur à Griffith : les parties différenciées de l'ensemble sont données d'elles-mêmes comme des objets indépendants. Il est dès lors forcé que lorsque les représentants de ces parties s'opposent, ce soit sous forme de duels individuels où les motivations collectives recouvrant des motivations étroitement personnelles (par exemple une histoire d'amour, élément mélodramatique). Griffith ignore que les riches et les pauvres ne sont pas donnés comme des phénomènes indépendants, mais dépendent d'une même cause qui est générale qui est l'exploitation sociale. Ce qu'Eisenstein reproche à Griffith, c'est de s'être fait de l'organique une conception toute empirique, sans loi de genèse ne de croissance ; c'est d'en avoir conçu l'unité d'une manière toute extrinsèque, comme unité de rassemblement, assemblage de parties juxtaposées et non pas unité de production, cellule qui produit ses propres parties par division, différenciation ; c'est d'avoir compris l'opposition de manière accidentelle, et non comme la force motrice interne par laquelle l'unité divisée reforme une unité nouvelle à un autre niveau.
L'organique est une grande spirale conçue scientifiquement en fonction d'une loi de genèse, de croissance et de développement. La spirale organique trouve sa loi interne dans la section d'or, qui marque un point césure, et divise l'ensemble en deux grandes parties opposables mais inégales. On a un montage d'opposition et non plus un montage parallèle.
La composition dialectique ne comporte pas seulement la spirale organique, mais aussi le pathétique ou le développement. Il n'y a pas seulement unité organique des opposés, lien organique entre deux instants, mais bond pathétique où le deuxième instant acquiert une nouvelle puissance puisque le premier est passé en lui. De la tristesse à la colère, du doute à la certitude, de la résignation à la révolte. Le pathétique est passage d'un terme à l'autre, d'une qualité à une autre, et le surgissement soudain de la nouvelle qualité qui naît du passage accompli. Il est à la fois compression et explosion. La ligne générale divise sa spirale en deux parties opposées, "L'ancien" et "Le nouveau" et reproduit sa division, répartit ses oppositions d'un côté comme de l'autre : c'est l'organique. Mais, dans la scène célèbre de l'écrémeuse, on assiste au passage d'un moment à l'autre, de la méfiance et de l'espoir au triomphe, du tuyau vide à la première goutte, passage qui s'accélère à mesure que s'approche la qualité nouvelle, la goutte triomphale : c'est le pathétique, le bond ou le saut qualitatif.
Le montage quantitatif :
Dans l'école française d'avant guerre (Abel Gance) on assiste aussi à une rupture avec le principe de composition organique. Avec un certain cartésianisme le maximum de mouvements est recherché, composition mécanique (fête foraine d'Epstein dans Cœur fidèle, bal de Marcel L'Herbier dans El Dorado, les farandoles de Grémillon. Plus que la conception organique des danseurs ou la conception dialectique de leurs mouvements, on cherche à abstraire un seul corps qui serait le danseur et un seul mouvement. A la limite, la danse serait une machine dont les pièces seraient les danseurs. Le type de machine privilégié est l'automate, machine simple ou mécanisme d'horlogerie. Clair mouvement mécanique comme loi du maximum de mouvement pour un ensemble d'images qui réunit en les homogénéisant les choses et les vivants, l'animé et l'inanimé. Les pantins, les passants, les reflets des pantins, les ombres de passants vont rentrer dans des rapports très subtils d'alternance, de retour périodiques et de réaction en chaîne qui constituent l'ensemble auquel le mouvement mécanique doit être appliqué (la fugue de L'Atalante, la composition de La règle du jeu, les abstractions géométriques dans un espace homogène lumineux et gris, sans profondeur de René Clair, Un chapeau de paille d'Italie, Le million). L'objet concret, l'objet de désir, apparaît comme moteur ou ressort agissant dans le temps. L'individualisme est partout l'essentiel, il tient le rôle de ressort ou de moteur développant ses effets dans le temps, fantôme, illusionniste ou savant fou destiné à s'effacer quand le mouvement qu'il détermine aura atteint son maximum ou l'aura dépassé. Goût général pour l'eau, la mer ou les rivières permettent de trouver dans l'image liquide une nouvelle extension de la quantité de mouvement dans son ensemble ; de meilleures conditions pour passer du concret à l'abstrait, une plus grande possibilité de communiquer aux mouvements une durée irréversible indépendamment de leurs caractères figuratifs. Pour la lumière, l'école française substitue l'alternance à l'opposition dialectique et au conflit expressionniste.
Le montage expressionniste :
A la force infinie de la lumière, s'opposent les ténèbres comme une force également infinie sans laquelle elle ne pourrait se manifester. La lumière n'a qu'une chute idéale, mais le jour, lui, a une chute réelle : telle est l'aventure de l'âme individuelle, happée par un trou noir dont l'expressionnisme donnera des exemples vertigineux (la chute de Marguerite dans le Faust de Murnau, celle du Dernier des hommes avalé par le trou noir des salles de toilette du grand hôtel, ou chez Pabst celle de Lulu). La vie non organique des choses, une vie terrible qui ignore la sagesse et les bornes de l'organisme. Un mur qui vit est quelque chose d'effroyable; mais ce sont aussi les ustensiles, les meubles, les maisons et leurs toits qui penchent, se serrent, guettent ou happent. L'expressionnisme est un mouvement violent qui ne respecte ni le contour organique, ni les déterminations mécaniques de l'horizontal et du vertical. Worringer, qui a créé le terme expressionnisme, l'a défini par l'opposition de l'élan vital à la représentation organique, invoquant la ligne décorative " gothique ou septentrional ": ligne brisée qui ne forme aucun contour où se distingueraient la forme et le fond, mais passe en zigzag entre les choses, tantôt les entraînant dans un sans fond où elle se perd elle-même, tantôt les faisant tournoyer dans un sans-forme où elle se retrouve en "convulsion désordonnée ".
chapitre 4-2 : L'image mouvement et ses trois variétés
![]()
Gilles Deleuze distingue trois grands types de cinéma : le cinéma réaliste avec ses trois types d'images mouvements (perception, action, affection), le cinéma naturaliste avec l'image pulsion et le cinéma moderne qui joue sur la rupture des liens sensori-moteurs pour proposer des images mentales dont Alfred Hitchcock est le précurseur.
Le cinéma réaliste articule des milieux et des comportements, des milieux qui actualisent et des comportements qui incarnent alors que le cinéma naturaliste oppose deux milieux particuliers le milieu des mondes dérivés et celui des mondes originaires. Une pulsion n'est pas un affect, parce qu'elle est une impression, au sens le plus fort, et non pas une expression.
La chose et la perception de la chose sont une seule et même chose mais rapportée à deux systèmes de référence distincts. La chose, c'est l'image telle qu'elle est en soi, telle qu'elle se rapporte à toutes les autres images dont elle subit intégralement l'action et sur lesquelles elle réagit immédiatement. Dans la perception ainsi définie, il n'y a jamais autre ou plus que dans la chose : au contraire il y a "moins". Nous percevons la chose, moins ce qui ne nous intéresse pas en fonction de nos besoins. Par besoin ou intérêt il faut entendre les lignes et points que nous retenons de la chose en fonction de notre force réceptrice, et les actions que nous sélectionnons en fonction des réactions retardées dont nous sommes capables. Ce qui est une manière de définir le premier moment matériel de la subjectivité : elle est soustractive, elle soustrait de la chose ce qui ne l'intéresse pas (…)
Si le cinéma n'a nullement pour modèle la perception naturelle subjective, c'est parce que la mobilité de ses centres, la variabilité de ses cadrages, l'amènent toujours à restaurer de vastes zones acentrées et décadrées : il tend alors à rejoindre le premier régime de l'image-mouvement, l'universelle variation, la perception totale, objective et diffuse. En fait, il parcourt le chemin dans les deux sens. Du point de vue qui nous occupe pour le moment, nous allons de la perception totale objective qui se confond avec la chose à une perception subjective qui se distingue par simple élimination ou soustraction. C'est cette perception subjective unicentrée qu'on appelle perception proprement dite. Et c'est le premier avatar de l'image-mouvement : quand on la rapporte à un centre d'indétermination, elle devient image-perception.
On ne croira pas pourtant que toute l'opération consiste uniquement en une soustraction. Il y a autre chose aussi. Quand l'univers des images-mouvement est rapporté à une de ces images spéciales qui forme un centre en lui, l'univers s'incurve et s'organise en l'entourant. On continue d'aller du monde au centre, mais le monde a pris une courbure, il est devenu périphérie, il forme un horizon. On est encore dans l'image-perception mais on entre dans l'image-action. En effet la perception n'est qu'un côté de l'écart, dont l'action est l'autre côté. Ce qu'on appelle action, à proprement parler, c'est la réaction retardée du centre d'indétermination. Or ce centre n'est capable d'agir en ce sens, c'est-à-dire d'organiser une réponse imprévue, que parce qu'il perçoit et a reçu l'excitation sur une face privilégiée, éliminant le reste. Ce qui revient à rappeler que toute perception est d'abord sensori-motrice… Si le monde s'incurve autour du centre perceptif, c'est donc déjà du point de vue de l'action dont la perception est inséparable. Par l'incurvation, les choses perçues me tendent leur face utilisable, en même temps que ma réaction retardée, devenue action, apprend à les utiliser… C'est le même phénomène d'écart qui s'exprime en terme de temps dans mon action et en terme d'espace dans ma perception : plus la réaction cesse d'être immédiate et devient véritablement action possible, plus la perception devient distante et anticipatrice, et dégage l'action virtuelle des choses ( …)
Tel est donc le deuxième avatar de l'image-mouvement : elle devient image-action. On passe insensiblement de la perception à l'action. L'opération considérée n'est plus l'élimination, la sélection ou le cadrage mais l'incurvation de l'univers, d'où résultent à la fois l'action virtuelle des choses sur nous et notre action possible sur les choses. C'est le second aspect matériel de la subjectivité (...)
Mais l'intervalle ne se définit pas seulement par la spécialisation de ces deux faces-limites, perceptive et active. Il y a l'entre-deux. L'affection, c'est ce qui occupe l'intervalle, ce qui l'occupe sans le remplir ni le combler. Elle surgit dans le centre d'indétermination, c'est-à-dire dans le sujet, entre une perception troublante à certains égards et une action hésitante. Elle est donc coïncidence du sujet et de l'objet, ou la façon dont le sujet se perçoit lui-même, ou plutôt s'éprouve et se ressent " du dedans ". (troisième aspect matériel de la subjectivité)
Chapitre 5 : l'image-perception : ![]()
Pasolini pensait que l'essentiel de l'image cinématographique ne correspondait ni à un discours direct ni à un discours indirect, mais à un discours indirect libre. Il consiste en une énonciation prise dans un énoncé qui dépend lui-même d'une autre énonciation. Par exemple : "Elle rassemble son énergie : elle souffrira plutôt la torture que de perdre sa virginité. Le linguiste Bakhtine, à qui nous empruntons cet exemple, pose bien le problème : il n'y a pas mélange entre deux sujets d'énonciation tout constitués dont l'un serait rapporteur et l'autre rapporté. Il s'agit plutôt d'un agencement d'énonciation, opérant à la fois deux actes de subjectivisation inséparables, l'un qui constitue un personnage à la première personne, mais l'autre assistant à sa naissance et le mettant en scène. Il n'y a pas mélange ou moyenne entre deux sujets mais différentiation de deux sujets corrélatifs dans un système lui-même hétérogène….
Pour Pasolini : une langue laisse d'autant plus affleurer le discours indirect libre qu'elle est riche en dialectes, ou plutôt que, au lieu de s'établir sur un "niveau moyen" elle se différencie en "langue basse et langue soutenue". Pasolini pour son compte appelle Mimesis cette opération de deux sujets d'énonciation dans le discours indirect libre. Peut-être ce mot n'est-il pas heureux, puisqu'il ne s'agit pas d'une imitation mais d'une corrélation entre forces dissymétriques. Pasolini tenait au mot Mimesis pour souligner le caractère sacré de l'opération.
Ce dédoublement du sujet dans le langage c'est le Cogito cartésien. Le cogito dans la pensée : un sujet empirique ne peut pas naître au monde sans se réfléchir en même temps dans un sujet transcendantal qui le pense, et dans lequel il se pense. Le cogito dans l'art : pas de sujet qui agisse sans un autre qui le regarde agir, et qui le saisisse comme agi, prenant sur soi la liberté dont il le dessaisit.
Pour Pasolini, le cinéma de poésie c'est ceci. Un personnage agit sur l'écran et est supposé voir le monde d'une certaine façon. Mais en même temps, la caméra le voit, et voit son monde, d'un autre point de vue, qui pense, réfléchit et transforme le point de vue du personnage. Pasolini dit : l'auteur "a remplacé le bloc de vision du monde d'un névrosé par sa propre vision délirante d'esthétisme". Il est bon en effet que le personnage soit névrosé pour mieux marquer la naissance difficile d'un sujet dans le monde.
Mais la caméra ne donne pas simplement la vision du personnage et de son monde, elle impose une autre vision dans laquelle la première se transforme et se réfléchit. Ce dédoublement est ce que Pasolini appelle une "subjectivité indirecte libre". Il s'agit de dépasser le subjectif et l'objectif vers une forme pure qui s'érige en vision autonome du contenu. Nous ne sommes plus devant des images subjectives ou objectives. Nous sommes pris dans une corrélation entre une image-perception et une conscience caméra qui la transforme. C'est un cinéma très spécial qui a acquis le goût de faire sentir la caméra. Et Pasolini analyse un certain nombre de procédés stylistiques qui témoignent de cette conscience réfléchissante ou de ce cogito proprement cinématographique : "le cadrage insistant", "obsédant" qui fait que la caméra attend qu'un personnage entre dans le cadre, qu'il fasse et dise quelque chose, puis sorte, alors qu'elle continue à cadrer l'espace redevenu vide : "laissant à nouveau le tableau à sa pure et absolue signification de tableau" ; "l'alternance de différents objectifs sur une même image" et "l'usage excessif du zoom" qui doublent la perception d'une conscience esthétique indépendante….
Ce qui caractérise le cinéma de Pasolini, c'est une conscience poétique du sacré qui lui permet de porter l'image perception ou la névrose de ses personnages à un niveau de bassesse ou de bestialité, dans les contenus les plus abjects, tout en les réfléchissant dans une pure conscience poétique animée par l'élément mythique et sacralisant. C'est cette permutation du trivial en noble, actes communication de l'excrémentiel et du beau, cette projection dans le mythe que Pasolini diagnostiquait déjà dans le discours indirect libre comme forme essentielle de la littérature. Et il arrive à en faire une forme cinématographique capable de grâce autant que d'horreur
Deleuze propose d'appeler dicisigne, la subjectivité libre indirecte, cette conscience caméra, lorsque la mi-subjectivité de l'image marque une immobilisation dans une forme esthétique supérieure
Chapitre 6 : l'image-affection : le
visage ![]()
Chapitre 6
En peinture, les techniques du portrait nous ont habitués à deux pôles du visage. Tantôt le peintre saisit le visage comme un contour, en une ligne enveloppante qui trace le nez la bouche, le bord des paupières et même la barbe et la toque : c'est une surface de visagéification. Tantôt au contraire, il opère par traits dispersés pris dans la masse, lignes fragmentaires et brisées qui indiquent ici le tressaillement des lèvres, là l'éclat d'un regard, et qui entraînent une matière plus ou moins rebelle au contour : ce sont des traits de visagéité. Heinrich Wölfflin a théorisé ces différences dans Les principes fondamentaux de l'art, les traits de visagéification étant majoritaires dans l'art classique et ceux de visagéité majoritaires dans l'art baroque.
Le visage réfléchit la lumière, réduction de l'espace
par abstraction, compression du lieu par artificialité, qui définit
un champ opératoire et nous conduit de l'univers enter à un
pur visage de femme. Entre le blanc du voile et le blanc du fond, le visage
peut perdre de son contour au profit d'un flou, d'un bougé. On atteint
non plus à la lutte de la lumière avec les ténèbres
comme dans l'expressionnisme mais à l'aventure de la lumière
avec le blanc. Claude Ollier montre que plus l'espace blanc est clos et exigu,
plus il est précaire, ouvert aux virtualités du dehors. Comme
il est dit dans Shanghai gesture, "tout peut arriver à n'importe
quel moment. Tout est possible. L'affect est fait de ces deux éléments
: la ferme qualification d'un espace blanc mais aussi l'intense potentialité
de ce qui va s'y passer. Pour Sternberg, les ténèbres n'existent
pas par elles-mêmes : elles marquent seulement l'endroit où la
lumière s'arrête.(p. 132-135)
(p. 136)
Comme Balazs le montrait, le gros plan n'arrache nullement son objet à
un ensemble dont il ferait partie, dont il serait une partie, mais, ce qui
est tout à fait différent, il l'abstrait de toutes coordonnées
spatio-temporelles, c'est-à-dire il l'élève à
l'état d'entité. Le gros plan n'est pas un grossissement et,
s'il implique un changement de dimension, c'est un changement absolu. Mutation
du mouvement, qui cesse d'être une translation pour devenir expression.
C'est ce qu'Epstein suggérait quand il disait : ce visage d'un lâche
en train de fuir, dès que nous le voyons en gros plan, nous voyons
la lâcheté en personne, le "sentiment-chose", l'entité.
Et quand Eisenstein critiquait les autres, Griffith ou Dovjenko, il leur reprochait
de rater parfois leurs gros plans, parce qu'ils les laissaient connotés
aux coordonnées spatio-temporelles d'un lieu, d'un moment, sans atteindre
à ce qu'il appelait lui-même l'élément "pathétique",
appréhendé dans l'extase ou dans l'affect
Deleuze propose de dénommer icône, non seulement le gros plan de visage déterritorialisé mais aussi certains insert d'objet ou très gros plans de visage lorsque le gros plan garde le pouvoir d'arracher l'image aux coordonnées spatio-temporelles pour faire surgir l'affect en tant qu'exprimé. Même le lieu présent dans le fond perd ses coordonnées et devient "espace quelconque" (ce qui limite l'objection d'Eisenstein). Un trait de visagéité n'est pas moins un gros plan complet qu'un visage entier. C'est seulement un autre pôle du visage, et un trait exprime autant d'intensité que le visage entier exprime de qualité. Si bien qu'il n'y a nullement à distinguer les gros plans et les très gros plans ou inserts, qui ne montreraient qu'une partie du visage. Dans de nombreux cas, il n'y a pas davantage à distinguer entre plans rapprochés, américains et gros plans. Et pourquoi une partie de corps, du menton, de l'estomac ou du ventre, serait-elle plus partielle, plus spatio-temporelle et moins expressive qu'un trait de visagéité intensif ou un visage entier réflexif ? Ainsi la série des gras koulaks dans La ligne générale d'Eisenstein. Et pourquoi l'expression n'arriverait-elle pas aux choses ? Il y a des affects de choses. Le tranchant, le coupant ou plutôt le transperçant du couteau de Jack l'éventreur n'est pas moins un affect que la frayeur qui emporte ses traits et la résignation qui s'empare finalement de tout son visage.
Bergman a poussé le plus loin le nihilisme du visage c'est-à-dire son rapport avec la peur du vide ou l'absence, la peur du visage face à son néant. Dans toute une partie de son œuvre, Bergman consume et éteint le visage, il brûle l'icône. (Balazs, le cinéma, Payot, p.57. Epstein, Ecrits I, Seghers p. 146-147. )
chapitre 7 : L'image affection : qualités, puissances,
espaces ![]()
Espace quelconque : Des espaces déconnectés à forte valeur affective par exemple dans le cinéma expérimental. Défaire l'espace en fonction d'un visage qui s'abstrait des coordonnées spatio-temporelles. Un espace qui se définit par des parties dont le raccordement et l'orientation ne sont pas déterminés d'avance et peuvent se faire d'une infinité de manière. Il n'a plus de coordonnées, c'est un pur potentiel.
Trois grandes façons d'extraire un espace quelconque d'un état de choses donné, d'un espace déterminé.
Le premier moyen fut l'ombre, les ombres. Dans l'expressionnisme, ténèbres et la lumière, le fond noir opaque et le principe lumineux s'accouplent et donnent à l'espace une forte profondeur, une perspective accusée et déformée qui vont être remplies d'ombres, soit sous la forme de tous les degrés du clair-obscur, soit sous la forme des stries alternantes et contrastées ; Ombre et lumière luttent comme l'esprit contre les ténèbres
L'abstraction lyrique rapport de la lumière avec le blanc. L'ombre ne s'oppose pas à la lumière mais offre une alternative un ou bien ou bien. Ainsi Jacques Tourneur rompt avec la tradition gothique du film de terreur ; ses espaces pâles et lumineux, ses nuits sur fond clair. Dans la piscine de La féline, l'attaque ne se voit que sur les ombres du mur blanc : est-ce la femme qui est devenue léopard (conjonction virtuelle) ou bien seulement le léopard qui s'est échappé (connexion réelle) ? Et dans Vaudou est-ce une morte vivante au service de la prêtresse, ou une pauvre fille influencée par la missionnaire ? L'esprit n'est pas pris dans un combat, mais en proie à une alternative. Cette alternative peut se présenter sous une forme esthétique ou passionnelle (Sternberg), éthique (Dreyer) ou religieuse (Bresson), ou même jouer entre ces différentes formes. Par exemple chez Sternberg, le choix que l'héroïne doit faire entre une androgyne blanche ou scintillante, glacée et une femme amoureuse ou même conjugale, peut n'apparaître explicitement qu'en certaines occasions (Morroco, Blonde Vénus, Shanghai express), il n'en est pas moins présent dans toute l'œuvre : L'impératrice rouge comporte un seul gros plan partagé d'ombre, et c'est précisément celui où la princesse renonce à l'amour et choisit la froide conquête du pouvoir. Tandis que l'héroïne de Blonde Vénus renonce au contraire au smoking blanc pour retrouver l'amour conjugal et maternel
Chez Dreyer, la passion apparaissait sur le mode de l'"extatique" et passait par le visage, son exhaustion, son détournement, son affrontement de la limite. Tandis que chez Bresson, elle est en elle-même procès.... C'est la construction d'un espace morceau par morceau, de valeur tactile où la main finit par prendre la fonction directrice qui lui revient dans Pickpocket, détrônant le visage. La loi de cet espace est "fragmentation" (De la FRAGMENTATION : elle est indispensable si on ne veut pas tomber dans la REPRESENTATION. Voir les êtres et les choses dans leurs parties séparables. Isoler ces parties. Les rendre indépendantes afin de leur donner une nouvelle dépendance, NslC, p.95-96). Les tables et les portes ne sont pas données entières. La chambre de Jeanne et la salle du tribunal, la cellule du condamné à mort, ne sont pas données dans des plans d'ensemble, mais appréhendées successivement suivant des raccords qui en font à chaque fois une réalité fermée, mais à l'infini. D'où le rôle spécial des décadrages. Le monde extérieur lui-même n'apparaît donc pas différent d'une cellule, telle la forêt aquarium de Lancelot du lac. C'est comme si l'esprit se heurtait à chaque partie comme à un angle fermé, mais jouissant d'une liberté manuelle dans le raccordement des parties.
L'espace n'est plus tel ou tel espace déterminé, il est devenu espace quelconque, suivant un terme de Pascal Augé. Certes, Bresson n'invente pas les espaces quelconques, bien qu'il en construise pour son compte à sa manière. Augé préférait en chercher la source dans le cinéma expérimental. Mais on pourrait dire également qu'ils sont aussi vieux que le cinéma. Un espace quelconque n'est pas un universel abstrait, en tout temps, en tout lieu. C'est un espace parfaitement singulier, qui a seulement perdu son homogénéité, c'est-à-dire le principe de ses rapports métriques ou la connexion de ses propres parties, si bien que les raccordements peuvent se faire d'une infinité de façons.
Nous disons maintenant qu'il y a deux sortes d'image-affection, ou deux figures de la priméité : d'une part la qualité puissance exprimée par un visage ou un équivalent; mais d'autre part la qualité-puissance exposée dans un espace quelconque. Et peut-être la seconde est-elle plus fine que la première, plus apte à dégager la naissance, le cheminement et la propagation de l'affect (...) Dès que nous quittons le visage et le gros plan, dès que nous considérons des plans complexes qui débordent la distinction trop simple entre gros plan, plan moyen et plan d'ensemble, il semble que nous entrions dans un "système des émotions" beaucoup plus subtil et différencié, moins facile à identifier, propre à induire des affects non humains.
Si l'on se réfère aux termes de Pierce, on désignera comme suit les deux signes de l'image-affection : Icône, pour l'expression d'une qualité-puissance par un visage, Qualisigne (ou Potisigne) pour sa présentation dans un espace quelconque. Certains films de Jorge Ivens nous donnent une idée de ce qu'est un qualisigne : "La pluie n'est pas une pluie déterminée, concrète, tombée quelque part. Ces impressions visuelles ne sont pas unifiées par des représentations spatiales ou temporelles. Ce qui est épié ici avec la sensibilité la plus délicate, ce n'est pas ce qu'est réellement la pluie, mais la façon dont elle apparaît quand, silencieuse et continue, elle s'égoutte de feuille en feuille, quand le miroir de l'étang a la chair de poule, quand une goutte solitaire cherche en hésitant son chemin sur la vitre, quand la vie d'une grande ville se reflète sur l'asphalte mouillé... Et même lorsqu'il s'agit d'un objet unique, comme le pont d'acier de Rotterdam, cette construction métallique se dissout en images immatérielles, cadrées de mille manières différentes... (Balazs, Le cinéma, Payot)". Ce n'est pas un concept de pont, mais ce n'est pas non plus l'état des choses individué défini par sa forme, sa matière métallique, ses usages et ses fonctions. C'est une potentialité. Le montage rapide des sept cents plans fait que les vues différentes peuvent se raccorder d'une infinité de manières et, n'étant pas orientés les unes par rapport aux autres, constituent l'ensemble des singularités qui se conjuguent dans l'espace quelconque où ce pont apparaît comme une pure qualité, ce métal une pure puissance, Rotterdam elle-même comme un affect. Et La pluie n'est pas davantage le concept de pluie, ni l'état d'un temps et d'un état pluvieux. c'est un ensemble de singularités qui présente la pluie telle qu'elle est en soi, pure puissance ou qualité qui conjugue sans abstraction toutes les pluies possibles et compose l'espace quelconque correspondant. C'est la pluie comme affect, et rien ne s'oppose davantage à une idée abstraite et générale bien qu'elle ne soit pas actualisée dans un état de chose individuel
Il y a les hommes blancs de Dieu, du Bien et de la Vertu, les dévots de Pascal, tyranniques, hypocrites peut-être, gardiens de l'ordre au nom d'une nécessité morale ou religieuse. Il y a les hommes gris de l'incertitude (Le Lancelot de Bresson ou même Pickpocket dont le titre prévu était précisément Incertitude. Il y a les créatures du mal, nombreuses chez Bresson (la vengeance d'Hélène dans Les dames du Bois de Boulogne, la méchanceté de Gérard dans Au hasard Balthazar, les vols du Pickpocket, les crimes d'Yvon dans L'argent). Et dans son extrême jansénisme, Bresson montre la même infamie du côtés des œuvres, c'est-à-dire du côté du mal et du bien : dans L'argent, le dévot Lucien n'exercera la charité qu'en fonction du faux témoignage et du vol qu'il s'est donné comme condition, tandis qu'Yvon ne se lance dans le crime qu'à partir de la condition de l'autre. Mais pourquoi n'y aurait-il pas plutôt qu'un choix du mal, qui serait encore désir, un choix pour le mal en toute connaissance de cause ? La réponse de Bresson est la même que celle du Méphisto de Goethe ; nous autres, diables ou vampires, nous sommes libres pour le premier acte mais déjà esclaves pour le second. C'est ce que dit (moins bien) le bon sens, tout comme le commissaire de Pickpocket : "On ne s'arrête pas", vous avez choisi une situation qui ne vous permet déjà plus de choisir. C'est en ce sens que les trois types de personnages précédents font partie du faux choix, de ce choix qui ne se fait qu'à condition de nier qu'il y ait le choix (ou qu'il y a encore le choix). On comprend du coup, du point de vue de l'abstraction lyrique, ce qu'est le choix, la conscience du choix comme ferme détermination spirituelle. Ce n'est pas le choix du bien pas plus que du mal; c'est un choix qui ne se définit pas par ce qu'il choisit, mais par la puissance qu'il possède de pouvoir recommencer à chaque instant, se recommencer soi-même, et se confirmer ainsi par soi-même. Le personnage du vrai choix s'est trouvé dans le sacrifice ou retrouvé par-delà le sacrifice qui ne cesse d'être recommencement : chez Bresson c'est Jeanne d'arc, c'est Le condamné à mort, c'est Le curé de campagne.... Et Bresson ajoute encore un cinquième type de personnage: la bête ou l'Ane dans Au hasard Balthazar. Ayant l'innocence de celui qui n'est pas en état de choisir, l'âne ne connait que l'effet des non-choix ou les choix de l'homme, c'est-à-dire la face des évènements qui s'accomplit dans les corps et les meurtrit, sans pouvoir atteindre (mais sans pouvoir trahir non plus) la part de ce qui déborde l'accomplissement, ou la détermination spirituelle. Ainsi l'âne est l'objet préféré de la méchanceté des hommes, mais aussi l'union préférentielle du Christ ou de l'homme du choix.
L'espace-couleur du colorisme. Minnelli avait fait de l'absorption la puissance proprement cinématographique. D'où, chez lui, le rôle du rêve : le rêve n'est que la forme absorbante de la couleur. D'où chez lui le rôle du rêve : le rêve n'est que la forme absorbante de la couleur. Son œuvre, de comédie musicale mais aussi de tout autre genre, allait poursuivre le thème lancinant de personnages littéralement absorbés par leur rêve (Yolanda, La pirate, Gigi, Melinda), et surtout par le rêve d'autrui et le passé d'autrui (les ensorcelés). Et Minnelli atteint au plus haut avec Les quatre cavaliers de l'Apocalypse quand les êtres sont happés par le cauchemar de la guerre. Dans toute son œuvre, le rêve devient espace, mais comme toile d'araignée dont les toiles sont moins faites pour le rêveur lui-même que pour les proies vivantes qu'il attire. Et, si les états de choses deviennent mouvement de monde, si les personnages deviennent figure de danse, c'est inséparable de la splendeur des couleurs, et de leur fonction absorbante presque carnivore, dévorante, destructrice (telle la roulotte jaune vif de The long, long trailer). Il est juste que Minnelli se soit confronté au sujet capable d'exprimer le mieux cette aventure sans retour : l'hésitation, la crainte et le respect avec lesquels Van Gogh s'approche de la couleur, sa découverte et la splendeur de sa création, et sa propre absorption dans ce qu'il crée, l'absorption de son être et de sa raison dans le jaune (La vie passionnée de Vincent Van Gogh)
Pour Bonitzer (Le champ aveugle, cahiers du Cinéma Gallimard) : depuis L'avventura, la grande recherche d'Antonioni, c'est le plan vide, le plan deshabité. A la fin de L'éclipse tous les plans parcourus par le couple sont revus et corrigés par le vide, comme l'indique le titre du film. (…) Antonioni cherche le désert : désert rouge, Zabriski point, Profession reporter (…) [qui] s'achève par un travelling avant sur le champ vide, dans un entrelacs de parcours insignifiants, à la limite du non-figuratif. L'objet du cinéma d'Antonioni, c'est d'arriver au non-figuratif, par une aventure dont le terme est l'éclipse du visage, l'effacement des personnages
Bergman dépassait l'image-action vers l'instance affective du gros
plan ou du visage qu'il confrontait au vide. Mais chez Antonioni, le visage
disparaît en même temps que le personnage et l'action, et l'instance
affective est celle de l'espace quelconque Antonioni pousse à son tour
jusqu'au vide.
Cassavetes qui avait commencé par des films dominés par le visage
et le gros plan (Shadows, Faces) construisait des espaces déconnectés
à forte teneur affective (Le bal des vauriens, La ballade des
sans espoirs). Il passait ainsi d'un type à l'autre de l'image affection.
c'est qu'il s'agissait de défaire l'espace, non moins en fonction d'un
visage qui s'abstrait des coordonnées spatio-temporelles que d'un événement
qui déborde de toute façon son actualisation, soit parce qu'il
tarde ou se dissout soit au contraire parce qu'il surgit trop vite
Dans Gloria, l'héroïne a de longues attentes mais aussi n'a pas le temps de se retourner, ses poursuivants ont déjà là, comme s'ils étaient installés de tout temps, ou plutôt comme si le lieu lui-même avait brusquement changé de coordonnées, n'était plus le même lieu, pourtant au même endroit de l'espace quelconque. Cette fois c'est l'espace vide qui s'est tout à coup rempli (p170). Jean Louis Comolli cahiers du cinéma n°205 à propos de Faces.
Chapitre 8 : De l'affect à l'action : l'image-pulsion.
Voir : naturalisme ![]()
Le cinéma naturaliste occupe une place tout à fait à part dans le cinéma. Il n'appartient pas au cinéma réaliste avec ses trois types d'images mouvements (perception, action, affection) ni encore au cinéma moderne qui joue sur la rupture des liens sensori-moteurs pour proposer des images mentales. Le cinéma naturaliste propose ce que Deleuze appelle des images-pulsion.
" Le naturalisme prolonge le réalisme dans un surréalisme particulier. Le naturalisme en littérature, c'est essentiellement Zola : c'est lui qui a l'idée de doubler les milieux réels avec des mondes originaires. Dans chacun de ses livres, il décrit un milieu précis, mais aussi il l'épuise et le rend au monde originaire : c'est de cette source supérieure que vient sa force de description réaliste. Le milieu réel, actuel, est le médium d'un monde qui se définit par un commencement radical, une fin absolue, une ligne de plus grande pente.
L'essentiel du naturalisme est dans l'image pulsion. Les pulsions sont souvent relativement simples, comme la pulsion de faim, les pulsions élémentaires, les pulsions sexuelles ou même la pulsion d'or dans Les rapaces. Elles sont inséparables des comportements pervers qu'elles produisent : cannibalisme, sadomasochisme, nécrophilie.
L'image naturaliste, l'image pulsion, a deux signes : les symptômes et les fétiches. Les symptômes sont la présence des mondes originaires dans le monde dérivé, et les fétiches, la représentation des morceaux arrachés au monde dérivé.
Les symptômes : la présence du monde originaire dans le monde dérivé.
Le naturalisme a eu deux grands créateurs au cinéma : Stroheim et Bunuel. Chez eux, l'invention des mondes originaires peut apparaître sous des formes localisées très diverses, artificielles ou naturelles : Chez Stroheim le sommet de la montagne de Maris aveugles, la cabane de sorcière de Folies de femmes, le palais de Queen Kelly, le marais de l'épisode africain du même film, le désert à la fin des rapaces ; chez Bunuel, la rocaille de L'âge d'or, la jungle de studio dans La mort en ce jardin le salon de L'ange exterminateur.
Même localisé, le monde originaire n'en est pas moins le lieu débordant où se passe tout le film, c'est-à-dire le monde qui se révèle au fond des milieux sociaux si puissamment décrits. Le monde originaire est un commencement du monde, mais aussi une fin du monde, et la pente irrésistible de l'un à l'autre : c'est lui qui entraîne le milieu, et aussi qui en fait un milieu fermé, absolument clos, ou bien l'entrouvre sur un espoir incertain.
Le dépôt d'ordures où le cadavre sera lancé, telle est l'image commune de Folies de femmes et de Los olvidados. Les milieux ne cessent de sortir du monde originaire, et d'y entrer ; et ils n'en sortent qu'à peine comme des ébauches déjà condamnées, déjà brouillées, pour y entrer plus définitivement, s'ils ne reçoivent un salut qui ne peut venir lui-même que d'un retour à l'origine.
La latitude zéro, c'est aussi le lieu primordial de L'Ange exterminateur qui s'incarnait d'abord dans un salon bourgeois mystérieusement clos, puis à peine le salon rouvert, se rétablit dans la cathédrale ou les survivants sont à nouveau réunis. C'est le lieu primordial du Charme discret de la bourgeoisie qui se reconstitue dans tous les lieux dérivés successifs pour empêcher l'avènement qu'on y attend. C'était déjà la matrice de L'Age d'or qui scandait tous les développements de l'humanité et les réabsorbait à peine en étaient-ils sortis.
Les fétiches : les morceaux arrachés au monde dérivé
La pulsion est un acte qui arrache, déchire, désarticule : le fétiche est un gros plan objet. Le fétiche c'est l'objet de la pulsion, c'est-à-dire le morceau qui à la fois appartient au monde originaire et est arraché à l'objet réel du milieu dérivé. C'est toujours un objet partiel, quartier de viande, pièce crue, déchet, culotte de femme, chaussure. La chaussure comme fétiche sexuel donne lieu à une confrontation Stroheim-Bunuel particulièrement dans La veuve joyeuse de l'un et Le journal d'une femme de chambre de l'autre.
La perversion n'est pas une déviation mais une dérivation, expression normale de la pulsion dans le milieu dérivé. C'est un rapport constant du prédateur à la proie. L'infirme est la proie par excellence, puisqu'on ne sait plus qui est morceau chez lui, la partie qui manque ou le reste de son corps. Mais il est prédateur aussi, et l'inassouvissement de la pulsion, la faim des pauvres, n'est pas moins morcelant que l'assouvissement des riches. La reine de Queen Kelly fouille dans la boîte de chocolats comme un mendiant dans une poubelle
Le destin de la pulsion c'est de s'emparer avec ruse, mais violemment de tout ce qu'elle peut dans un milieu donné, et, si elle peut de passer d'un milieu dans un autre. Une scène des Maîtresses de Dracula de Terence Fisher montre le vampire à la recherche de la victime qu'il a choisie mais qui, ne la trouvant pas, se contente d'une autre : car la pulsion de sang doit être assouvie
Dans Folies de femmes de Stroheim, le héros séducteur passe de la femme de chambre à la femme du monde pour finir par la débile infirme, poussé par la force élémentaire d'une pulsion prédatrice qui lui fait explorer tous les milieux et arracher ce que chacun présente. L'épuisement complet d'un milieu, mère serviteur, fils et père, c'est aussi ce que fait la Susana de Bunuel. Il faut que la pulsion soit exhaustive. Les joies de la pulsion ne se mesurent pas à l'affect, c'est-à-dire à des qualités intrinsèques de l'objet possible
Chez les pauvres ou chez les riches, les pulsions ont le même but et le même destin : mettre en morceaux, arracher les morceaux, accumuler les déchets, constituer le grand champ d'ordures et se réunir toutes dans une seule et même pulsion de mort. Mort, mort, la pulsion de la mort, le naturalisme en est saturé
Le naturalisme renvoie ainsi simultanément à quatre cordonnées : monde originaire - milieu dérivé, pulsions - comportement. Imaginez une œuvre où le milieu dérivé et le monde originaire sont réellement distincts et bien séparés : même s'ils ont toutes sortes de correspondance ce n'est pas une œuvre naturaliste (Pier Paolo Pasolini).
Nicholas Ray (...) appartient à l'abstraction lyrique (...) La violence est comme dépassée: ce que les personnages ont conquis, c'est le niveau d'abstraction et de sérénité, la détermination spirituelle qui leur permet de choisir nécessairement le côté qui leur permet de renouveler, de recréer sans cesse le même choix, tout en acceptant le monde. Ce que cherchait déjà le couple de Johnny Guitar ou celui d'A l'ombre des potences et qu'ils commençaient à obtenir, le couple de Traquenard finira par l'accomplir pleinement : cette recréation d'un lien choisi qui retomberait autrement dans les ténèbres. En tous ces sens, l'abstraction lyrique apparaît bien comme l'élément pur que Ray n'a cessé de vouloir atteindre : même dans ses premiers films où la nuit a tant d'importance, la vie nocturne de héros n'est qu'une conséquence, et le jeune homme ne se réfugie dans l'ombre que par réaction. La maison dans l'ombre qui abrite la jeune fille aveugle et l'assassin irresponsable est comme l'envers du blanc paysage de neige qu'une foule ténébreuse de lyncheurs vient noircir.
Il n'en fallut pas moins à Ray une lente évolution pour maîtriser cet élément de l'abstraction lyrique. Ses premiers films, il les fit dans le modèle américain de l'image action qui le rapprochait de Kazan : la violence du jeune homme est une violence agie, une violence de réaction contre le milieu, contre la société, contre le père, contre la misère et l'injustice, contre la solitude. Le jeune homme veut violemment devenir un homme, mais c'est cette violence même qui ne lui donne pour choix que de mourir ou de rester enfant, d'autant plus enfant que violent (c'est encore le thème de La fureur de vivre bien que le héros semble y réussir son pari, devenir un homme en une seule journée, mais trop vite pour en être apaisé).
Or une seconde période, dont beaucoup d'éléments étaient en germe dans la première, va modifier profondément l'image de la violence et de la vitesse. Elles cessent d'être une réaction liée à une situation, elles deviennent intérieures et naturelles au personnage, innées : on dirait que le révolté a choisi, non pas exactement le mal, mais "pour" le mal et qu'il atteint à une sorte de beauté par et dans une convulsion permanente. Ce n'est plus une violence agie mais comprimée, d'où sortent seulement des actes courts, efficaces et précis, souvent atroces qui témoignent d'une pulsion brute. Avec Traquenard, elle s'exprime dans la vie et la mort du gangster ami, mais aussi dans l'amour exaspéré du couple, dans l'intensité de la danse de la femme. Et c'est surtout la nouvelle violence de La forêt interdite, qui fait de ce film le chef d'œuvre du naturalisme : le monde originaire, le marais des Everglades, ses verts lumineux, ses grands oiseaux blancs, l'Homme aux pulsions qui veut "tirer en plein dans la figure de Dieu", sa bande de "frères de Caïn, tueurs d'oiseaux et leur ivresse répond à la tempête et à l'orage. Mais déjà ces images doivent être dépassées, déjà le pari porte sur la sortie du marais, quitte à mourir, en découvrant la possibilité d'une acceptation, d'une réconciliation. Enfin, la violence surmontée, la sérénité acquise vient constituer la force ultime d'un choix qui se choisit lui-même et ne cesse de recommencer, réunissant dans une dernière période tous les éléments de l'abstraction lyrique que le réalisme de la première et le naturalisme de la seconde avaient lentement élaborés.
Joseph Losey : pulsion d'avilissement. Joseph Losey est le troisième grand auteur naturaliste, à l'égal de Stroheim et de Bunuel. Ce qui apparaît d'abord chez Losey, c'est une violence très particulière qui imprègne ou emplit les personnages et qui précède toute action (un acteur comme Stanley Becker semble doué de cette violence qui le prédestine à Losey). C'est le contraire de la violence d'action, réaliste. C'est une violence en acte, avant d'entrer en action ; c'est une violence non seulement intérieure ou innée, mais statique, dont on ne trouve d'équivalent que chez bacon en peinture, lorsqu'il évoque une émanation" qui se dégage d'un personnage immobile, ou chez Jean Genet en littérature, quand il décrit l'extraordinaire violence qui peut habiter une main immobile au repos. Temps sans pitié présente un jeune accusé, dont on nous dit qu'il est non seulement innocent, mais doux et affectueux ; et pourtant le spectateur tremble, autant que le personnage tremble lui-même de violence, tremble sous sa propre violence contenue.
En second lieu, cette violence originaire, cette violence de la pulsion, va pénétrer de part en part un milieu donné, un milieu dérivé qu'elle épuise littéralement suivant un long processus de dégradation. Losey aime à choisir à cet égard un milieu "victorien", cité ou maison victoriennes où le drame se passe, et où les escaliers prennent une importance essentielle en tant qu'ils dessinent une ligne de plus grande pente. La pulsion fouille le milieu, et en connaît d'assouvissement qu'en s'emparant de ce qui semble lui être fermé et d'appartenir en droit à un autre milieu, à un niveau supérieur.
D'où la perversion chez Losey, qui consiste à la fois dans cette propagation de la dégradation, et dans l'élection, ou le choix du "morceau" le plus difficile à atteindre. The servant témoigne de cet investissement du maître et de la maison par le domestique. C'est un monde de prédateurs : Cérémonie secrète fait précisément affronter plusieurs types de prédateurs, le fauve, les deux rapaces, et l'hyène, humble, affectueuse et vengeresse. Le messager multiplie ces processus, puisque non seulement le fermier s'empare de la fille du château mais les deux amants s'emparent de l'enfant, contraint et fasciné, le pétrifiant dans son rôle de go-between, exerçant sur lui un étrange viol qui redouble leur plaisir.
Les personnages de Losey ne sont pas de faux durs, mais de faux faibles : ils sont condamnés d'avance par la violence qui les habite, et qui les pousse à aller jusqu'au bout d'un milieu que la pulsion explore, mais au prix de les faire disparaître eux-mêmes avec leur milieu. Plus encore que tout autre film de Losey, M. Klein est l'exemple d'un tel devenir qui nous tend les pièges des interprétations psychologiques ou psychanalytiques.
M. Klein est bien ce comprimé de violence qu'on retrouve toujours chez Losey. La violence des pulsions qui l'habite l'entraîne dans le plus étrange devenir : pris pour un juif, confondu avec un juif sous l'occupation nazi, il commence par protester, et met toute sa sombre violence dans une enquête où il veut dénoncer l'injustice de cette assimilation. Mais ce n'est pas au nom du droit, ou d'une prise de conscience d'une justice plus fondamentale, c'est au seul nom de la violence qui est en lui qu'il va peu à peu faire cette découverte décisive : même s'il était juif, toutes ses pulsions s'opposeraient encore à la violence dérivée d'un ordre qui n'est pas le sien, mais qui est l'ordre social d'un régime dominant. Si bien que le personnage se met à assumer cet état de juif qu'il n'est pas, et consent à sa propre disparition dans la masse des juifs entraînés vers la mort. C'est exactement le devenir juif d'un non-juif. (C'est aussi le thème d'un des meilleurs romans d'Arthur Miller, Focus, ed. de Minuit : un Américain moyen pris à tort pour un juif, persécuté par le K.K. K., abandonné par sa femme et ses amis, commence par protester, essayer de prouver qu'il est un pur aryen; puis prend progressivement conscience que ces persécutions ne seraient pas moins odieuses s'il était réellement juif, et finit par se confondre volontairement avec le juif qu'il n'est pas).
On a beaucoup commenté dans M. Klein, le rôle du double et du cheminement de l'enquête. Ces thèmes semblent secondaires et subordonnés à l'image-pulsion, c'est-à-dire à cette violence statique du personnage qui n'a pour issue dans le milieu dérivé qu'un retournement contre soi, un devenir qui le mène à la disparition comme à l'assomption la plus bouleversante.
Inséparables des milieux dérivés, les mondes originaires
ont des traits particuliers qui appartiennent à son style. Ce sont
des espaces qui appartiennent aux actes et gestes de la pulsion. Le monde originaire
communique avec les milieux dérivés, à la fois comme
prédateur qui y choisit ses proies, et comme parasite qui en précipite
la dégradation. Le milieu c'est la maison victorienne et le monde originaire,
c'est la région sauvage qui la surplombe ou qui l'entoure. Les mondes
originaires peuvent aussi être surplombants : la haute terrasse de Boom
et surtout la falaise des Damnés. Les falaises de Portland,
leur paysage primitif et leurs installations militaires, leurs enfants mutants
radio-actifs, les grandes figures d'oiseaux et d'hélicoptères,
les sculptures, le gang à moto dont les guidons sont comme des ailes
sont les figures du monde originaire qui conduisent à des actions perverses
dans le monde dérivé du "le minable style victorien de
la petite station balnéaire de Weymouth". Ils sont parfois détachés
horizontalement des milieux dérivés sous forme de labyrinthes,
la Venise de Eva une péninsule qui ressemble à une extrémité
du monde, le Norfolk du messager,
le jardin à l'italienne pour Don Giovanni, le parc désaffecté
où le héros de Temps sans pitié a installé
son entreprise de circuit automobiles, un simple square de gravier comme dans
The servant, un terrain de cricket et bien sûr les tunnels de
M. Klein notamment ceux
du vélodrome d'hiver.
Marco Ferreri : évoque aussi un monde originaire au sein de milieux réalistes : l'immense cadavre de King Kong sur le campus du grand ensemble de Rêve de singe. L'irrésistible pulsion de souffler dans un ballon de Break-up
Visconti : Ossessione et L'innocent. Atteindre à des pulsions brutes primordiales mais Visconti est trop aristocratique pour être vraiment naturaliste.
Renoir : Nana, Le journal d'une femme de chambre, La Bête humaine. Atténuation du naturalisme par le détachement que constituent la scène de théâtre ou l'eau mouvante qui mettent à distance les mondes originaires.
Fuller : Indécente brutalité assez irréaliste. Mais pulsions insérées au sein d'images-action qui actualisent milieux et comportements pour s'adapter au grand moule du réalisme américain.
Le cinéma américain peut atteindre le naturalisme par ses actrices. Ava Gardner aux prises avec des pulsions qui l'entraînent irrésistiblement à s'unir à l'homme mort ou impuissant (Pandora, La comtesse aux pieds nus, Le soleil se lève aussi de Henry King) ou Jennifer Jones dans Ruby Gentry (King Vidor) elle est la fille des marais qui poursuit sa vengeance et achève de détruire le milieu déjà épuisé de la ville et des hommes, faisant que le marais retourne au marais et dans Duel au soleil, elle finit dans le sang, les rochers et la poussière.
L'image temps : p190
Chapitre 9 : l'image-action. Voir : John Ford ![]()
Le réalisme c'est l'image action qui règle les rapports entre des milieux qui actualisent et des comportements qui incarnent. Il n'exclut ni la fiction ni le rêve, il peut comprendre le fantastique, l'extraordinaire, l'héroïque et surtout le mélodrame. C'est ce modèle qui fit le triomphe universel du cinéma américain.
Le milieu actualise toujours plusieurs qualités et puissances. Il en opère une synthèse globale, il est lui-même l'Ambiance ou l'Englobant. Le milieu et ses forces s'incurvent, ils agissent sur le personnage, lui lancent un défi, et constituent une situation dans laquelle il est pris. Le personnage réagit à son tour (action proprement dite) de manière à répondre à la situation, à modifier le milieu ou son rapport au milieu avec la situation avec d'autres personnages. Il en sort une situation modifiée ou restaurée, une nouvelle situation. Selon la classification des images de Pierce, c'est le règne de la secondéité, là où tout est deux. L'action en elle-même est un duel de forces, une série de duels, duel avec le milieu, avec les autres, avec soi. Enfin la nouvelle situation qui sort de l'action forme un couple avec la situation de départ : S-A-S'.
Le synsigne c'est un ensemble de qualités-puissances en tant qu'actualisées dans un milieu, dans un état des choses ou un espace temps déterminé. L'englobant ultime est le ciel, chez Ford ou chez Hawks qui fait dire à l'un des personnages de La captive aux yeux clairs ; "C'est un grand pays, la seule chose encore plus grande est le ciel". Englobé par le ciel, le milieu englobe à son tour la collectivité
Le binôme désigne tout duel, c'est-à-dire ce qui est proprement actif dans l'image action. Les feintes, les parades, les pièges sont des binômes exemplaires
Synsigne et binômes marquent les grands genres de l'image action : le documentaire, le film social, le film noir, le western.
Dans les documentaires de Flaherty, l'homme découvre la noblesse de situations extrêmes dans lesquelles il doit faire face à des défis et Flaherty saisit sur le vif le tête-à-tête avec le milieu. Nanouk commence par l'exposition du milieu quand l'Eskimo aborde avec sa famille. Immense synsigne du ciel opaque et des côtes de glace, où Nanouk assure sa survie dans un milieu si hostile ; duel avec la glace pour construire l'igloo, et surtout célèbre duel avec le phoque.
Les films sociaux sont de grandes synthèses globales allant de la collectivité à l'individu et de l'individu à la collectivité dont les films de King Vidor sont un modèle. Loin d'exclure le rêve cette forme réaliste comprend les deux pôles du rêve américain : d'une part l'idée d'une communauté unanimiste ou d'une nation milieu, creuset et fusion de toutes les minorités (l'éclat de rire unanimiste à la fin de La foule, ou la même expression qui se forme sur le visage d'un jaune, d'un Noir, d'un blanc dans Street Scene) ; d'autre part l'idée d'un chef, c'est-à-dire d'un homme de cette nation qui sait répondre aux défis du milieu comme aux difficultés d'une situation (Notre pain quotidien, An american romance).
Mais l'unanimité peut être fausse, et l'individu livré à lui-même. N'était-ce pas précisément le cas de La foule où la ville n'était qu'une collectivité humaine, artificielle et indifférente et l'individu un être abandonné, privé de ressources et de réactions ? La figure SAS'', où l'individu modifie la situation, a bien pour envers une situation SAS, telle que l'individu ne sait plus que faire et se retrouve au mieux dans la même situation : le cauchemar américain de La foule. Il peut même arriver que la situation devienne pire et que l'individu tombe plus bas dans la spirale descendante : SAS". C'est souvent le cas du film noir. Le film noir décrit fortement le milieu, expose les situations, se resserre en préparation d'actions et action minutée (le modèle du hold-up par exemple), et débouche enfin sur une nouvelle situation, le plus souvent l'ordre rétabli. Mais justement si les gangsters sont des perdants nés, malgré la puissance de leur milieu et l'efficacité de leurs actions, c'est que quelque chose ronge l'une et l'autre, inversant la spirale à leur détriment. D'une part le "milieu" est une fausse communauté, en fait une jungle où toute alliance est précaire et réversible ; d'autre part les comportements ne sont pas de vraies réponses à des situations mais recèlent une faille ou des fêlures qui les désintègrent. C'est l'histoire de Scarface de Hawks où toutes les fêlures du héros, toutes les petites failles par lesquelles il en fait trop, se réunissent dans une crise abjecte qui l'emporte avec la mort de sa sœur. Ou bien sur un mode différent dans Asphalt jungle de Huston, l'extrême minutie du docteur et la compétence du tueur ne résisteront pas à la trahison d'un comparse, qui libère chez l'un la petite félure érotique, chez l'autre la nostalgie du pays natal, et les conduit tous les deux à l'échec et à la mort.
Le western est le quatrième grand genre de la grande forme de l'image-action. C'est en tant que représentant de la collectivité que le héros devient capable d'une action qui l'égale au milieu, et en rétablit l'ordre accidentellement et périodiquement compromis : il faut les médiations de la communauté et du pays pour constituer un chef et rendre un individu capable d'une si grande action. On reconnaît le monde de Ford, avec les moments collectifs intenses (mariage, fête, danse et chanson), la présence constante du land et l'immanence du ciel. Jean Mitry (Ford, éditions universitaires) a en conclu à un espace fermé chez Ford sans mouvement ni temps réels. Il nous semble plutôt que le mouvement est réel, mais, au lieu de se faire de partie à partie, ou bien par rapport à un tout dont il traduirait le changement, se fait dans un englobant dont il exprime la respiration. Le dehors englobe le dedans, tous deux communiquent, et l'on avance en passant de l'un à l'autre, dans les deux sens, suivant les images de La chevauchée fantastique où l'intérieur de la diligence alterne avec la diligence vue de l'extérieur. On peut aller d'un point connu à un point inconnu, terre promise comme dans Wagonmaster : l'essentiel reste l'Englobant qui les comprend tous deux et qui se dilate à mesure qu'on avance à grand peine, et se contacte quand on s'arrête et se repose. L'originalité de Ford, c'est que seul l'englobant donne la mesure du mouvement, ou le rythme organique. Aussi est-il le creuset des minorités, c'est-à-dire ce qui les réunit, ce qui en révèle les correspondances même quand elles ont l'air de s'opposer, ce qui en montre déjà la fusion pour la naissance d'une nation : tels les trois groupes de persécutés qui se rencontrent dans Wagonmaster, les mormons, les comédiens ambulants, les Indiens.
Tant qu'on en reste à cette première approximation, on est dans une structure SAS devenue cosmique ou épique : en effet le héros devient égal au milieu par l'intermédiaire de la communauté et ne modifie pas le milieu mais en rétablit l'ordre cyclique. Mais dès le début, on a non seulement des westerns épiques mais des westerns tragiques et romanesques avec des cow-boys déjà nostalgiques, solitaires, vieillissants ou même perdants-nés, des indiens réhabilités. Même chez Ford, le héros ne se contente pas de rétablir l'ordre épisodiquement menacé. L'organisation du film, la représentation organique, n'est pas un cercle mais une spirale où la situation d'arrivée diffère de la situation de départ : SAS'. C'est une forme éthique, plutôt qu'épique. Dans L'homme qui tua Liberty Valance, le bandit est tué et l'ordre rétabli. Mais le cow-boy qui l'a tué laisse croire que c'est le futur sénateur, acceptant ainsi la transformation de la loi qui cesse d'être la loi tacite épique de l'Ouest pour devenir la loi écrite ou romanesque de la civilisation industrielle. De même, dans Les deux cavaliers, où cette fois le shérif renonce à son poste et refuse l'évolution de la petite ville. Dans les deux cas, Ford invente un procédé très intéressant, qui est l'image modifiée : une image est montrée deux fois, mais la seconde fois, modifiée ou complétée de manière à faire sentir la différence entre S et S'. Dans Liberty Valance, la fin montre la vraie mort du bandit et le cow-boy qui tire, tandis qu'on avait vu précédemment l'image coupée à laquelle s'en tiendra la version officielle (c'est le futur sénateur qui a tué le bandit). Dans Les deux cavaliers, on nous montre la même silhouette de shérif dans la même attitude mais ce n'est plus le même shérif. Il est vrai que entre les deux S et S', il y a beaucoup d'ambiguité et d'hypocrisie. Le héros de Liberty Valance tient à se laver du crime pour devenir un sénateur respectable, tandis que les journalistes tiennent à lui laisser sa légende, sans laquelle il ne serait rien. Et, comme l'a montré Roy (Pour John Ford, édition du cerf), Les deux cavaliers ont pour sujet la spirale de l'argent qui, dès le début, mine la communauté et ne fera qu'agrandir son empire.
Mais on dira que, dans les deux cas, ce qui compte pour Ford c'est que la communauté puisse se faire sur elle-même des illusions. Ce serait la grande différence entre les milieux sains et les milieux pathogènes. Jack London écrivait de belles pages pour montrer que, finalement, la communauté alcoolique est sans illusion sur elle-même. Loin de faire rêver l'alcool "refuse de laisser rêver le rêveur", il agit comme une raison pure qui nous convainc que la vie est une mascarade, la communauté une jungle, la vie un désespoir (d'où le ricanement de l'alcoolique). On pourrait en dire autant des communautés criminelles. Au contraire une communauté est saine tant que règne une sorte de consensus qui lui permet de se faire des illusions sur elle-même, sur ses motifs, sur ses convoitises, sur ses valeurs et ses idéaux : illusions vitales, illusions réalistes plus vraies que la réalité pure (Jack London, Le cabaret de la dernière chance et Ford "Je crois au rêve américain", Andrew Sinclair John Ford p124). C'est aussi le point de vue de Ford qui dès Le mouchard montrait la dégradation presque expressionniste d'un traître dénonciateur, en tant qu'il ne pouvait se refaire d'illusion. On ne pourra donc pas reprocher au rêve américain de n'être qu'un rêve : c'est ainsi qu'il se veut. La société change et ne cesse de changer, pour Ford comme pour Vidor, mais les changements se font dans un Englobant qui les couvre et les bénit d'une saine illusion comme continuité de la nation.
Le cinéma américain a en commun avec le cinéma soviétique de croire à une finalité de l'histoire universelle, ici l'éclosion de la nation américaine, là-bas l'avènement du prolétariat. Mais chez les Américains, la représentation organique ne connaît évidemment pas de développement dialectique, elle est à elle seule toute l'histoire, la lignée germinale dont chaque nation-civilisation se détache comme un organisme, chacune préfigurant l'Amérique. D'où le caractère profondément analogique ou parralléliste de cette conception de l'histoire, telle qu'on la retrouve dans Intolérance de Griffith qui entremêle quatre périodes ou dans la première version des Dix commandements de Cecil B. De Mille qui met deux périodes en parallèle dont l'Amérique est l'ultime. Les nations décadentes sont des organismes malades, comme la Babylone de Griffith ou la Rome de De Mille. Si la Bible est fondamentale, c'est que les Hébreux, puis les chrétiens font naître des nations civilisations saines qui présentent les deux traits du rêve américain : être un creuset où les minorités se fondent, être un ferment qui forme des chefs capables de réagir à toutes les situations. Inversement le Lincoln de Ford récapitule l'histoire biblique, jugeant aussi parfaitement que Salomon, assurant comme Moïse le passage d'une loi nomade à une loi écrite, entrant dans la cité sur un âne à la manière du Christ.
Il est facile de se moquer des conceptions historiques d'Hollywood. Il nous semble au contraire qu'elle recueille les aspects les plus sérieux de l'histoire vue par le XIXème siècle. Nietzsche (considérations intempestives) distinguait trois de ces aspects, l'histoire monumentale, l'histoire antiquaire et l'histoire critique. L'aspect monumental concerne l'englobant physique et humain, le milieu naturel et architectural. Babylone et sa défaite chez Griffith, les Hébreux, le désert et la mer qui s'ouvre, ou bien les Philistins, le temple de Dagon et sa destruction par Samson chez Cecil B. de Mille sont d'immense synsigne qui font que l'image elle-même est monumentale. Le traitement peut être très différent, en grande fresque comme les Dix commandements ou en série de gravures dans Samson et Dalila l'image reste sublime, et le temple de Dagon peut déclencher notre rire, c'est un rire olympien qui s'empare du spectateur. Suivant l'analyse de Nietzsche un tel aspect de l'histoire favorise les parallèles ou les analogies d'une civilisation à une autre : les grands moments de l'humanité, si distants soient-ils sont censés communiquer par les sommets et constituer "une collection d'effets en soi" qui se laissent d'autant mieux comparer et agissent d'autant plus sur l'esprit du spectateur moderne. L'histoire monumentale tend donc naturellement vers l'universel, et trouve son chef d'œuvre dans Intolérance parce que les différentes périodes ne s'y succèdent pas simplement, mais alternent suivant un montage rythmique extraordinaire (Buster Keaton en donnera une version burlesque dans Les trois ages).
Cette conception de l'histoire a toutefois un grand inconvénient :
traiter les phénomènes comme des effets en soi, séparés
de toute cause. C'est ce que Nietzsche signalait déjà, et c'est
ce qu'Eisenstein critique dans le cinéma historique et social américain.
Non seulement les civilisations sont considérées comme parallèles,
mais les phénomènes principaux d'une même civilisation,
par exemple les riches et les pauvres sont traités comme "deux
phénomènes parallèles indépendants ", comme
de purs effets que l'on constate au besoin avec regret, pourtant sans avoir
de causes à leur assigner. Dès lors il est inévitable
que les causes soient rejetées d'un autre côté, et n'apparaissent
que sous la forme de duels individuels qui opposent tantôt un représentant
des pauvres et un représentant des riches, tantôt un décadent
et un homme de l'avenir, tantôt un juste et un traître, etc..
La force d'Eisenstein est donc de montrer que les principaux aspects techniques
du montage américain depuis Griffith, le montage alterné parallèle
qui compose la situation et le montage alterné concourant qui aboutit
au duel, renvoient à cette conception historique sociale et bourgeoise.
C'est à ce défaut capital qu'Eisenstein veut remédier
: il réclamera une présentation de véritables causes,
qui devra soumettre le monumental à une construction dialectique (de
toute façon la lutte des classes au lieu d'un traître d'un décadent
ou d'un méchant (Eisenstein Film form, Meridian Books).
Si l'histoire monumentale considère les effets pris en soi et ne retient des causes que de simples duels opposant les individus, il faut que l'histoire antiquaire s'occupent de ceux-ci et reconstitue leurs formes habituelles à l'époque : guerre et affrontements, combat de gladiateur, courses de chars, tournois de chevalerie etc. l'antiquaire ne se contente pas des duels au sens strict, il s'étend vers la situation extérieure et se contracte dans les moyens d'action et les usages intimes : vastes tentures, habits, parures, machines, armes ou outils bijoux, objets privés.
Enfin il est vrai que la conception monumentale et la conception antiquaire de l'histoire ne s'uniraient pas si bien sans l'image éthique qui les mesure et les distribue toutes les deux. Il faut que le passé antique ou récent passent en justice, pour révéler quels sont les ferments de la décadence et les germes d'une naissance, l'orgie et le signe de la croix, la toute puissance des riches et la misère des pauvres. Il faut qu'un fort jugement éthique dénonce l'injustice des choses apporte la compassion, annonce la nouvelle civilisation en marche, bref ne cesse de redécouvrir l'Amérique
SS'. Le montage parallèle alterné suffit à organiser
le passage de S à S', la manière dont les Indiens surgissent
en haut d'une colline, à la limite du ciel et de la terre il est souvent
distribué
SA le montage alterné concourant
A montage interdit
Chapitre 10 : l'image-action : la petite forme
![]()
La petite forme de l'image action va d'une action, d'un comportement à une situation partiellement dévoilée
Le signe de composition de cette nouvelle image action c'est l'indice : une action (ou un équivalent d'action, un geste simple) dévoile une situation qui n'était pas donnée. La situation est donc conclue de l'action par inférence ou par raisonnement relativement complexe. Puisque la situation n'est pas donnée pour elle-même, l'indice est ici indice de manque, implique un trou dans le récit et correspond au premier sens du mot "ellipse". Par exemple dans L'opinion publique, Chaplin insistait sur le trou d'une année que rien ne venait combler, mais que l'on concluait du nouveau comportement et de l'habillement de l'héroïne, devenue maîtresse d'un homme riche. L'indice est souvent d'autant plus fort qu'il enveloppe un raisonnement rapide ainsi lorsque la femme de chambre ouvre une commode, et le col d'un homme tombe accidentellement sur le sol, ce qui révèle la liaison d'Edna. Chez Lubitsch on trouve constamment ces raisonnements rapides. Dans Sérénade à trois l'un des deux amants voit l'autre vêtu d'un smoking, au petit matin chez l'aimée commune : il conclut de cet indice (et le spectateur en même temps) que son ami a passé la nuit avec la jeune femme. L'indice consiste donc en ceci qu'un des personnages est "trop" habillé, trop bien habillé d'un costume de soirée, pour ne pas avoir été durant la nuit dans une situation très intime qui n'a pas été montrée. C'est une image-raisonnement.
Il y a un second type d'indice, plus complexe indice d'équivocité. Dans L'opinion publique la scène du collier jeté et rattrapé fait que l'on se demande si Edna n'aime pas d'un amour compréhensif et profond son amant riche. C'est comme si une action, un comportement recelait une petite différence qui suffit pourtant à la renvoyer simultanément à deux situations tout à fait distantes et éloignées. Dans To be or not to be, on se demande quand un spectateur quitte son siège dès que l'acteur commence son monologue c'est parce qu'il en a assez ou parce qu'il a rendez-vous avec la femme de l'acteur ? Une très petite différence dans le geste mais aussi l'énormité de la distance entre deux situations telles qu'une question de vie ou de mort.
Les indices de l'image-situation se retrouvent aussi dans les westerns et le film noir, genres majeurs de l'image-action. Dans L'invraisemblable vérité le héros fabrique de faux indices qui l'accusent d'un crime mais les preuves de la fabrication ayant disparus il se trouve arrêté et condamné ; tout près d'obtenir sa grâce, lors d'une dernière visite à sa fiancée, il se coupe, laisse échapper un indice qui fait comprendre à celle-ci qu'il est coupable et qu'il a vraiment tué. La fabrication de faux indices était une manière efficace d'effacer les vrais, mais aboutissent par une voie détournée à la même situation que les vrais. Aucun autre film ne livre une telle densité d'indices avec une telle mobilité et convertibilité des situations opposées.
Le western enfin pose le même problème dans des conditions particulièrement riches. Malgré sa dette à l'égard de Hawks, le néo western va dans une autre direction (...) Ce n'est plus la loi globale ou intégrale SA (un grand écart qui n'existe que pour être comblé) mais une loi différentielle AS: la plus petite différence qui n'existe que pour être creusée, pour susciter des situations très distantes ou opposables.
En premier lieu les Indiens n'apparaissent plus en haut de la colline et ne se détachant sur le ciel mais jaillissent des hautes herbes dont ils ne se distinguent pas. L'Indien se confond presque derrière le rocher derrière lequel il attend et le cow-boy a quelque chose de minéral qui le confond avec le rocher.
La violence devient l'impulsion principale, et y gagne autant d'intensité que de soudaineté. Non seulement le groupe fondamental a disparu au profit de groupes de rencontre de plus en plus hétéroclites et mélangés, mais ceux-ci en se multipliant, ont perdu la claire distinction qu'ils avaient encore chez Hawks : les hommes dans un même groupe, et d'un groupe à l'autre, ont tant de relations et des alliances si complexes qu'ils se distinguent à peine et que leurs oppositions se déplacent sans cesse (Major Dundee, La horde sauvage de Sam Peckinpah). Entre le poursuivant et le poursuivi, mais aussi entre le Blanc et l'Indien, la différence devient de plus en plus petite : dans L'appât pendant longtemps le chasseur de primes et sa proie ne semblent pas des hommes bien différents ; et dans Little Big Man de Penn, le héros ne cesse d'être blanc avec les Blancs, indien avec les Indiens, franchissant dans les deux sens une frontière minuscule, à l'occasion d'actions peu distinctes. C'est que l'action ne peut jamais être déterminée par une situation préalable ; c'est au contraire la situation qui découle de l'action, au fur et à mesure : Boetticher disait que ses personnages ne se définissent pas par une cause mais par ce qu'ils font pour la défendre. Et Godard quand il analysait la forme chez Anthony Mann dégageait la formule ASA', qu'il opposait à la grande forme SAS' ; la mise en scène consistait à découvrir en même temps qu'à préciser, alors que dans un western classique la mise en scène consiste à découvrir puis à préciser.
La loi de la petite différence ne vaut que si elle induit des situations logiquement très différentes. Pour Little Big Man, la situation change réellement du tout au tout suivant qu'il est poussé du côté des indiens ou du côté des blancs. Et, si l'instant est la différentielle de l'action, c'est à chacun de ces instants que l'action peut basculer, tourner dans une situation tout autre ou opposée. Rien n'est jamais gagné. Les défaillances, les doutes, la peur n'ont donc plus du tout le même sens que dans la représentation organique : ce ne sont plus les étapes même douloureuses qui comblent l'écart, par lesquelles le héros s'élève jusqu'aux exigences de la situation globale, actualise sa propre puissance et devient capable d'une si grande action. Car il n'y a plus du tout d'action grandiose, même si le héros a gardé d'extraordinaires qualités techniques. A la limite, il fait partie des losers tels que les présente Peckinpah : "Ils n'ont aucune façade, il ne leur reste plus qu'une illusion, aussi représentent-ils l'aventure désintéressée, celle dont on ne tire aucun profit, sinon la pure satisfaction de vivre encore". Ils n'ont rien gardé du rêve américain, ils ont seulement gardé la vie, mais, à chaque instant critique, la situation que leur action suscite peut se retourner contre eux, et leur faire perdre cette seule chose qui leur restait. Ici aussi les signes sont des indices ; des indices de manque, dont témoignent les ellipses brutales dans le récit et des indices d'equivocité dont témoignent la possibilité et la réalité de renversements de situation soudain.
C'est dans le burlesque que la forme AS trouve le plein développement
de sa formule, une très petite différence dans l'action ou entre
deux actions aboutit à deux situations très différentes
et n'existe que pour faire valoir cette différence.
Chapitre 11 : Transformation des formes. ![]()
Le monde presque exclusivement masculin de Kurosawa s'oppose à l'univers féminin de Mizoguchi. L'œuvre de Kurosawa appartient à l'image-action, celle où l'action répond par un duel à une situation magnifiée. Mais Kurosawa fait subir à l'image-action un élargissement qui vaut pour une transformation sur place : avant d'agir, il faut connaitre ce qui se cache sous la situation.
La technique et la métaphysique de Kurosawa sont finalement assez proches de la peinture chinoise et japonaise qui invoque les principes du vide primordial et du souffle vital qui imprègne toute chose en un, les réunit en un tout et les transforme suivant le mouvement d'un grand cercle ou d'une spirale organique.
Dilaté ou contracté le grand espace souffle de Kurosawa se comprend mieux si on se rapporte à une topologie japonaise : on ne commence pas par un individu, pour indiquer le numéro, la rue, le quartier, la ville, on part au contraire de l'enceinte, de la ville, et l'on désigne le grand bloc, puis le quartier, enfin l'aire où chercher l'inconnue. On ne va pas d'une inconnue aux données capables de la déterminer. On part de toutes les données, on en descend pour marquer les limites entre lesquelles se tient l'inconnue. C'est une forme Situation-Action très pure : il faut connaître toutes les données avant d'agir et pour agir. Kurosawa dit que le plus difficile, pour lui, c'est "avant que le personnage ne commence à agir : pour en arriver là, il me faut réfléchir pendant plusieurs mois (Kurosawa : Entretien avec Shimizu, Etudes cinématographiques Kurosawa, p. 7)". Mais, justement, ce n'est difficile que parce que cela vaut pour le personnage lui-même : il lui fallait d'abord toutes les données.
C'est pourquoi les films de Kurosawa ont souvent deux parties bien distinctes, l'une qui consiste en une longue exposition, l'autre où l'on commence à agir intensément, brutalement (Chien enragé, Entre le ciel et l'enfer). C'est pourquoi aussi l'espace de Kurosawa peut-être un espace théâtral contracté, où le héros a toutes les données sous les yeux, et ne les quitte pas des yeux pour agir (Le garde du corps). C'est pourquoi enfin l'espace se dilate, et constitue un grand cercle qui joint le monde des riches et le monde des pauvres, le haut et le bas, le ciel et l'enfer ; il faut une exploration des bas-fonds en même temps qu'une exposition des sommets pour dessiner ce cercle de la grande forme, traversé latéralement par un diamètre où se teint et se meurt le héros (Entre le ciel et l'enfer).
Mais s'il n'y avait rien d'autre, Kurosawa serait seulement un auteur éminent qui aurait développé l'image-action, et se laisserait comprendre d'après des critères occidentaux devenus classiques. Son exploration des bas-fonds correspondrait bien au film criminel et misérabiliste ; son grand cercle du monde des pauvres et du monde des riches renverrait à la conception humaniste libérale que Griffith avait su imposer, à la fois comme donnée de l'Univers et comme base de montage (et, en effet cette vision griffithienne existe chez Kurosawa : il y a des riches et des pauvres, et ils devraient se comprendre, s'entendre…). Bref, l'exigence d'une exposition, avant l'action, répondrait tout à fait à la formule SA : de la situation à l'action.
Pourtant, dans le cadre de cette grande forme, Kurosawa témoigne d'une originalité profonde, qu'on peut certainement rattacher à des traditions japonaises, mais qui sont aussi redevables à son génie propre.
Les données dont il faut faire l'exposition complète ne sont en effet pas simplement celles de la situation. Ce sont les données d'une question qui est cachée dans la situation, enveloppée dans la situation, et que le héros doit dégager, pour pouvoir agir, pour pouvoir répondre à la situation.
La réponse n'est donc pas seulement celle de l'action à la situation, mais, plus profondément, une réponse à la question ou au problème que la situation ne suffisait pas à dévoiler. S'il y a une affinité de Kurosawa avec Dostoïevski, elle porte sur ce point précis : chez Dostoïevski, l'urgence d'une situation, si grande soit-elle, est délibérément négligée par le héros, qui veut d'abord chercher qu'elle est la question plus pressante encore. C'est ce que Kurosawa aime dans la littérature russe, la jonction qu'il établit entre Russie-Japon. Il faut arracher à une situation la question qu'elle contient, découvrir les données de la question secrète qui seules, permettent d'y répondre, et sans lesquelles l'action même ne serait pas une réponse.
Chez Mizoguchi tout part du "fond", c'est-à-dire du morceau d'espace réservé aux femmes, "le plus au fond de la maison", avec sa mince charpente et ses voiles. Dans les amants crucifiés, c'est tout un jeu dans les chambres de femmes qui inaugure l'action, c'est-à-dire la fuite de l'épouse. Et certes déjà dans la maison, tout un système de connexions s'exerce grâce aux cloisons coulissantes, amovibles. Mais c'est en rapport avec la rue que s'établit d'abord le problème du raccordement d'un morceau d'espace à un autre ; et, plus généralement, entre deux morceaux d'espace, beaucoup de vides médians interviennent, un personnage ayant déserté le cadre, ou la caméra abandonné le personnage. Un plan définit une aire restreinte, comme la portion visible du lac envahi par le brouillard dans Les contes de la lune vague ; ou bien une colline barre l'horizon, et le paysage d'un plan à un autre exclut le fondu, affirme une contiguïté qui s'oppose à la continuité. On ne parlera pourtant pas d'un espace morcelé, bien qu'il s'agisse d'une séparation constante. Mais chaque scène, chaque plan doivent porter un personnage ou un événement au sommet de son autonomie, de sa présence intensive.
Au-delà du raccordement de proche en proche, le dernier problème est celui d'une connexion généralisée des morceaux d'espace. Quatre procédés concourent à cet effet, qui définissent autant une métaphysique qu'une technique : la position relativement haute de la caméra qui produit un effet de plongée en perspective, assurant le déploiement d'une scène dans une aire restreinte ; le maintien d'un même angle pour des plans contigus, qui produit un effet de glissement recouvrant les coupures ; le principe de distance qui interdit de se rapprocher du personnage au-delà du plan moyen et permet des mouvements circulaires de la caméra, ne neutralisant pas une scène, mais au contraire en tenant et prolongeant l'intensité jusqu'au bout dans l'espace ; enfin et surtout, le plan séquence tel qu'il a été analysé par Noël Burch, dans la fonction particulière qu'il prend chez Mizoguchi, véritable plan-rouleau qui déroule les morceaux successifs d'espace auxquels sont pourtant attachés des vecteurs de direction différente (les plus beaux exemples selon Burch étant dans Les sœurs du Gion et Contes des chrysanthèmes tardifs). Et c'est ce qui nous semble essentiel dans ce que l'on a appelé les mouvements extravagants de caméra chez Mizoguchi : le plan-séquence assure une sorte de parallélisme des vecteurs orientés différemment, et constitue ainsi une connexion des morceaux d'espace hétérogènes, conférant une homogénéité très spéciale à l'espace ainsi constitué. Dans cet allongement ou cet étirement illimité, nous touchons alors à la nature ultime de l'espace de la petite forme. Il est "petit" par son processus : son immensité vient de la connexion des morceaux qui le composent, de la mise en parallèle de vecteurs différents (et qui maintiennent leurs différences), de l'homogénéité qui ne se forme qu'au fur et à mesure. D'où l'intérêt que Mizoguchi, à la fin de sa vie, éprouvait pour le cinémascope, son pressentiment qu'il pourrait en tirer des nouvelles ressources en fonction de sa conception de l'espace.
Pour Mizuguchi, la compréhension de l'Univers passe par les femmes et pourtant le système social réduit les femmes à l'état d'oppression, souvent de prostitution larvée ou manifeste. Les lignes d'univers sont féminines mais l'état social est prostitutionnel.
(1) Kurosawa : Entretien avec Shimizu, Etudes cinématographiques Kurosawa,
p. 7
Chapitre 12 : La crise de l'image action. ![]()
Hitchcock est le cinéaste mental par excellence. Chez Hitchcock, les actions, les affections, tout est interprétation, du début jusqu'à la fin. La corde est fait d'un seul plan pour autant que les images ne sont que les méandres d'un seul et même raisonnement. La raison en est simple : dans les films d'Hitchcock une action étant donnée (au présent, au futur ou au passé) va être littéralement entourée par un ensemble de relations qui en font varier le sujet, la nature, le but etc. Ce qui compte, ce n'est pas l'auteur de l'action, ce qu'Hitchcock appelle avec mépris le whodunit ("qui l'a fait ?"), mais ce n'est pas davantage l'action même : C'est l'ensemble des relations dans lesquelles l'action et son auteur sont pris.
D'où le sens très spécial du cadre : les dessins préalables du cadrage, la stricte délimitation du cadre, l'élimination apparente du hors cadre s'expliquent par la référence constante d'Hitchcock, non pas à la peinture ou au théâtre, mais à la tapisserie, c'est-à-dire au tissage. Le cadre est comme les montants qui portent la chaîne des relations, tandis que l'action constitue seulement la trame mobile qui passe par-dessus et par-dessous. On comprend dès lors qu'Hitchcock procède d'habitude par plans courts, autant de plans qu'il y a de cadre, chaque plan montrant une relation ou une variation de la relation. Mais le plan théoriquement unique de La corde n'est nullement une exception à cette règle : très différente du plan-séquence de Welles ou de Dreyer, qui tend de deux manières à subordonner le cadre à un tout, le plan unique de Hitchcock subordonne le tout (des relations) au cadre, se contentant d'ouvrir ce cadre en longueur, à condition de maintenir la fermeture en largeur, exactement comme un tissage qui fabriquerait un tapis infiniment long. L'essentiel de toute façon, c'est que l'action, et aussi la perception et l'affection, soient encadrées dans un tissus de relations. C'est cette chaîne de relations qui constituent l'image mentale, par opposition à la trame des actions, perceptions et affections.
Hitchcock empruntera donc au film policier ou au film d'espionnage une action particulièrement frappante, du type "tuer " ou "voler". Comme elle est engagée dans un ensemble de relations que les personnages ignorent (mais que le spectateur connaît déjà ou découvrira avant), elle n'a que l'apparence d'un duel qui régit toute action : elle est déjà autre chose, puisque la relation constitue la tiercité qui l'élève à l'état d'image mentale. Il ne suffit donc pas de définir le schéma d'Hitchcock en disant qu'un innocent est accusé d'un crime qu'il n'a pas commis ; ce ne serait qu'une erreur de "couplage", une fausse identification du "second". Au contraire, Rohmer et Chabrol ont parfaitement analysé le schéma d'Hitchcock : le criminel a toujours fait son crime pour un autre, le vrai criminel a fait son crime pour l'innocent qui, bon gré mal gré, ne l'est plus. Bref, le crime n'est pas séparable de l'opération par laquelle le criminel a échangé son crime, comme dans L'inconnu du Nord Express, ou même "donné" ou "rendu" son crime à l'innocent comme dans La loi du silence. On ne commet pas un crime chez Hitchcock, on le donne, on le rend ou on l'échange. C'est le point fort du livre de Rohmer et de Chabrol. La relation (l'échange, le don, le rendu...) ne se contente pas d'entourer l'action, elle la pénètre d'avance et de toutes parts, et la transforme en acte nécessairement symbolique.
Il n'y a pas seulement l'actant et l'action, l'assassin et la victime, il y a toujours un tiers, et non pas un tiers accidentel ou apparent comme le serait simplement un innocent soupçonné, mais un tiers fondamental, constitué par la relation elle-même, relation de l'assassin, de la victime ou de l'action avec le tiers apparent. Ce triplement perpétuel s'empare aussi des objets, des perceptions, des affections. C'est chaque image dans son cadre, par son cadre, qui doit être l'exposition d'une relation mentale. Les personnages peuvent agir, percevoir, éprouver mais ils ne peuvent pas témoigner pour les relations qui les déterminent. Ce sont les mouvements de caméra, et leurs mouvements vers la caméra. D'où l'opposition d'Hitchcock à l'Actors Studio, son exigence que l'acteur agisse le plus simplement, soit neutre à la limite, la caméra se chargeant du reste. Ce reste c'est l'essentiel de la relation mentale. C'est la caméra et non pas un dialogue qui explique pourquoi le héros de Fenêtre sur cour a la jambe cassée (photos de la voiture de course dans la chambre, appareil photo brisé). C'est la caméra dans Sabotage qui fait que la femme, l'homme et le couteau n'entrent pas successivement dans une relation de paires, mais dans une véritable relation (tiercité) qui fait que la femme rend son crime à l'homme.
Chez Hitchcock, il n'y a jamais duel ou double : même dans L'ombre d'un doute, les deux Charlie, l'oncle et la nièce, l'assassin et la jeune fille, prennent à témoin un même état du monde qui pour l'un, justifie ses crimes, et, pour l'autre, ne peut être justifié de produire un tel criminel. Et, dans l'histoire du cinéma, Hitchcock apparaît comme celui qui ne conçoit plus la constitution d'un film en fonction de deux termes, le metteur en scène et le film à faire, mais en fonction de trois : le metteur en scène, le film et le public qui doit enter dans le film, ou dont les réactions doivent faire partie intégrante du film (tel est le sens explicite du suspense, puisque le spectateur est le premier à "savoir" les relations).
Parmi beaucoup de commentaires excellents, il n'y a pas lieu de choisir entre ceux qui voient en Hitchcock un penseur profond, ou seulement un grand amuseur. Il n'est pas toutefois nécessaire de faire d'Hitchcock un métaphysicien, platonicien et catholique comme Rohmer et Chabrol ou un psychologue des profondeurs, comme Douchet. Hitchcock a plutôt une compréhension très sûre des relations, théorique et pratique. Ce n'est pas seulement Lewis Caroll, c'est toute la pensée anglaise qui a montré que la théorie des relations était la pièce maîtresse de la logique, et pouvait être à la fois le plus profond et le plus amusant. S'il y a des thèmes chrétiens chez Hitchcock, à commencer par le péché originel, c'est parce que ces thèmes ont posé dès le début le problème de la relation, comme le savent bien les logiciens anglais. Les relations, l'image mentale, c'est ce d'où part Hitchcock à son tour, ce qu'il appelle le postulat ; et c'est à partir de ce postulat de base que le film se développe avec une nécessité mathématique ou absolue malgré les invraisemblances de l'intrigue ou de l'action.
Or si l'on part des relations, qu'est ce qui arrive en fonction de leur extériorité ? Il peut arriver que la relation s'évanouisse disparaisse d'un coup, sans que les personnages changent, mais les laissant dans le vide : si la comédie Mr et Mme Smith appartient à l'œuvre d'Hitchcock, c'est précisément parce que le couple apprend tout d'un coup que son mariage, n'étant pas légal, il n'a jamais été marié. Il peut arriver au contraire que la relation prolifère et se multiplie, selon les termes envisagés et les tiers apparents qui viennent s'y joindre la subdivisant ou l'orientant vers de nouvelles directions (Mais qui a tué Harry ?). Il arrive enfin que la relation passe elle-même par des variations, suivant les variables qui l'effectuent, et entraînant des changements dans un ou plusieurs personnages ; c'est en ce sens que les personanges d'Hitchcock ne sont certes pas des intellectuels, mais ont des sentiments qu'on peut appeler des sentiments intellectuels, plutôt qu'affects et tant qu'ils se modèlent sur un jeu varié de conjonctions vécues, parce que… quoique.. puisque… si… même si… (Agent secret, Les enchaînés, Soupçons) ce qui apparaît dans tous les cas, c'est que la relation introduit entre les personnages, les rôles, les actions, le décor, une instabilité essentielle. Le modèle de cette instabilité, ce sera celle du coupable et de l'innocent. Mais aussi, la vie autonome de la relation va la faire tendre vers une sorte d'équilibre, fût-il désolé, désespéré ou même monstrueux : l'équilibre innocent-coupable, la restitution à chacun de son rôle, la rétribution pour chacun de son action, seront atteints, mais au prix d'une limite qui risque de ronger et même d'effacer l'ensemble. Tel le visage indifférent de l'épouse, devenue folle dans Le faux coupable (…)
Hitchcock introduit l'image mentale au cinéma. c'est-à-dire : il fait de la relation l'objet d'une image, qui non seulement s'ajoute aux images perception, action et affection, mais les encadre et les transforme. Avec Hitchcock, une nouvelle sorte de "figures" apparaissent, qui sont des figures de pensées. En effet l'image mentale exige elle-même des signes particuliers qui ne se confondent pas avec ceux de l'image action. On a souvent remarqué que le détective n'avait q'un rôle médiocre ou secondaire (sauf quand il entre pleinement dans la relation comme dans Blackmail ; et que les indices ont peu d'importance. En revanche, Hitchcock fait naître des signes originaux, suivant les deux types de relations, naturelle et abstraite. Suivant la relation naturelle, un terme renvoie à d'autres termes dans une série coutumière telle que chacun peut être interprété par les autres : ce sont des marques ; mais il est toujours possible qu'un de ces termes saute hors de la trame, et surgisse dans des conditions qui l'extraient de la série ou le mettent en contradiction avec elle, en quel cas on parlera de démarque. Il est donc très important que les termes soient tout à fait ordinaires, pour que l'un d'eux, d'abord, puisse se détacher de la série : comme dit Hitchcock, Les oiseaux doivent être des oiseaux ordinaires. Certaines démarques de Hitchcock sont célèbres, comme le moulin de Correspondant 17 dont les ailes tournent en sens inverse du vent, ou l'avion sulfateur de La mort aux trousses qui apparaît là où il n'y pas de champ à sulfater. De même le verre de lait que sa luminosité rend suspect dans Soupçons ou la clé qui ne s'adapte pas à la serrure dans Le crime était presque parfait. Parfois la démarque se constitue très lentement, comme dans Blackmail où l'on se demande si l'acheteur de cigare est normalement pris dans la série client-choix-préparatifs- allumage ou si c'est un maître chanteur qui se sert du cigare et de son rituel pour provoquer déjà le jeune couple.
D'autre part et en second lieu, conformément à la relation abstraite, on appellera symbole non pas une abstraction, mais un objet concret porteur de diverses relations, ou des variations d'une même relation, d'un personnage avec d'autres ou avec soi-même. Le bracelet est un tel symbole dès The ring comme les menottes dans Les trente neuf marches ou l'alliance de Fenêtre sur cour. Les démarques et les symboles peuvent converger particulièrement dans Les enchaînés ; la bouteille suscite une telle émotion chez les espions qu'elle saute par delà même la série habituelle vin-cave-dîner ; et la clé de la cave ; que l'héroïne tiens dans sa main serrée, porte l'ensemble des relations qu'elle entretient avec son mari à qui elle la volée, avec son amoureux à qui elle va la donner, avec sa mission qui consiste à découvrir ce qu'il y a dans la cave.
On voit qu'un même objet, une clé par exemple peut suivant les images où il est pris fonctionner comme un symbole (Les enchaînés) ou une démarque (Le crime était presque parfait). Dans Les oiseaux la première mouette qui frappe l'héroïne est une démarque puisqu'elle sort violemment de la série coutumière qui l'unit à son espèce, à l'homme et à la nature. Mais les milliers d'oiseaux, toutes espèces réunies, dans leurs préparatifs, dans leurs attaques, dans leurs trêves, sont un symbole : ce ne sont pas des abstractions ou des métaphores, ce sont de véritables oiseaux, littéralement, mais qui présentent l'image inversée des rapports de l'homme avec la nature, et l'image naturalisée des rapports des hommes entre eux. Les démarques sont des chocs de relations naturelles (série) et les symboles des nœuds de relations abstraites (ensemble).
Inventant l'image mentale ou l'image-relation, Hitchcock s'en sert pour clôturer l'ensemble des images actions et aussi des images perception et affection. D'où sa conception du cadre. Et non seulement l'image mentale encadre les autres, mais les transforme en les pénétrant. Par là, on pourrait dire d'Hitchcock qu'il achève, qu'il accomplit tout le cinéma en poussant l'image-mouvement jusqu'à sa limite(...).
Incluant le spectateur dans le film, et le film dans l'image mentale, Hitchcock accomplit le cinéma. Toutefois, certains des plus beaux films d'Hitchcock laissent apparaître le pressentiment d'une question importante. Vertigo nous communique un véritable vertige ; et, certes, ce qui est vertigineux, c'est au cœur de l'héroïne, la relation de la même avec la même qui passe par toutes les variations de ses rapports avec les autres (la femme morte, le mari, l'inspecteur). Mais nous ne pouvons pas oublier l'autre vertige, plus ordinaire, celui de l'inspecteur incapable de gravir l'escalier du clocher vivant dans un étrange état de contemplation qui se communique à tout le film et qui est rare chez Hitchcock. Et Complot de famille : la découverte des relations renvoie, même pour rire, à une fonction de voyance. D'une manière plus directe encore, le héros de Fenêtre sur cour accède à une image mentale, non pas simplement parce qu'il est photographe mais parce qu'il est dans un état d'impuissance motrice : il est réduit en quelque sorte à une situation optique pure. S'il est vrai qu'une des nouveautés d'Hitchcock était d'impliquer le spectateur dans le film, ne fallait-il pas que les personnages eux-mêmes, d'une manière plus ou moins évidente, fussent assimilables à de spectateurs ? Mais alors, il se peut qu'une conséquence apparaisse inévitable : l'image mentale serait moins l'accomplissement de l'image action et des autres images, qu'une remise en question de leur nature et de leur statut. Bien plus, c'est toute l'image mouvement qui serait alors mise en question, par la rupture des liens sensori-moteurs dans tel ou tel personnage. Ce qu'Hitchcock avait voulu éviter, une crise de l'image traditionnelle au cinéma, arrivera pourtant à la suite d'Hitchcock et en partie par l'intermédiaire de ses innovations.
En premier lieu, l'image ne renvoie plus à une situation globalisante ou synthétique, mais dispersive. Les personnages sont multiples, à interférences faibles, et deviennent principaux ou redeviennent secondaires. Ce n'est pourtant pas une série de sketches ou une suite de nouvelles, puisqu'ils sont tous pris dans la même réalité qui les disperse. Robert Altman explore cette direction dans Nashville avec des pistes sonores multiples et l'écran anamorphique qui permet plusieurs mises en scènes simultanées. La ville et la foule perdent leur caractère collectif et unanimiste à la King Vidor; la ville en même temps cesse d'être une ville d'en haut, la ville debout avec gratte-ciel et contreplongée, pour devenir la ville couchée, la ville horizontale ou à hauteur d'homme, où chacun mène sa propre affaire pour son propre compte.
Chez Cassavetes, l'ellipse cesse d'être un mode de récit, une
manière dont on va d'une action à une situation partiellement
dévoilée : Elle appartient à la situation même,
et la réalité est lacunaire autant que dispersive. Les enchaînements,
les raccords ou les liaisons sont délibérément faibles.
Le hasard devient le seul fil conducteur comme dans Quintet d'Altman. Tantôt
l'événement tarde et se perd dans les temps morts, tantôt
il est là trop vite mais il n'appartient pas à celui à
qui il arrive (même la mort). Et il y a d'intimes rapports entre ces
aspects et l'événement : le dispersif, le direct en train de
se faire, le non appartenant. Cassavetes joue de ces trois aspects dans Le
bal des vauriens et dans La ballade des sans espoirs. On dirait des événements
blancs qui n'arrivent pas à concerner vraiment celui qui les provoque
ou les subit, même quand ils le frappent dans sa chair ; des événements
dont le porteur, un homme intérieurement mort, comme dit Lumet a hâte
de se débarrasser. (p279)