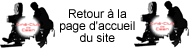|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Eclipses n°52


Dans son édito, Système D, Youri Deschamps écrit que "sans nul doute, la "génération 90" a vu naître un véritable fils prodigue : Arnaud Desplechin, qui, dès son premier long métrage (La sentinelle, 1992), devient la figure de proue d’un cinéma d’auteur hexagonal alors foisonnant. Le cinéaste s’octroie ensuite les faveurs d’un public beaucoup plus conséquent avec Comment je me suis disputé… - Ma vie sexuelle (1996), tout à la fois intimiste et porté par un sens du romanesque en perpétuelle expansion – formule qui deviendra la marque de fabrique du cinéaste. Dans son film suivant, Esther Kahn (2000), un film "d’époque", l’auteur reste toutefois fidèle à son sujet de prédilection : la naissance à soi et aux autres, qui se réalisent ici par l’intermédiaire de la pratique théâtrale.
Après une parenthèse expérimentale plus aride (Léo, en jouant "Dans la compagnie des hommes" – 2003) mais tout aussi passionnante, le cinéaste revient en très grande forme avec Rois et Reine (2004), qui suit les parcours parallèles de deux anciens amants. Peuplé de fantômes et couvert de plaies laissées béantes, Rois et Reine conjugue la souffrance et la fantaisie avec un singulier sens du rythme et du contraste, qui emporte immédiatement l’adhésion.
Avant de signer Un conte de noël (2008), qui constitue à la fois la synthèse et le sommet actuel de son œuvre, Desplechin tourne un documentaire sur sa famille, L’Aimée (2007), dans lequel il filme son père notamment, qui vient de vendre la grande maison familiale de Roubaix.
Cette première monographie consacrée à l’œuvre
d’Arnaud Desplechin recueille des analyses traitant de chacun de ses
films (deux notes de lecture sont proposées à titre d'exemple
à la fin de ce compte-rendu), mais également des contributions
plus transversales, consacrées aux thèmes et motifs récurrents,
ou bien centrées sur des questions de mise en scène propres
à l’auteur. On retiendra ici tout particulièrement l'analyse
de Sébastien David (voir notes de lecture).
I. Corps du langage et langage du corps
- Les figurations de l’ambivalence (Approche transversale) par SÉBASTIEN DAVID
- États d’âme, états des corps (La Vie des morts, 1991 ; Comment je me suis disputé…, 1996 ; Rois et reine, 2004 ; Un conte de Noël, 2008) par CÉLINE SATURNINO
- L’art du sourire (Rois et reine, 2004) par VIOLAINE CAMINADE DE
SCHUYTTER
II. Le théâtre du monde et la scène du vivant
- Loin de moi (La Sentinelle, 1992 ; Esther Kahn, 2000) par PIERRE JAILLOUX
- La vie comme un roman (Comment je me suis disputé…, 1996) par YOLA LE CAÏNEC
- Une histoire à dormir debout (Comment je me suis disputé…, 1996) analyse de la séquence d’ouverture par BRUNO FOLLET
- Imitation of Life (Rois et reine, 2004) par MICHAËL DELAVAUD
- Une mécanique victimaire (Un conte de Noël, 2008) par LOETITIA
PAPION
III. En famille : l’avis des morts
- Ce que les morts ont à dire (La Vie des morts, 1991 ; La Sentinelle, 1992 ; Rois et reine, 2004 ; Un conte de Noël, 2008) par HÉLÈNE VALLY
- Comment (dés)investir l’espace familial (La Vie des morts, 1991) par RÉMI GONZALEZ
- D’entre les morts (Un conte de Noël, 2008) par YOURI DESCHAMPS
- Though this house give glimm’ring light (Un conte de Noël,
2008) analyse de la partition musicale par GRÉGORY RATTEZ
IV. Héritiers et héritages
- Les héritiers symptomatiques (Approche transversale) par SAAD CHAKALI
- La chambre ouverte (Sur l’influence de François Truffaut) par JÉRÔME LAUTÉ
- Judaïsme et judéité (Esther Kahn, 2000 ; Un conte de Noël, 2008) par ENRIQUE SEKNADJE
- Des éclats de lumière par HÉLÈNE VALLY.
Notes de lecture (extraits des textes) :
Les figurations de l’ambivalence (Approche transversale) par SÉBASTIEN DAVID
... En chaque film jaillissent des évènements inattendus et pourtant déterminants, comme si des forces invisibles venaient troubler le monde, logeaient en son épaisseur et animaient les personnages et leurs relations. C'est toujours d'abord la prééminence du symbole qui vient irradier le récit et renier l'ordre habituel des choses dans le cinéma d'Arnaud Desplechin. Ainsi, dans Un conte de Noël, seul face au public recueilli, Abel (Jean-Paul Roussillon) déclare : "Mon fils est mort.. Je n'éprouve pas de chagrin. La souffrance est une toile peinte (... En mourant mon fils devient mon fondateur. Cette perte est ma fondation". Plus tard, informée de sa maladie, Junon (Catherine Deneuve) compagne d'Abel, se rend à l'hôpital pour apprendre que seule une greffe de moelle osseuse pourra la sauver, les chances de trouver un donneur sont infimes d'autant que Junon n'a ni plus ni aïeul ni frère, alors seuls donneurs que la médecine parait admettre. Devant la possibilité, émise par son mari, que ce soit les enfants ou petits-enfants qui soient les donneurs, le médecin demeure interdit, rejetant cette possibilité : la réciproque apparait comme la violation d'un tabou. Interloquée, Junon affirme au contraire que rien en s'oppose à ce que ses enfants lui "donnent la vie". Apogée de l'ambivalence quant à une réappropriation symbolique, les personnages violent la nécessité de l'ordre naturel, le rendent réversible. Transgression suprême, contre toute causalité ordinaire et visible, dans Un conte de Noël, les enfants, et parfois leur mort, octroient ou rendent la vie à leurs ascendants.
A cette dimension symbolique vient s'ajouter une reconfiguration de l'image. En effet, si tout plan de cinéma fait signe vers ce qui le compléterait, si le cadre est d'abord un cache, les films d'Arnaud Desplechin impliquent bien davantage en créant des formes d'entre-expressions entre les présents et les absents, les mots et les choses, les morts et les vivants, en mettant en scène des ondes de chocs traversant sourdement les plans et vibrant de personnages en personnages.
Ainsi, au début de La vie des morts, alors que dans le jardin deux personnages révèlent que Patrick est entre la vie et la mort, un plan montre Pascale dénudée (Marianne Dénicourt), dans la salle de bain, prise de soubresauts et de nausées. Le cadre laisse apparaître son corps à moitié immergé et tout se passe comme si la violence de la révélation, faite ailleurs et à un autre personnage, trouvait un écho dans ce plan et dans l'organisme de la jeune femme. Plus tard, ce sont ainsi les menstruations de Pascale qui apparaissent au moment précis où son cousin rend son dernier souffle, manifestations dont ne saurait dire si elles sont le signal de l'agonie, le soulagement d'un poids enfin délesté, ou l'expression de la béance d'une blessure que Pascale aurait souhaitée et qui achèverait ainsi de tuer le membre de la famille, jusque là seulement presque mort.
De la même manière, dans Rois et reine, la terrible lettre de Louis (Maurice Garrel) lue par ses soins d'outre-tombe, laisse sur le ventre de sa fille Nora une meurtrissure sensible comme provoquée par l'horreur des paroles, affliction visible plusieurs plans plus tard, expression d'une intériorité affectée, voire infestée, qui inscrit à la surface de la peau nue une véritable plaie du sens.
L'image dans les films d'Arnaud Desplechin n'est alors pas seulement un champ de formes, mais sillonnée de forces invisibles et efficientes. A sa manière, l'auteur réactualise ainsi le montage des attractions cher à Eisenstein qui ne "limite plus les possibilités expressives au déroulement logique de l'action mais concourt à établir un effet thématique final" (Le montage des attractions, S. M. Eisenstein, Le film sa forme/ son sens, Christian Bourgois, Paris 1976). Tressaillement de l'ordre des choses, de la cohérence narrative, ce montage qui pointe une forme d'entre-expression et de communication entre les êtres et les absents, entre les événements et les personnages, s'impose comme une sollicitation au spectateur, démultipliant la violence symbolique ressentie. Autrement dit, l'ambivalence, c'est le surgissement d'une doublure du visible par l'invisible, le jaillissement d'une logique qui transcende la représentation, dévoilant que tous les personnages et tous ces corps ne trouvent leur incandescence qu'à être les ombres d'idées ou d'affects qui les font agir et dont l'attention des spectateurs est comme l'écran qui les reflète et les fait être.
On achèvera cette traversée des figures de l'ambivalence en confessant ceci, ces (dé) figurations ne sont jamais vécus par les spectateurs comme des aberrations, mais tout au contraire comme les conditions même de sa participation. Si les films d'Arnaud Desplechin sont des expériences si viscérales, si intenses, si personnelles, c'est justement car ces figures de l'équivoque conduisent chacun à conférer de la chair à ces êtres de lumière et, qu'en retour, leur rayonnement pénètre notre intimité. De ces figurations de l'équivoque jaillissent une certitude : face à ces personnages qui semblent nous regarder irrésistiblement, nous savons que nous existons.
Une mécanique victimaire (Un conte de Noël, 2008) par LOETITIA PAPION
Dans le prologue, Elisabeth présente son jeune frère Henri comme un "enfant-médicament". Le projet d'Abel et de Junon consistait à guérir un enfant en en créant un autre, le placenta d'Henri étant attendu comme un remède au lymphome de Burkitt de l'aîné, Joseph. Ainsi, Henri n'est pas accueilli dans la famille pour lui-même, mais comme un objet conçu pour réparer le mal. Conçu comme un remède inutile, il devient un poison familial et finit par incarner le Mal aux yeux d'Elisabeth qui le bannit de la cité Vuillard : " Je connais peu de gens qui furent autant haïs que moi; et à chaque fois je m'en étonne" écrit-il à sa sœur. Son statut de donneur compatible pour Junon contribue néanmoins à sa réintégration. Une approche anthropologique, appuyée sur les thèses de René Girard, invite à regarder Henri comme un bouc-émissaire. Cependant et parce qu'il s'agit d'un conte, la réparation se fait à rebours d'un héros tragique, jusqu'à la réparation finale.
La pièce de théâtre imaginée par les enfants rejoue de façon cocasse l'épisode du bannissement d'Henri : Le prince Zorro est chassé du château à cause de ses actions infamantes. Sous la torture, il avoue avoir "couché avec une bique". Sa réintégration dans le royaume lui coutera un bras ("On coupa le bras du prince et il devint très gentil"). De même la réintégration d'Henri dans le clan familial est rendue possible en échange de sa moelle osseuse. Dans la pièce des enfants, la crise trouve sa résolution dans un acte de démembrement puisque pour réparer le mal, le prince Zorro donne un morceau de sa personne : sur scène Basil scie le bras de son frère avec une épée en plastique et finit par arracher un bras de poupée qu'il brandit en signe de triomphe. Basile soustrait le mal du prince en le dépeçant. la victime est démembrée vivante devant une assistance complice. Ce geste est supposé apporter le salut à la communauté, en lavant les péchés du petit prince zoophile.
Though this house give glimm'ring light (Un conte de Noël, 2008) analyse de la partition musicale par GRÉGORY RATTEZ
La composition du Songe d'une nuit d'été de Mendelssohn dans sa version de 1843, opus 61 comprend successivement : ouverture, scherzo, marche des elfes, chœur des elfes, intermezzo, nocturne, marche nuptiale, prologue, marche funèbre, danse bergamasque et le final "Though this house give glimm'ring light". Il s'agit de pièces symphoniques destinées à s'intercaler entre les différentes scènes du drame homonyme de Shakespeare. Dans le film d'Arnaud Desplechin, différents mouvements de l'œuvre de Mendelssohn arrangée par Grégoire Hetzel nous parviennent. Citons par exemple : l'intermezzo, associé aux séquences du feu d'artifice qui apparaissent également comme une trêve dans la guerre familiale qui se joue ; l'ouverture, lors du départ de la famille à la recherche de Simon, où les violons énonçant un thème rapide et rebondissant soulignent la précipitation ambiante ; l'ouverture qui vient également illustrer le début du générique de fin.
Les allusions au drame de Shakespeare dans le film sont nombreuses : l'apparition à la télévision d'une scène tirée de l'adaptation de cette pièce par Max Reinhardt en 1935 et l'hallucination de Paul voyant un loup, être de la forêt mystérieuse, au beau milieu du salon; la maquette du théâtre de Thésée chez Elizabeth dans la dernière séquence du film; l'intrigue sous-jacente de l'amour interdit entre Simon et Sylvia dont l'étymologie du prénom n'est pas anodine dans ce contexte; la denier réplique d'Elisabeth qui est également la dernière de Puck dans la pièce de Shakespeare.
La bande originale de Grégoire Hetzel se fonde sur une autre pièce faisant elle aussi référence au thème de la nuit et du rêve : Lullaby de George Gershwin. Composé en 1919 pour quatuor à cordes, cette berceuse sera bientôt réutilisée dans un opéra en un acte du même compositeur : Blue Monday de 1922. Dans cet opéra, le thème de la berceuse sert de base pour l'air intitulé "has anyone seen my Joe ?". Ce Joe ne serait-il pas, dans le film, un diminutif de Joseph, enfant disparu dont le drame semble se reproduire et qui parait manquer à tous ? Toujours est-il que les séquences dans lesquelles la berceuse se fait entendre semblent corroborer cette possibilité : la berceuse illustre la lettre de Henri qui, bien que pour de raisons différentes, a disparu lui aussi de la famille depuis 5 ans; elle se fait entendre lorsque Spatafora puis Claude et enfin Paul, respectivement ami de la famille, beau-fils et petit-fils semblent agir pour Junon comme le ferait un fils : cadeau, inquiétude quant à la greffe et présentation au conseil d'experts pour devenir donneur de moelle... Autant de réincarnations du fils disparu : lors de l'anesthésie d'Henri, qui apparait comme à demi mort (comme Joseph) et réalise pour sa mère ce qu'il n'a pu réaliser pour son frère décédé. La berceuse stoppe à la séquence suivante lorsqu'il se réveille. La berceuse apparait donc comme une autre référence musicale à la nuit et au rêve et semble ici vouloir personnifier Joseph, le Vuillard défunt mais dont le fantôme reste terriblement présent dans le film.
Si la musique de Gershwin se fait entendre comme écho au fils défunt, tous les Vuillard apparaissent représentés par le jazz. Dans les différentes chaînes hi-fi de la maison se succèdent en effet, Duke Ellington, Charles Mingus, Joe Henderson, Brook Benton... Le jazz apparait ainsi comme une réelle tradition familiale. La musique diffusée dans la maison roubaisienne est exclusivement acoustique, aucun son électronique ne transparait. Le jazz est quasiment la seule musique diffusée dans la maison. Si la musique de Mendelssohn semble être utilisée comme musique de scène, descriptive de la psychologie et de l'action des personnages, le jazz apparait quant à lui comme une musique en scène, tour à tour choisie, diffusée ou imitée par les Vuillard, vivants ou morts.