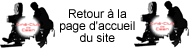Volume dirigé par Youri Deschamps

Un volume qui fait le point sur la msie en scène de Douglas Sirk, 26 ans après le livre de Jean-Loup Bourget aux éditions Edilig.
SOMMAIRE
Un mensonge qui dit toujours la vérité,
introduction de YOURI DESCHAMPS
I. De Detlef Sierck à Douglas Sirk
- Orgueil et préjugés (La Fille des marais – 1935, Les Soutiens de la société – 1935, Paramatta, bagne de femmes – 1937) par YANN CALVET
- Vers un ailleurs ( La Habanera – 1937, Hitler’s Madman – 1943) par MICHAËL DELAVAUD
- Une parenthèse européenne en Amérique (L’Aveu – 1944, Scandale à Paris – 1946, Des filles disparaissent – 1947) par DAMIEN DETCHEBERRY
II. Tours et détours : d’un genre à l’autre
- Dors, mon amour (L’homme aux lunettes d’écaille – 1948 , Jenny, femme marquée – 1949) par CÉLINE SATURNINO ET RÉMI GONZALEZ
- Closer to Heaven (Taza, fils de Cochise, 1954 ; Le Signe du païen,
1954 ; Les Ailes de l’espérance, 1957 ; La Ronde de l’aube,
1958) par FRANCK BOULÈGUE
III. Splendeurs du mélodrame
- Le droit du plus fort (All I Desire – 1953, Demain est un autre jour – 1956) par VIOLAINE CAMINADE DE SCHUYTTER
- De l’ambivalence des décors et des objets (All I Desire – 1953, Demain est un autre jour – 1956) par ROBERTO CHIESI
- L’invraisemblable mysticisme (Le Secret magnifique – 1954) par JEAN-MARIE SAMOCKI
- Through the looking-glass (Tout ce que le ciel permet – 1956) par JÉRÔME LAUTÉ
- Larmes amères (Le Temps d’aimer et le temps de mourir – 1958) par JEAN- BAPTISTE VIAUD
- Le mélodrame, instrument de protestation insoupçonné (Mirage de la vie – 1959) par PAMELA MESSI
- Des images et des couleurs (Mirage de la vie – 1959) par ROLAND
CARRÉE
IV. Héritages
- À travers l’hommage, la découverte de soi-même (l’influence de Douglas Sirk sur le cinéma de Rainer Werner Fassbinder) par PIERRE-SIMON GUTMAN
- À la recherche du mélodrame perdu (l’empreinte de Douglas Sirk dans l’oeuvre de Pedro Almodovar, François Ozon et Todd Haynes) par JEAN-MAX MÉJEAN
- L’ancien et le nouveau (étude comparée des séquences d’ouverture d’Écrit sur du vent – 1957 et Point limite zéro – 1971, de Richard C. Sarafian) par LUC DUVINAGE.
Le livre présente une analyse des principaux films de Douglas Sirk depuis les mélodrames allemands, en passant par les œuvres de transition que sont L'aveu (1944), Scandale à Paris (1946) et Des filles disparaissent (1947) qui constituent selon la formule de Jean-Loup Bourget "une tentative pour réaliser à l'intérieur du système hollywoodien, un cinéma à l'européenne, tant par le sujet que par le propos." Il est rappelé que ce sont trois histoires ayant un cadre typiquement européen, non pas l'Europe en crise que Douglas Sirk vient de quitter mais celle du XIXe siècle et du début du XXe siècle : L'aveu est l'adaptation d'un roman renié par Anton Tchekhov, Drame de la chasse. Scandale à Paris est l'adaptation libre des mémoires de François Eugène Vidocq publiées en 1828 et l'action Des filles disparaissent se situe au tournant du 20e siècle, renvoyant clairement aux meurtres de Jack l'eventreur qui ont secoué l'Angleterre victorienne.
Sont aussi analysées L’homme aux lunettes d’écaille (1948) et Jenny, femme marquée (1949) deux films noirs avant que les auteurs n'abordent le mélodrame, genre emblématique du cinéaste.
Remarquable article de Jérôme Lauté sur Tout ce que le ciel permet, chef-d'œuvre de Sirk sur lequel pourtant il a déjà été beaucoup écrit. S'appuyant principalement sur le livre d'entretien de Jon Halliday, l'auteur rappelle que si Sirk a déclaré que le studio tenait au titre, qu'il a accepté, mais parce qu'il pensait, qu'en ce qui le concerne, "le ciel était radin" (JH, p.70). C'est en effet bien plutot en incarnant la philosophie de Thoreau que Ron parvient à déciller les yeux de Cary. Le dernier plan du film montre Ron alité, Cary près de lui, position symétrique à celle du Secret magnifique où c'était le personnage joué par Rock Hudson qui veillait anxieusement celui interprété par Jane Wyman dont il attendait le réveil après l'opération miracle qui devait lui rendre la vue. Ici on peut considérer que le personnage de Jane Wyman retrouve également la vue, ou plutot apprend grâce à Ron à distinguer l'essentiel de l'accessoire.
Ce processus de decillement est certes permis par le ciel comme l'indique le plan en plongée sur la baie vitrée des amis de Ron. Plan filmé comme venu du ciel, comme si un démiurge bienveillant veillait sur la destinée des personnages. Mais vision ironique a posteriori quand on sait à quelles oppositions cette relation doit se heurter. Jérôme Lauté devellope ainsi le processue de surveillance auquel est soumise Cary et surtout comment Sirk le met en scène au travers des multiples fenêtres et mirorirs du film:
"
Tout ce que la société permet.
Le premier plan du film donne le ton : la caméra cadre le clocher d'une église. Ce même plan servira de leitmotiv visuel pour marquer le passage du temps, mais plus encore, le clocher apparaît comme le symbole de la surveillance dont Cary Scott fait l'objet, hypothèse accréditée par le mouvement exécuté à la grue qui part du clocher pour aboutir à la rue menant à sa maison. Cette surveillance est exercée par les membres du Country club auquel elle appartient, par les commères en particulier, à l'affût des moindres faits et gestes d'une veuve encore jolie, qui représente donc une menace potentielle pour leurs maris, comme en témoigne la séquence au cours de laquelle l'un des membres du Country club essaie d'embrasser Cary contre son gré, après s'être plaint de l'ennui qui règne dans son foyer.
Mais cette surveillance est également le fait des propres enfants de Cary. En effet son fils Ned, jeune homme suffisant, lui reproche dès le début du film de porter une robe décolletée, de couleur rouge de surcroît, comme s'il déniait à sa mère le droit d'avoir une sexualité après la mort de son époux. Sa soeur Kay ne se gêne d'ailleurs pas pour lui faire la remarque, rapprochant ses paroles d'un complexe d'œdipe mal digéré. Kay en effet a fait des études de sociologie et, à ce titre, elle a tendance à considérer chaque être humain comme un sujet d'étude, ce que lui rappellera son frère.
Le personnage de Kay est d'ailleurs l'un des plus intéressant du film, en ce qu'il subit une évolution inverse de celle de Cary : sa culture et sa formation devraient lui permettre de jeter un autre regard sur le personnage de Ron et de s'affranchir des convenances sociales pesant sur les femmes dans cette bonne société WASP des années 50. Cela semble être le cas au moins au début, comme le révèle son apparence physique, jupe sage, grosses lunettes, conforme à la caricature de l'intellectuelle colportée par le cinéma hollywoodien de l'époque. Mais cette apparente émancipation dissimule mal une envie de se conformer au code de bonne conduite en vigueur, ce que révéleront sa crainte des ragots et son refus, aussi net que celui de son frère de voir sa mère épouser Ron. De manière ironique, c'est pourtant elle qui l'exhorte à ne pas se comporter comme les veuves égyptiennes, enfermées vivantes dans la pyramide servant de tombeau à leur époux ; c'est elle aussi qui finira par se fiancer bien sagement avec un garçon tout ce qu'il y a de plus falot. Il est significatif qu'au moment où elle annonce ses fiançailles à sa mère, elle ait délaissé son costume d'intellectuelle pour celui de future femme au foyer, comme le résume cruellement la séquence au cours de laquelle elle demande conseil à sa mère à propos d'une teinte de vernis à ongle. son frère présent à ce moment lui rétorque qu'elle intègre "le clan des femelles "
A cette surveillance constante s'ajoute le traitement particulier dévolu aux objets et aux espaces. Ainsi la coupe gagnée par le mari de Cary, fièrement exhibée par Ned devant le prétendant de sa mère "en titre", comme pour lui indiquer que celui-ci ne sera jamais à la hauteur, rappelle pendant toute la première moitié du film le souvenir du père et du mari disparus. Plus tard, c'est l'absence de cette même coupe, remisée par Cary avant de recevoir Ron chez elle officiellement qui choquera Ned, averti par cette absence de ce qu'il appelle pudiquement "les changements à venir" dans la maison. Ned a bien compris que la coexistence d'Harvey, l'autre prétendant, et de la coupe dans le même espace, montrait que celui-ci n'avait aucune chance de remplacer celui qui l'avait remportée. Au contraire, sa place hors champ, à la cave qui plus est, montre bien que Cary s'est affranchie du rôle de veuve sage éplorée que la société de ses propres enfants entendaient lui faire jouer et qu'elle redevient une femme après avoir été une mère.
Miroirs et fenêtres
Dans la maison de Cary, les miroirs, présents dans chaque pièce, contribuent eux aussi à la surveillance dont la jeune veuve fait l'objet, en lui renvoyant l'image d'un horizon sans issue, sinon celle de la maison, mais également en renvoyant à Cary l'image de ce qu'une femme, veuve ou non, doit être ou doit faire dans cette petite ville de la Nouvelle Angleterre. Le motif du reflet rappelle la nature clivée du personnage de Cary, tiraillée entre les conventions et son rôle de mère de famille, et son amour pour Ron. Comme le déclare le cinéaste : " le miroir est l'imitation de la vie. Ce qui est intéressant dans un miroir, c'est qu'il ne montre pas l'individu tel qu'il est, mais son opposé (Jon Halliday, conversations avec Douglas Sirk, Cahiers du Cinéma 1997, collection Atelier, p. 65)
La première apparition des enfants de Cary se fait dans un miroir : on y distingue en effet leur reflet à l'instant où ils entrent dans la chambre de leur mère et au moment même où le cinéaste a cadré le branche de " koelreuteria ", l'arbre censé pousser là où règne l'amour, selon une légende chinoise racontée par Ron à Cary lors de leur première rencontre. Et ce rameau est justement cadré près du miroir pour symboliser l'intrusion de cet élément nouveau dans la vie de la jeune veuve. Et c'est seulement après être apparus comme personnages dans le miroir qu'un panoramique rapide les fait exister en tant que personnes lorsqu'ils saluent leur mère. On remarque un miroir derrière la coupe du mari et sur son piano. Mais le miroir définitif au sens de point de non-retour, est bien entendu celui de l'écran de télévision, lors d'une séquence les plus ironiquement désespérée jamais filmée par Sirk. Elle se situe au moment où Cary à rompu avec Ron et croit que celui-ci a une liaison avec la jeune femme brièvement entrevue chez les amis de celui-ci. De plus son fils Ned lui apprend qu'il va partir travailler pour une compagnie pétrolière en Iran et sa fille qu'elle va se marier : elle va donc se retrouver totalement seule, alors même qu'elle pensait au moins "retrouver" ses enfants en rompant avec l'homme qu'elle aimait. C'est le soir de Noël et Sirk ne se gêne pas pour en exhiber le décorum : chants, traîneaux, sapins, guirlandes. Et le cadeau tant attendu des deux enfants pour leur mère arrive enfin : il s'agit d'un poste de télévision. Survient alors le plan le plus cruel et, à juste titre le plus célèbre du film, celui qui voit Cary se refléter sur l'écran cathodique, pendant que le vendeur qui lui a livré l'appareil lui fait l'article en évoquant le spectacle de la vie qu'elle pourra y contempler.
Le plan est d'autant plus cruel et douloureux que le reflet de Cary est encadré par une carte de Noël et un ruban en papier cadeau, qui introduisent un sur-cadrage du reflet de la jeune veuve, qui semble condamnée plus sûrement que les femmes égyptiennes dans les pyramides
Les fenêtres de la maison de Sara, l'amie de Cary servent aux invités à épier l'arrivée du couple scandaleux et se répandre du même coup en propos calomnieux à son égard. La fenêtre renvoie donc une fois de plus au thème de la surveillance.
Chez Alida et Mike, Cary découvre non seulement le Walden de Thoreau mais également une manière débridée de recevoir et de faire la fête à l'opposée de l'atmosphère collet monté des réceptions du Country club. Le cinéaste prend bien soin de cadrer, en contre-plongée d'abord et en plongée ensuite, la baie vitrée située au plafond de bois de Mike et Alida. En contre plongée lors de la discussion sur Walden dans lequel Thoreau raconte qu'il a pris soin dans la cabane qu'il a construite, de ménager le plus d'ouvertures possibles, pour voir le ciel et les étoiles ou les nuages lorsqu'il fait jour. Et c'est justement ce que fait la baie vitrée du plafond : elle ouvre l'espace vers un champ de possibles d'autant qu'à ce moment la relation entre Cary et Ron en est encore à ses débuts.
Et, la fête battant son plein, cette même baie est de nouveau filmée, mais cette fois en plongée, comme venu du ciel, comme si un démiurge bienveillant veillait sur la destinée des personnages, vision ironique a posteriori quand on sait ce qu'il va advenir de cette relation. A ce sujet, Sirk a déclaré que le studio tenait au titre, qu'il a accepté, mais parce qu'il pensait, qu'en ce qui le concerne, "le ciel était radin" (JH, p.70)
L'autre occurrence est celle de la grande baie vitrée que Ron installe dans le moulin abandonné qu'il a réaménagé pour Cary : occupant l'espace d'un mur, elle donne directement sur la campagne aux alentours, exactement comme dans la cabane aménagée par Thoreau près de l'étang de Walden, pour laquelle le narrateur refuse d'empêcher la lumière du soleil ou de la lune d'entrer. Elle s'oppose au motif de la fenêtre en tant qu'objet de surveillance, puisqu'il n'y a rien à surveiller mais tout à observer, à savoir le spectacle de la nature. Elle symbolise également la "transparence" du personnage de Ron, son absence d'affectation. Et le dernier plan du film montre Ron alité, Cary près de lui, contrairement au Secret magnifique où c'était le personnage joué par Rock Hudson qui veillait anxieusement celui interprété par Jane Wyman dont il attendait le réveil après l'opération miracle qui devait lui rendre la vue. En même temps dans tout ce que le ciel permet, on peut considérer que le personnage de Jane Wyman retrouve également la vue, ou plutot apprend grâce à Ron à distinguer l'essentiel de l'accessoire.
Le Walden de Thoreau greffé dans un mélodrame hollywoodien
Walden est publié en 1854 par le poète philosophe Henry David Thoreau (1817-1862). Elle oscille entre l'essai et le récit autobiographique d'une expérience mené par l'écrivain qui, pendant deux années a vécu retiré du monde dans une cabane qu'il a lui-même construite près de l'étang de Walden dans le Massachusetts. L'auteur de la désobéissance civile y livre ses réflexions inspirées par ce mode de vie en contradiction avec les valeurs des jeunes Etats-Unis : la mobilité, le culte du progrès et la recherche du bonheur dans le contexte du capitalisme naissant et de la révolution industrielle. On peut lire dans cette œuvre les prémices de ce qui deviendra bien plus tard le mouvement écologique
L'ouvrage de Thoreau est non seulement cité mais il apparaît
dans le film et fait l'objet d'une discussion entre Cary et Alida, l'épouse
de l'amie de Ron qui a fui un poste de publicitaire à New York pour
s'installer en pleine campagne de Nouvelle Angleterre, à l'instar de
Thoreau. Le parallèle est évoqué : le mari d'Alida a
lu Walden, qu'il considère comme sa bible alors que Ron, lui est Walden.
C'est du moins ce que Alida laisse entendre. A la question de savoir si Ron
a lu Walden, Alida répond ; "Ron lui, le vit", ce qui est
pour Sirk une manière de refuser une interprétation trop intellectuelle
et distanciée de cette référence littéraire et
philosophique dans un film hollywoodien, tout en reconnaissant l'importance
"fondatrice" du livre de Thoreau pour lui-même et pour le
film : "[Walden] était le vrai sujet du film [...] mais avec un
film de ce genre, la seule solution c'est de déraciner un arbre dans
le jardin et de le replanter dans le salon (JH p. 70). Ce n'est donc pas un
hasard si le personnage de Ron est un jardinier et pépiniériste
: cela permet de donner une forme littérale à la métaphore
de la double greffe à l'œuvre dans le film : celle d'un essai
philosophique dans un drame hollywoodien et celle du déplacement du
personnage de Cary d'un univers de convention et de convenances vers un univers
de vérité et de transparence. Et comme toutes les greffes, celle-ci
prend plus ou moins bien, et suscite même un violent rejet aux deux
tiers du film...
"
Jérôme Lauté (extraits des pages 70 à 77, Through the looking glass, dans Eclipses-revue de cinéma n° 46, juin 2010)